Le dictionnaire de la BD
Retrouvez ici en un coup d'œil le dictionnaire esthétique et thématique de la bande dessinée afin d’expliquer termes usuels ou plus techniques, genres, thèmes, concepts permettant d'approfondir l'analyse de la bande dessinée.
Cette publication en ligne, initiée et coordonnée par Thierry Groensteen, représente une première version partielle du Bouquin de la bande dessinée publié en 2021 aux éditions Robert Laffont, dans la collection « Bouquins », avec des textes actualisés et complété par un tiers d’articles supplémentaires, non accessibles ici.
a

abstraction
La bande dessinée abstraite a été labellisée et en quelque sorte officialisée comme catégorie, sinon comme genre, avec la parution, en 2009, de l’anthologie Abstract Comics éditée chez Fantagraphics par Andrei Molotiu.
Depuis cette date, on a vu plus d’un auteur creuser ce sillon, et un ou deux éditeurs l’encourager. Nous n’avons pas assez de recul pour savoir s’il s’agira d’un phénomène éphémère ou d’une forme de bande dessinée qui perdurera aux côtés des productions ordinaires, fondées sur la représentation et la narration. En tout état de cause, il est peu vraisemblable que la bande dessinée abstraite occupe davantage qu’une niche ; elle ne semble pas de nature à séduire le grand public, qui entretient d’autres attentes à l’endroit du médium. Mais, depuis cette position marginale qui est constitutivement la sienne, elle interroge la définition de la bande dessinée comme telle, elle oblige à en réconsidérer les fondements mêmes. Jusque-là en effet, la bande dessinée était par essence mimétique parce qu’elle obéissait à une vocation narrative et qu’elle se positionnait comme une littérature.
adaptations littéraires
Le processus d’adaptation se définit par la transposition d’une œuvre d’un média à un autre, en en conservant la trame. Lorsqu’il s’agit de passer d’un texte littéraire à la bande dessinée, l’économie narrative se déplace en grande partie du langage écrit vers celui du dessin. Dès lors, avant de s’intéresser au phénomène de transposition spécifique au neuvième art, il n’est peut-être pas inutile de faire un détour par celui de l’illustration, qui a concrétisé le premier ce rapprochement entre la littérature et l’image.
En apprendre plusalbum
Lorsque, dans les années 1830, les tout premiers albums de bande dessinée commencent à circuler, le mot « album » recouvre des significations multiples et renvoie à des objets variés.
Par son étymologie, l’album renvoie à la surface blanchie à la chaux pour servir de support à une inscription. Il entre dans la langue française, semble-t-il, par l’intermédiaire du haut-allemand, par la périphrase de l’album amicorum, dans lequel les jeunes personnes rassemblent des sentences manuscrites, des autographes des visiteurs de passage. Par extension sémantique, le terme en vient enfin à désigner tout recueil de feuillets constituant une collection, en particulier d’estampes.
Quand Töpffer s’empare du support de l’album pour publier ses premiers récits, il se situe à la croisée de ces différentes significations. Si le sens archéologique de l’album de Pompéi paraît bien loin, son geste se situe à mi-chemin entre recueil privé et livre publié (un recueil qu’il a longtemps rechigné à publier par crainte du qu’en-dira-t-on, et un livre sur lequel les interventions éditoriales extérieures sont réduites, presque à la frontière de l’auto-édition).
Le succès de ce premier album, Histoire de Mr Jabot, est immédiat. La forme narrative inédite est abondamment reprise, piratée (en France, en Allemagne, et même aux États-Unis, où Mr Vieux-Bois sera publié sous le titre The Adventures of Mr Obadiah Oldbuck), copiée par des successeurs, dont le plus connu est le Français Cham ; le support lui-même, l’album, rencontre un assentiment immédiat. Le format choisi par Töpffer, « à l’italienne », marque profondément la production séquentielle tout au long du XIXe siècle ; ainsi naît « un objet culturel voué à une longue vie : l’album de bande dessinée » (Filliot : 2011).
amour
Quand on demanda à Yslaire les raisons du succès de Sambre, il répondit : « Il y a eu peu d’histoires d’amour racontées en bande dessinée. Sambre était pratiquement la première. (…) Ce n’est toujours pas un genre très visité. » (La Légende des Sambre, Glénat, 2003, p. 94).
Cette réponse est à la fois vraie et fausse. Vraie car, sauf sous la forme des romance comics et, plus récemment, des shôjo mangas, la bande dessinée n’a justement pas érigé la catégorie des « histoires d’amour » en genre, à côté du récit historique, fantastique, policier ou de super-héros. Vraie aussi pour la simple raison que, dans l’espace francophone, la production s’est longtemps adressée prioritairement à l’enfance et que la sous-représentation des personnages féminins y était de règle. On ne peut, par ailleurs, qu’être frappé par le nombre d’ouvrages (essais ou « beaux livres » à l’imagerie racoleuse) consacrés à l’érotisme dans la bande dessinée (c’est alors la production moderne pour adultes qui est concernée), alors que le thème de l’amour, lui, n’a guère été étudié en tant que tel.
Yslaire se trompe pourtant, dans la mesure où, depuis un quart de siècle, l’amour tient une place de plus en plus importante dans les fictions dessinées. Il est, par exemple, le thème obsessionnel d’un Bastien Vivès, depuis les albums qui l’ont révélé, Le Goût du chlore (2008) et Dans mes yeux (2009). Mais on n’aura garde d’oublier que Töpffer déjà, dans l’histoire des Amours de Mr Vieux Bois (1837), s’était attaché à peindre un coup de foudre et une passion aveugle. Le héros, longiligne et sec comme son nom l’indique, s’enflammait pour une inconnue rencontrée à la promenade. Pour les beaux yeux de « l’Objet aimé » (qui restera anonyme et muette), il se métamorphosait en une caricature d’amoureux transi, passant de la plus grande exaltation au plus profond désespoir. Quelques décennies plus tard, le Sapeur Camember de Christophe courtisait et finissait par épouser la bonne et cuisinière du colonel, Mam’selle Victoire, ce « soleil resplendissant de toutes les vertus domestiques ».
animation [cinéma d’]
« Bande dessinée » et « cinéma d’animation » se croisent, convergent et divergent depuis longtemps, au moins depuis la naissance de ces deux termes dans les années 1950 ou sous des intitulés antérieurs qui leur correspondent en partie. Plus spécifiquement, la définition du cinéma d’animation renvoie à un processus de composition de mouvement visuel dépendant d’une succession de phases calculées antérieurement à sa réalisation et à son enregistrement image par image. Ce procédé, qui repose sur un incessant aller-retour entre fixité et cinétisme, à la base de tout le principe cinématographique, explique son obligatoire dialogue avec la bande dessinée, dont la fixité est le critère commun.
À la condition de ne pas réduire le terme de cinéma d’animation à celui de dessin animé, qui est le principal médium déclencheur du cinéma image par image, et de comprendre que le dessin animé n’est plus un dessin mais, pour paraphraser Deleuze, un dessin-mouvement, il est possible d’affirmer que, depuis leur naissance, les deux champs artistiques produisent des effets de « remédiation », autrement dit d’interaction et de rétroaction, entre les techniques graphiques qui leur sont communes. Aussi aborderons-nous cette question plutôt du point de vue de ces allers et retours que d’une stricte généalogie historique ou que d’une rhétorique didactique.
animaux
Les littératures dessinées font trois utilisations des personnages d’animaux. La première catégorie, la plus nombreuse, est celle des animaux anthropomorphes, tels Krazy Kat, Mickey ou Pif le chien. Les caractères généraux de ces êtres sont la bipédie, la présence de mains ou à tout le moins le caractère préhensile des membres supérieurs, la présence d’expressions faciales, le don de la parole, les conduites humaines, parfois mélangées à des conduites animales. En principe, l’animal adopte un costume humain plus ou moins complet, même s’il n’arbore le cas échéant que les oripeaux de la respectabilité bourgeoise (Yogi Bear porte col dur, cravate et canotier, mais rien d’autre). Cependant les exceptions sont nombreuses (Krazy Kat, Félix le chat, Gai-Luron sont nus).
En apprendre plusauteur
L’usage de la notion d’auteur présente plus de difficultés dans le champ de la bande dessinée que dans celui de la littérature. La première difficulté tient au fait que la bande dessinée relève indissociablement des arts du livre et du récit (d’aucuns la nomment « littérature dessinée »), d’une part, et des arts visuels, d’autre part. Désigner les créateurs de bandes dessinées comme auteurs revient à mettre l’accent sur la dimension littéraire du média ; les qualifier d’artistes a l’effet inverse, celui d’exhausser sa dimension plastique.
Quoiqu’il n’ait jamais dissimulé son peu de goût pour la bande dessinée, Bernard Pivot invita naguère près d’une quinzaine de créateurs à participer à son émission Apostrophes – Hergé, Goscinny, Bilal, Bretécher, Tardi, mais aussi les moins attendus Boilet, Mandryka ou Montellier –, leur reconnaissant ainsi, implicitement, le rang d’auteurs.
autobiographie
« Lorsqu’on m’a proposé pour la première fois de faire un récit de 44 planches, j’avais en tête que les premiers romans étaient souvent autobiographiques : alors, pourquoi ne pas faire de même ? En me décrivant dans quatre âges de la vie, je pensais pouvoir faire le tour de mon autobiographie. Je me suis ainsi mis en scène à six ans, à quatorze ans, à trente-cinq ou trente-huit ans et puis à quatre-vingts ans, avec quatre personnages qui vivent ensemble, se parlent et se croisent. (...) Plus tard, j’ai découvert que l’autobiographie était quelque chose de relativement neuf en bande dessinée et que j’étais un des pionniers en France. » (Sohet, 2001 : 39) Ainsi parle Edmond Baudoin de son album Passe le temps (1982). Ses propos sont le fait d’un auteur ayant lu très peu de bandes dessinées avant d’en faire, et ignorant que les dessinateurs, en effet, n’avaient pas coutume de s’aventurer dans les territoires du Moi, de l’intime, contrairement aux écrivains.
En apprendre plusautoreprésentation
La pratique de l’autoportrait traverse toute l’histoire de la peinture, et nombre de peintres ont choisi de se représenter face à leur chevalet, dans l’exercice de leur art.
Pour le créateur de bandes dessinées, le topos analogue consiste à se représenter devant sa table à dessin. À la fois accessoire et élément de décor, la table à dessin apparaît comme l’attribut qui résume un lieu (l’atelier), une profession, une activité, un sacerdoce. Une variante que l’on rencontre quelquefois (d’Hergé à Chris Ware) est celle du dessinateur enchaîné à sa table, boulet au pied, tel un forçat voué, sa vie entière, à aligner des petits dessins comme d’autres cassaient des cailloux.
avant-garde
La bande dessinée n’a pas épousé le mouvement des avant-gardes dont la succession a écrit l’histoire du modernisme en art. On ne trouvera pas d’équivalent au futurisme, au constructivisme, au suprématisme, au dadaïsme dans les bandes dessinées qui paraissaient à l’époque où ces mouvements s’exprimaient sur la scène artistique. Rien d’étonnant à cela, puisque la bande dessinée, après avoir été, au XIXe siècle, une variante de la caricature, était devenue, pour l’essentiel, une littérature pour enfants (en Europe) et un divertissement de masse (aux États-Unis), en tout cas un phénomène complètement étranger au monde de l’art officiel, celui des salons, des musées, des galeries.
En apprendre plusaventure
Indissociable de toute littérature d’évasion, la notion d’aventure semble être au cœur de l’imaginaire de la bande dessinée. En témoigne l’omniprésence de cet intitulé générique : « Les aventures de… » Elle n’a, en soi, rien de spécifique : les lecteurs se délectaient naguère des Aventures de Joseph Rouletabille (Gaston Leroux), des Aventures d’un gamin de Paris (Louis Boussenard) ou des Aventures extraordinaires d’Arsène Lupin (Maurice Leblanc).
La formule renvoie à l’idée de série, avec un héros récurrent appelé à revenir pour vivre d’autres aventures. (Souvenons-nous que les newspaper strips n’avaient pas de fin programmée ; les épisodes devaient s’enchaîner pour assurer une présence continue du héros dans le journal ; il en ira de même des séries franco-belges dans nos « illustrés ».)
Elle met en exergue la centralité du héros, soumis à une suite d’épreuves dont il est (en principe) destiné à triompher par autant d’exploits, mais elle est aussi promesse d’un certain type de récit privilégiant la logique de l’action, les rebondissements, le rythme, le suspense.
Le récit d’aventures se caractérise enfin par des affrontements axiologiques : le héros, chevalier du Bien, affronte les forces du Mal, véritable hydre dont les têtes peuvent se renouveler d’épisode en épisode, même si certains « méchants » plus réussis que d’autres peuvent accéder au rang d’adversaire attitré.
b

bédéphilie
« Bédéphiles » est le terme généralement employé pour désigner les personnes s’affirmant comme des amateurs de bandes dessinées. À plusieurs, ils cultivent « le goût de la bande dessinée » et développent des formes de sociabilité singulières. Ils forgent ensemble un ensemble de pratiques et de représentations, une culture où l’expérience individuelle et intime se conjugue à des actes collectifs et publics. Cette culture émerge en France à l’aube des années 1960. Elle a ensuite évolué au fil des générations d’amateurs et des transformations médiatiques, politiques et sociales du paysage culturel français. Devenue suffisamment visible et vivante, elle s’est vu attribuer un nom : « la bédéphilie ».
Les amateurs de bandes dessinées se caractérisent déjà par le fait d’être des lecteurs de bandes dessinées. Toutes sortes de lecteurs : flâneur ou spécialiste, insatiable collectionneur ou esthète sélectif. Ils ne sont pas seulement des consommateurs qui achètent des albums, des périodiques, voire des produits dérivés. Par leurs discours et leurs pratiques, ils participent à l’interprétation et à l’évaluation des créations en bande dessinée. Ils prennent part au développement et aux transformations du domaine de la bande dessinée et à sa montée en visibilité dans le champ culturel. Acteurs, certains le sont aussi par leur investissement dans la production et la diffusion.
blog
Strictement parlant, un blog (ou blogue pour les Québécois) est un site personnel hébergé par une plateforme de blogging (Blogspot, Wordpress, Myspace, Canalblog…) et mis à jour régulièrement par un ou plusieurs utilisateurs. Les plateformes mettent gratuitement à disposition une adresse et une interface de gestion qui, dans sa version simple, ne requiert pas de compétences techniques particulières. Elles permettent de mettre en ligne instantanément ou de manière différée des contenus multimédias. La plupart du temps, un blog se présente comme une suite de billets (ou notes) publiés dans un ordre antéchronologique (le billet le plus récent apparaît en premier) et parfois accompagnés d’une section « Commentaires » qui permet aux visiteurs de faire part de leurs remarques. Tout aussi fréquemment, une colonne de liens renvoie à d’autres sites choisis par le blogueur. Certains blogs sont agrémentés d’animations, de jeux, de webradios, de compteurs de visites ou de boutiques. La plupart des hébergeurs imposent de la publicité, mais certains blogueurs choisissent de devenir propriétaires de leur adresse afin d’éviter ces inconvénients, ou, s’ils acceptent au contraire de diffuser des annonces commerciales, de le faire moyennant une rémunération.
Le référencement des blogs fait généralement appel à des catégories thématiques ou génériques : cuisine, droit, journal intime, littérature, gay/lesbien, cinéma, humour… Les blogs BD constituent l’une de ces catégories, qui rassemble des blogs ou des sites d’auteurs ou d’amateurs publiant seuls ou collectivement.
c

canon
L’ensemble des classiques de la littérature forme ce qu’il est convenu d’appeler le canon littéraire, et le plus large consensus règne quant à la composition de ce répertoire des œuvres qu’il « faut » connaître et, si possible, avoir lu.
Le recul du temps est nécessaire à la constitution du canon. Les œuvres célébrées au moment de leur publication (celles, par exemple qui reçoivent un prix littéraire important) n’y rentreront pas nécessairement. Il suffit de considérer la liste des lauréats du Goncourt pour être éclairé là-dessus.
À l’école, l’un des buts des cours de français était naguère d’initier les enfants à ce canon à travers l’étude d’extraits choisis, de les familiariser avec ce qui a été écrit de meilleur – et, ce faisant, de leur inculquer des notions de valeur et de hiérarchie entre les œuvres. Mais aujourd’hui les enseignants doivent reconnaître qu’ils n’ont plus guère la possibilité de remplir cet office. L’émiettement de la culture, l’effondrement de la transmission, le remplacement du mérite littéraire par le conformisme idéologique ont porté de sérieux coups à la notion de canon. Elle est, par ailleurs, de plus en plus mise en cause dans son fondement même. L’heure est à l’abolition des hiérarchies. L’idée que certains textes seraient « fondateurs » ou « classiques » est remise en cause. La déconstruction du canon est à l’ordre du jour.
classique
On appelle « classique » un livre qui a su surmonter « l’épreuve du temps » et conserver une forme d’actualité pour des lecteurs, critiques, chercheurs ou auteurs de notre époque. Un ouvrage qui, dépassant son contexte de production, se serait émancipé des conditions dans laquelle il a été conçu et diffusé, peut-être parce qu’il a su, comme l’écrivait Charles Baudelaire dans Le Peintre de la vie moderne, « dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, […] tirer l’éternel du transitoire ». Relevant d’une temporalité longue, cette notion de « classique » semble n’avoir rien d’évident dans le champ d’une bande dessinée qui a longtemps semblé quelque peu oublieuse de son riche passé et que Thierry Groensteen n’hésitait pas à qualifier, dans son essai Un Objet culturel non identifié, daté de 2006, « d’art sans mémoire » n’ayant « pas grand souci de son patrimoine » (2006 : 67).
En apprendre pluscollection
Les collections de bande dessinée apparaissent presque en même temps que les œuvres de Rodolphe Töpffer : en 1847, alors que l’éditeur Aubert publie son douzième album de bande dessinée, il inclut rétrospectivement l’ensemble des titres de bande dessinée publiés par sa maison dans une « collection des Jabots », renforçant la filiation töpfferienne que l’éditeur cherche alors à construire. Le moment Töpffer correspond, chronologiquement, au mouvement d’industrialisation et de rationalisation de la production et de l’offre touchant l’ensemble de la chaîne du livre. Le regroupement des publications en collections de format, de présentation et de prix uniques constitue en effet l’un des phénomènes majeurs qui transforme l’édition au XIXe siècle. Pourtant, ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que le principe de la collection commence réellement à s’imposer dans le domaine de la bande dessinée. Dès lors, l’histoire de la tardive adoption du principe de collection éclaire la position singulière qu’occupe la bande dessinée dans l’espace éditorial franco-belge.
En apprendre pluscomic book
Aux États-Unis, l’appellation « comic book » est traditionnellement utilisée pour désigner le format des bandes dessinées là où, dans les autres pays, elle renvoie à la production américaine en général. Même s’il est généralement associé aux seuls super-héros de DC et Marvel, le comic book couvre en réalité un spectre de créations beaucoup plus large, reflet d’une industrie qui, depuis son émergence, s’est distingué de ses homologues français ou japonais en créant ses propres codes.
En apprendre pluscontre-culture
« Archie et Jughead n’ont jamais embrassé Veronica et Betty. Superman n’a jamais embrassé Loïs Lane. Nous en avons assez de cette philosophie de bande dessinée. » (Roszak : 62-63). Ainsi s’exprime le leader révolutionnaire afro-américain Bobby Seale, cofondateur du Black Panther Party, au cours d’un meeting à l’université de Berkeley en 1968.
Le pavillon coquet à l’herbe toujours impeccablement tondue dans lequel vit Archie, où son père exerce une autorité bonhomme tandis que sa mère s’acquitte au mieux des tâches ménagères, apparaît, pour une frange de la jeunesse en révolte, comme l’expression d’une aliénation. Cette famille « modèle » est l’antithèse des communautés prônant l’amour libre, émancipé de l’institution du mariage, qui fleurissent alors sur le territoire états-unien. Quant au patriotisme conquérant de Superman, il se situe en décalage complet avec les innombrables manifestations qui réclament la fin de guerre au Viêt Nam.
corps
Du corps humain, la caricature et la bande dessinée ont proposé des représentations très hétérogènes : « bonhommes en fil de fer », dont la tradition enjambe les siècles (du Français Grandville à l’Espagnol Calpurnio), « bonhommes patate » de Martin Vidberg et, occasionnellement, Lewis Trondheim, Chris Ware ou Ivan Brunetti, corps stylisés, « en caoutchouc », des héros de cartoons, figurations académiques des maîtres du réalisme (Raymond, Foster, Cuvelier, Buzzelli…).
En apprendre pluscouleur
Après une assez longue période protohistorique (de Töpffer à Christophe), la bande dessinée annonce la couleur lorsqu’elle atteint un large public grâce à la grande presse américaine, qui trouvait là le support idéal pour mettre en valeur l’usage de la quadrichromie. C’est en effet communément l’apparition du Yellow Kid qui marque la naissance de la bande dessinée comme culture de masse : ce sera d’ailleurs en souvenir de ce gamin dessiné par Outcault, ainsi nommé pour le coloris de sa tunique, qu’on appellera la presse à sensation « yellow press », tant la guerre des tirages entre Hearst et Pulitzer se joua en couleurs (la palette Art Nouveau de Winsor McCay, les couleurs tranchées et arbitraires d’Herriman, l’expressionnisme coloré de Frank O. King, les teintes « pétantes » de Cliff Sterrett…).
Depuis lors, et pour toujours, la bande dessinée se partage entre des œuvres en noir et blanc et d’autres en couleurs, les proportions et surtout la connotation de l’une et l’autre pratiques variant selon les époques. Ainsi, d’abord réservée aux planches dominicales, la couleur était un luxe mais devint vite, pour les éditeurs, synonyme d’attrait commercial supplémentaire. C’est ainsi qu’après la guerre, les premiers Tintin ont été refaits pour la couleur, laquelle étend rapidement son hégémonie : en 1985, Thierry Groensteen remarquait que « dans le contexte de l’édition française où trois albums sur quatre sont en couleurs, la collection des "Romans (À Suivre)", la collection "BD noire" de chez Glénat ainsi que les albums des éditions Audie et Futuropolis sont les derniers îlots de résistance à l’impérialisme de la quadrichromie. » Cette logique conduit les éditeurs à demander à Mœbius de colorer son Cauchemar blanc et son Major Fatal, ou à dénaturer nombre d’œuvres conçues pour le noir et blanc, de Will Eisner à Hugo Pratt. Sous couvert d’efficacité commerciale, on aboutissait à des contresens stylistiques : en effet, créer pour la couleur implique des préoccupations esthétiques particulières, les rapports de tons, les harmonies colorées, les symboliques chromatiques devant s’insérer dans les valeurs de noir et de blanc, voire les supplanter.
À la fin du siècle dernier, un rééquilibrage s’est opéré. Si (À Suivre) et Futuropolis, champions du noir et blanc des années 1980, ont disparu, ils ont donné naissance à une génération entière de dessinateurs nourris de Pratt, Muñoz, Altan, Forest et Tardi, pour qui la couleur ne saurait être un modèle absolu. L’Association et à sa suite Casterman, les Humanoïdes associés, Le Seuil… publient alors quantité de bandes dessinées en noir et blanc, tandis qu’on réédite luxueusement la version sans couleurs du Garage hermétique. Dans les deux décennies suivantes, la vogue du « roman graphique » et la grande popularité des mangas accordent désormais toute sa place à une bande dessinée en noir et blanc et font corollairement de la couleur un choix.
critique
La critique de bande dessinée s’est développée beaucoup plus tard que le médium lui-même. Pendant des décennies, les bandes dessinées ont été produites, ont circulé, ont été lues par des millions de lecteurs, sans donner lieu à aucune appréciation, aucun jugement, aucune médiation. Sauf, naturellement, les critiques adressées à la BD en tant que telle par les éducateurs, longtemps hostiles, par principe, à cette « sous-littérature » accusée de tous les vices (Morgan, 2003, livre deux).
Pour un regard plus sérieux et plus ouvert, il faut attendre les prémices du mouvement bédéphile. En France : quelques articles épars, de Robert Champigny (sur Pogo, dans Critique en février 1957), d’Edgar Morin (« Tintin, le héros d’une génération », La Nef No.13, 1958), de Robert Benayoun ou de Claude Beylie (qui fut le premier à utiliser le terme de « neuvième art », dans Lettres et médecins, en mars 1964), notamment, sans oublier les premiers essais en librairie : Le Petit Monde de Pif le chien (1955), de Barthélemy Amengual, Le Monde de Tintin (1959), de Pol Vandromme, Bande dessinée et culture (1966), d’Evelyne Sullerot – mince volume dont j’ai pu écrire qu’il marquait peut-être la naissance d’une théorie esthétique de la bande dessinée. Tout cela est aujourd’hui bien connu.
d

dessin vivant
Mademoiselle Jeanne ne touche plus terre. Dans un état d’excitation extrême, qui semble provoquer une légère lévitation, elle dévore des yeux le dessin que Gaston est en train de graver au canif sur un marronnier. Les premiers signes apparaissent sur l’écorce : ce sont les initiales de Gaston et de Jeanne et il semble que Gaston entame le dessin d’un cœur les enserrant… Dans un état d’excitation croissante, Mademoiselle Jeanne regarde le dessin qui advient, elle minaude, elle sautille… avant de déchanter dans la dernière case du strip. Le dessin est fini et il n’est pas du tout conforme à ses espoirs : ce qui aurait pu devenir un cœur entourant les initiales des deux amoureux est finalement le portrait grossier d’un bonhomme aux yeux bigleux et aux oreilles décollées.
Dans ces six cases de Franquin, on peut reconnaître toutes les composantes de l’expérience du dessin vivant. Mais avant d’aller plus loin, il convient de définir cette notion.
dialogue
La notion de dialogue désigne la forme la plus naturelle de la parole lorsqu’elle tend à devenir échange. Il s’agit donc d’une modalité énonciative prenant la forme d’une interaction, qui se caractérise par l’alternance des tours de parole, chaque énonciateur devenant tour à tour locuteur puis allocutaire. Une confusion entre le sens du préfixe dia- (à travers) et celui du préfixe di- (deux) peut conduire à envisager le dialogue comme un échange entre deux locuteurs seulement ; or ce préfixe ne fait qu’indiquer l’idée d’une parole « qui circule », qui s’échange entre plusieurs locuteurs, dont le nombre ne saurait être restreint à deux. Ce glissement vient de ce que la communication en tant qu’acte est généralement envisagée suivant le schéma prototypique d’un « tête-à-tête », bien que ce prototype ne corresponde en rien aux expériences énonciatives les plus fréquentes.
En apprendre plusdocumentation
Le réalisme documentaire est, en principe, de rigueur dans les bandes dessinées fondées sur une reconstitution historique. Mais les dessinateurs, qui n’ont pas vocation à usurper la qualité d’historiens, sont en droit de suppléer à une documentation insuffisante par une part d’intuition, voire de s’accorder la licence poétique de « réinventer » de toutes pièces Carthage, Babylone ou Alésia. Nombre de séries d’aventures ont simplement un cadre historique, mais ne se veulent pas didactiques. Parfois elles ne recherchent même pas une crédibilité de façade, se donnant sans fausse pudeur pour ce qu’elles sont, des œuvres de fantaisie et de divertissement.
En apprendre pluse

encrage
Dans le processus traditionnel d’élaboration d’une bande dessinée, l’étape de l’encrage suit celle des crayonnés. Le dessin a été réalisé au crayon sur la planche originale, et vient le moment où le dessinateur estime pouvoir le fixer, le mettre au net, lui donner son aspect définitif et propre à la reproduction. Il s’agit alors de se relire, de repasser sur ses propres traces. En ce sens l’encrage est aussi ancrage, puisque l’image s’y installe dans un état définitif (que viendra encore compléter, le cas échéant, la couleur).
En apprendre plusenfance
« Que la bande dessinée entretienne, même adulte, des liens privilégiés avec l’enfance, est une réalité qui non seulement n’est pas négative, mais est constitutive des potentialités poétiques de ce langage, et aussi de sa position culturelle. » Avec ces quelques lignes tirées de La Bande dessinée et son double (p. 17), Menu reprend à son compte une idée souvent ressassée mais jamais dépliée dans toutes ses composantes et implications. Ce sont donc les liens privilégiés du médium bande dessinée avec l’enfance que cet article se propose d’explorer.
En apprendre plusenseignement (1) : enseigner avec la bande dessinée
L’histoire des liens entre bande dessinée et éducation s’est exprimée successivement dans les termes d’une hostilité farouche, d’une intégration résignée, puis d’une récupération intéressée et d’une légitimation affichée.
En apprendre plusenseignement (2) : enseigner la bande dessinée
Lorsqu’en 1983 s’ouvrit le premier atelier de bande dessinée au sein d’une école d’art en France, à Angoulême, des critiques s’élevèrent du milieu professionnel. Elles venaient d’auteurs majoritairement autodidactes, qui craignaient que cette reconnaissance institutionnelle n’enferme la bande dessinée dans l’académisme et l’élitisme. Pourtant, les formations spécifiques à la bande dessinée existaient déjà hors de France (notamment en Argentine, aux USA et en Belgique) et avaient précisément démontré le contraire : par la confrontation entre la bande dessinée et d’autres pratiques artistiques, et la possibilité donnée aux auteurs chevronnés et débutants de travailler ensemble, en marge des contraintes de production éditoriales, des formes nouvelles émergeaient, toutes aussi passionnantes et audacieuses que celles qui naissaient dans les pages des meilleurs magazines. L’enseignement de la bande dessinée, comme tout enseignement artistique, est le fruit d’apports réciproques : si cet enseignement a évidemment suivi l’évolution du métier d’auteur, il a également contribué à le faire évoluer.
En apprendre plusérotisme et pornographie
Dans sa bande dessinée autobiographique Blankets, Craig Thompson raconte comment la vision d’un portrait de Jésus dans la chambre de sa petite amie Raina lui rappelle un épisode de son enfance : ses parents l’ont réprimandé pour avoir dessiné « une dame sans aucun vêtement sur elle » ("a lady without any clothes on"). Des années plus tard, alors que Craig envisage d’entreprendre des études d’art, un membre de sa paroisse le met en garde : son frère a dû dessiner d’après modèle vivant en école d’art, ce qui l’a rendu dépendant de la pornographie et par conséquent ("the next logical step") homosexuel. Le milieu très puritain dans lequel grandit le jeune Craig est rongé par ce qu’Irène Le Roy Ladurie nomme une « obsession iconophobe » (Le Roy Ladurie, 2016), et ce, paradoxalement, en raison de l’extraordinaire puissance d’incarnation que recèlent les images dans la pensée orthodoxe. Il faut croire que cette puissance d’incarnation se fait sentir en dehors du récit de Thompson puisqu’une habitante de la ville de Marshall, dans le Missouri, a demandé en 2006 que deux ouvrages « pornographiques » fussent retirés de la bibliothèque publique de la ville : Fun Home d’Alison Bechdel et Blankets. L’anecdote rapportée dans Blankets postule au moins deux choses : premièrement, que la représentation de la nudité d’une femme est constitutive de la pornographie ; deuxièmement, que des images dessinées possèdent un pouvoir d’incarnation suffisamment fort pour susciter un désir sexuel (ce que semble confirmer l’affaire de 2006).
En apprendre plusesclavage
Il faudrait plutôt évoquer « les esclavages », car le phénomène de la servitude existe en bien des lieux et bien des époques, tout en revêtant des formes quelque peu différentes. Dans l’Antiquité, les maîtres et les esclaves ne se distinguaient pas forcément par l’apparence physique, et l’on sait qu’à Rome des affranchis pouvaient parfois accéder à de très hautes charges. En revanche, la traite négrière atlantique et l’esclavage colonial se sont développés à partir du XVIe siècle sur fond de racisme. Les partisans du travail forcé soutenaient que les Africains étaient par nature destinés à être asservis, convoquant même parfois la Bible, avec le fameux « mythe de Cham », selon lequel Noé aurait voué les Noirs, par sa malédiction, à servir les autres « races ». Même s’il réussit à obtenir son affranchissement, un ancien esclave reste par conséquent, en Amérique, dans une position sociale inférieure, liée à la couleur de son épiderme et entérinée par un ensemble de règlements ségrégationnistes. Le poison du racisme se maintiendra bien après les abolitions successives de l’esclavage prononcées par les diverses nations occidentales au long du XIXe siècle. Enfin, de nos jours, il existe encore des formes d’esclavage, sur bien des continents : traite des femmes, vente d’enfants, travail forcé et non rémunéré de domestiques…
En apprendre plusexposition
Aujourd’hui installées dans l’agenda culturel, les expositions de bande dessinée semblent ne plus susciter de débat d’opportunité. Chaque année, plusieurs grandes expositions sont organisées dans des institutions culturelles prestigieuses, de la BNF au MAC de Lyon, en passant par la Cité de l’Architecture ou la Fondation Cartier. Une telle présence dans le paysage culturel français est relativement neuve, l’histoire des expositions de bande dessinée étant liée aux progrès de sa reconnaissance comme forme artistique.
En apprendre plusf

fantasy
L’ambiguïté, pour ne pas dire le caractère précaire, de la catégorie littéraire de la fantasy est bien manifestée dans le fait qu’on ait conservé pour la désigner un terme anglais, qui présente, de surcroît, toutes les apparences d’un faux ami. Sa traduction littérale, fantaisie, a, en français, des connotations de légèreté et de caprice qui sont aux antipodes d’un genre qui donne au contraire la prééminence à la convention assumée et à la cohérence de l’univers fictionnel. Quant au néologisme de fantasie, recommandé par l’Académie et adopté par la commission générale de terminologie et de néologie (JO du 23 décembre 2007), il ne s’est jamais imposé. Par comparaison, les catégories limitrophes – merveilleux, fantastique – ont, elles, des désignations françaises traditionnelles, tandis que l’expression anglophone de science fiction a été francisée par le simple expédient d’un tiret (science-fiction).
Si on la réduit à son noyau thématique, la présence d’un ou plusieurs éléments relevant de mondes imaginaires, on pourrait dire que la fantasy est consubstantielle à la bande dessinée, quand bien même ces éléments trouvent leur source, le cas échéant, dans les littératures écrites. On pense à des personnages longtemps considérés, au moins en France, comme emblématiques de la bande dessinée, comme Tarzan, à des genres comme celui des séries à animaux anthropomorphes (funny animals) ou celui des super-héros, à des procédés habituels dans les récits dessinés (le monde fictionnel fait de bric et de broc et aux lois invraisemblables, l’invention fabuleuse comme ressort narratif), voire à des conventions romanesques, présentes dans des séries qui ne se posent cependant pas comme dérogeant aux lois du monde ordinaire (par exemple le fait que, dans l’univers fictionnel, personne, en réalité, ne travaille). Si l’on annexe au domaine toute série incluant, à l’intérieur du monde naturel, quelque élément relevant du merveilleux, tel que super-pouvoir ou faculté prodigieuse, ou encore animal doué de raison, on englobera de facto une grande partie des littératures dessinées. Astérix, Tintin ou Lucky Luke relèvent alors de la fantasy. Le risque d’une telle approche est évidemment de diluer la notion même de fantasy jusqu’à sa disparition. On constate ainsi que la recherche à partir du mot clé fantasy sur des catalogues en ligne de manga renvoie à une grande partie de la production, car des éléments tels que les pouvoirs magiques, les êtres fabuleux, le recours à l’allégorie, font partie des invariants de cette littérature.
Inversement, si l’on tient le terme de fantasy pour un synonyme du merveilleux en tant que genre littéraire (telle est la position d’André-François Ruaud, dans son Panorama illustré de la fantasy et du merveilleux), la notion gagne en cohérence et il devient possible de mettre en lumière une émergence de ce genre dans les littératures dessinées, dans l’aire culturelle francophone (contes de fées de l’imagerie Pellerin à Épinal, dès 1840, presse Fayard au début du XXe siècle, La Jeunesse illustrée, 1903, Les Belles Images, 1904), comme dans l’aire anglophone (dans les années 1900, les sunday pages à thème féerique ou onirique émanant de ce que Pierre Couperie avait baptisé l’École du New York Herald). La féerie ne disparaîtra jamais des littératures dessinées, ni dans les newspaper comics (The Pussycat Princess, 1935, de Grace Drayton), ni dans les illustrés français pour la jeunesse (Le Chevalier Printemps, de Jean Trubert, 1948).
fanzine
On le sait, le terme fanzine est la contraction de l’appellation en langue anglaise « Fanatic Magazine », qui désigne des petites revues périodiques écrites et imprimées par des amateurs sur leur domaine de prédilection.
Historiquement, les premiers fanzines ‒ et le terme qui les désigne ‒ sont apparus aux États-Unis dans les années 30, et notamment dans le milieu de la Science-Fiction (The Comet, en 1930). Ils permettaient à de jeunes passionnés de parler de leurs auteurs préférés et de publier leurs premières nouvelles.
Par principe, tout ce qui touche au fanzine est bénévole. La vente du fanzine n’a pour but que de permettre de financer l’impression et de garantir la parution d’un nouveau numéro.
Les premiers fanzines consacrés à la bande dessinée vont apparaître durant la seconde moitié du XXe siècle dans la plupart des pays développés, mais surtout dans les pays où la production de bandes dessinées est suffisamment importante pour être commentée. Il ne sera question ici que des fanzines de bande dessinée francophones.
femme (1) : représentation de la femme
La bande dessinée a longtemps été produite majoritairement par des hommes pour des jeunes lecteurs eux aussi masculins.
Il existait cependant une bande dessinée « pour les filles », qui, dans l’espace francophone, s’est exprimée dans toute une série de magazines spécialisés (La Semaine de Suzette, Fillette, Lisette, Mireille, Ames Vaillantes, Bernadette, Line…) ; il y eut aussi, dans les années cinquante, une bande dessinée « sentimentale », dont les fleurons étaient, d’une part, les séries quotidiennes publiées par France Soir, comme 13 rue de l’espoir, et, d’autre part, les « romans dessinés » qui précédèrent les romans-photos dans la presse du cœur). La vérité est que les bandes dessinées sentimentales n’étaient certainement pas lues que par des femmes. Jan Baetens a même montré que certaines thématiques récurrentes des « romans dessinés », comme la vitesse ou la technologie, étaient clairement destinées à intéresser un lectorat masculin.
Dans le même temps, les périodiques de bande dessinée supposés s’adresser à tous les publics – les Tintin, Spirou, Pif, Vaillant, Pilote où, selon les spécialistes, se sont écrites les grandes pages de l’histoire du média ─ déclinaient surtout l’aventure au masculin et ciblaient de façon plus ou moins consciente un public de garçons. Ainsi l’Oncle Paul, figure emblématique de Spirou, s’adressait-il à ses seuls « neveux ». Il a été remarqué que, dans Astérix, « les femmes sont absentes du premier album. Il faut attendre Le Devin en 1972 pour qu’elles aient le droit de goûter à la potion magique, et Le Cadeau de César en 1974 pour qu’elles prennent place au banquet final. » (Lipani Vaissade : 72) Le château de Moulinsart est l’exemple type d’un microcosme composé exclusivement d’hommes. Haddock, Tournesol, Tintin et Nestor y vivent en phalanstère. On ignore même s’il y a une bonne ou une cuisinière au château. De même, le village des Schtroumpfs est une communauté masculine. Aussi, quand le féminin (en la personne de la Castafiore ou de la Schtroumpfette) pénètre en de tels lieux, c’est sur un mode nécessairement perturbateur, fauteur de troubles.
On se souvient peut-être que la Schtroumpfette est une invention du méchant sorcier Gargamel, créée à dessein pour déstabiliser le monde harmonieux des Schtroumpfs − même si c’est au Grand Schtroumpf qu’elle devra d’être transformée en blonde fatale. Rappelons ici la sidérante « recette » de Gargamel : « Un brin de coquetterie, une solide couche de parti-pris, trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, de la poudre de langue de vipère, un carat de rouerie, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge, cousu de fil blanc, bien sûr, un boisseau de gourmandise, un quarteron de mauvaise foi, un dé d’inconscience, un trait d’orgueil, une pointe d’envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d’esprit volatil et beaucoup d’obstination, une chandelle brûlée par les deux bouts… » (Peyo, La Schtroumpfette, 1967.)
femme (2) : la création au féminin
Vers 1985, on comptait, en France, environ une dessinatrice de bandes dessinées pour vingt-cinq dessinateurs. Si la parité, en ce domaine, paraît encore lointaine, la proportion d’auteures a triplé en trente ans, pour atteindre au moins 12 % de la profession en 2014, peut-être davantage (les données disponibles à cet égard sont sujettes à caution).
La présence des femmes reste comparativement très faible, par rapport à la position majoritaire qu’elles occupent dans la littérature de jeunesse (environ 66 %). Quant aux « femmes de lettres » (romancières, essayistes), si les statistiques manquent pour évaluer précisément leur nombre, il semble que celui-ci ait considérablement augmenté dès la fin du… XIXe siècle, et que la proportion (environ une écrivaine pour un peu plus de trois écrivains) soit, depuis, restée relativement stable. C’est leur visibilité qui s’est accrue, les Colette, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras et autre Nathalie Sarraute s’étant imposées au premier plan de l’histoire littéraire du XXe siècle.
festival
Dans un communiqué en date du 10 août 2017, la ministre de la Culture se félicitait à juste titre de ce que « les festivals composent aujourd’hui en France un paysage riche et varié qui recouvre l’ensemble du champ culturel : la musique, les arts de la rue, le cirque, le cinéma, le livre, la bande dessinée, les arts visuels, la danse, le théâtre, la marionnette, le conte, l’histoire, l’archéologie ». On en dénombrerait environ 3000 chaque année, sur l’ensemble du territoire.
Les festivals de bande dessinée ne sont ni les moins nombreux ni les moins dynamiques.
feuilleton
On connaît l’origine du roman-feuilleton, c’est-à-dire de l’œuvre littéraire publiée par livraisons dans la presse quotidienne. La formule en a été inventée simultanément par Emile de Girardin et Dutacq, directeurs respectifs de deux journaux nés le même jour (1er juillet 1836) : La Presse et Le Siècle, qui allaient se livrer une concurrence acharnée. Des auteurs populaires comme Soulié, Sue, Féval, Ponson du Terrail publièrent leurs œuvres en feuilleton, mais Sand ou Flaubert firent de même. Balzac publia quelque vingt romans en fragments dans les quotidiens. Dumas découpa son Comte de Monte Cristo en cent-trente-neuf livraisons. Les séries prolongeront, en librairie, cette logique de la fidélisation. À la suite des Trois Mousquetaires viendront Le Vicomte de Bragelonne puis Vingt ans après. D’autres auteurs sauront intensifier la cadence. Souvestre et Allain donnent un bel exemple de fécondité, en signant quelque trente-deux Fantômas entre 1910 et 1914 !
Les romans-feuilletons ont longtemps eu mauvaise presse, les auteurs étant soupçonnés de tirer à la ligne et de flatter les goûts du public. Sainte-Beuve, notamment, s’en prit violemment à eux dans un article intitulé « De la littérature industrielle » (La Revue des deux mondes, 1er septembre 1839). La bande dessinée, qui souffrait déjà d’un certain nombre d’autres handicaps symboliques (Groensteen, 2006), ne gagna sans doute pas en légitimité culturelle en faisant pendant longtemps du feuilleton son mode de publication privilégié. Toutefois, cette collusion entre littérature dessinée et régime feuilletonesque ne se produisit qu’au XXe siècle, de façon progressive. Au XIXe, en dehors de quelques cas relativement isolés (l’Histoire de Mr Cryptogame, de Töpffer et Cham, en livraisons dans L’Illustration, quelques récits de voyage par Cham, dans le Charivari, l’Histoire de Mossieu Réac, de Nadar, dans La Revue nouvelle à l’usage des gens sérieux, les Mésaventures de Mr Bêton, de Léonce Petit, dans Le Hanneton, les Histoires campagnardes, du même, dans Le Journal amusant, le Voyage de Monsieur Blandureau autour du monde, anonyme, dans La Terre illustrée…), le support de référence était l’album. Il le redeviendra à partir des années 1980.
g

gag
La notion de gag n’appartient pas en propre à la bande dessinée. Il y a des gags au cinéma, ils caractérisent même un genre de cinéma, le cinéma burlesque. Il y a des gags à la télévision, pensez aux « vidéo-gags ». Il y a, depuis beaucoup plus longtemps, des gags au théâtre et dans tous les arts vivants qui mettent en scène le corps d’un acteur, le cirque notamment. Si l’on suit l’analyse célèbre du rire par Bergson, le gag n’appartiendrait pas même au seul domaine esthétique. Le premier événement qu’il donne en exemple dans son essai est, on le sait, une scène de rue :
En apprendre plusgalerie
Les galeries spécialisées en bande dessinée connaissent aujourd’hui un développement spectaculaire. Si leur origine remonte aux années 1970, l’ouverture de la plupart d’entre elles est postérieure aux années 2000 et concentrée dans les cinq dernières années.
L’année 2013 aura vu à Paris l’apparition de trois d’entre elles : la galerie Glénat, la galerie Champaka ainsi que la galerie BD Artwork, une galerie virtuelle qui organise des expositions dans des lieux variés. À l’heure actuelle, Paris compte au moins une quinzaine de galeries spécialisées (Martel, Oblique, 9e art, Huberty & Breyne — anciennement Petits Papiers —, Barbier et Mathon, Napoléon, Jean-Marc Thévenet, Daniel Maghen, Anne Barrault, Julien Brugeas, etc.), et il ne faut pas oublier les galeries belges (Petits Papiers, Slomka, Brüsel, Thierry Goossens, etc.) ou suisses. Le milieu, en pleine effervescence, connaît une concurrence importance : les galeries déménagent, se rénovent, s’agrandissent, se spécialisent et innovent pour s’assurer de rester à la pointe du marché. En dépit de leur succès, elles ne sont pourtant pas à l’abri de la faillite : la Gallery, par exemple, fondée à Paris par le montréalais Laurent Imbert, a brutalement fermé en 2011.
génétique (de la bande dessinée)
Même si l’idée d’une exploration de l’ADN de la bande dessinée reste pertinente, il ne s’agit pas de cela ici mais bien d’une transposition d’un concept hérité de la génétique des textes. Cette discipline, née au milieu des années soixante-dix, s’est très vite distinguée d’une exploration linéaire des sources de l’œuvre pour s’intéresser au processus créatif lui-même, depuis le premier mot noté par intuition sur un carnet, à l’œuvre publiée, en passant par tous les moments décisifs où se joue le sort du sens et où l’on aperçoit tout ce que la création ne doit pas à l’inspiration magique. Le travail de l’écriture, en somme, constitué de tous les éléments matériels, psychiques, intellectuels, rationnels ou non, qui sont à la base de l’évolution d’un texte vers telle forme, tel prolongement narratif, tel renoncement ou tel repentir. Aragon, léguant l’ensemble de ses manuscrits au CNRS, qui fut à lui tout seul l’initiateur de la génétique des textes en France, avait décrit en 1976 cette approche des brouillons, des tapuscrits, des carnets comme une nouveauté que des chercheurs comme Louis Hay, Jean-Louis Lebrave, Raymonde Debray-Genette, Almuth Grésillon ou plus récemment Pierre-Marc de Biasi, ont assez rapidement concrétisé par la création et le déploiement des équipes de l’Institut des Textes et Manuscrits modernes. On se fera une idée de la richesse des méthodes d’enquête, de plus en plus adaptées aux arts visuels (photographie, cinéma, peinture), à la musique et à l’architecture, en se rendant sur le site de cette institution ou en lisant les numéros toujours très instructifs de Genesis, d’abord publié chez Jean-Michel Place puis aux Presses universitaires de la Sorbonne. La présence de dessins dans les manuscrits d’auteur et d’autres graphes plus ou moins formés a du reste récemment permis à cette revue de constituer un ensemble d’études passionnantes sur les écritures non-verbales situées aux marges des manuscrits (No.36). En décembre 2016, cette revue a proposé dans sa 43ème livraison un ensemble de textes consacrés à la génétique de la bande dessinée, ouvrant ainsi un territoire très riche à la recherche.
En apprendre plusgenre
Il ne sera pas question ici des grands genres hérités de l’Antiquité grecque (le drame, l’épopée, l’œuvre lyrique), ni de la tragédie, du sonnet, de la fable, de l’élégie..., qui sont les genres généralement évoqués par les théoriciens de la littérature « sérieuse ».
Dans le domaine de la bande dessinée, j’ai cru reconnaître dans le voyage, le merveilleux et la bêtise les trois thématiques dominantes de la production du XIXe siècle, qui était essentiellement satirique (Groensteen 1998 : 16). Avec les débuts du comic strip américain, on voit perdurer le merveilleux, qui trouve son fleuron en Little Nemo in Slumberland, mais de nouveaux genres émergent : le kid strip (ces enfants turbulents que sont les Katzenjammer Kids, Buster Brown ou Bicot, tous héritiers des Max und Moritz de Busch), le family strip (centré sur la vie du couple et l’univers domestique, que celui-ci soit calme et pacifique ou, au contraire, dévasté par la guerre conjugale), le sport strip (la boxe et les courses hippiques sont particulièrement prisées) ou encore le funny animal strip, pour ne citer que ceux-là.
gestuaire
Le premier à s’être intéressé aux postures et aux mouvements des héros de bande dessinée fut le sémiologue et narratologue français Claude Brémond, qui publia dès 1968 un article programmatique : « Pour un gestuaire des bandes dessinées ». Selon Brémond, l’attitude, le geste, la mimique du personnage dessiné forment ensemble un « complexe ». Il pariait sur un lexique très réduit et, en disciple de Propp, préconisait de l’étudier à partir des « signifiés narratifs » (la surprise, la colère, la menace, etc.) à l’intérieur du « seul cadre de référence acceptable » pour lui : l’analyse du récit. Le programme de recherche que ce texte annonçait ne fut malheureusement jamais entrepris.
Brémond se référait à Barthes pour opposer les gestes fonctionnels (ceux signifient la situation, la participation du personnage à l’histoire) aux gestes indiciels (ceux qui caractérisent ce qu’il est) mais la distinction – pas toujours facile à établir – remonte à Aristote. Il soutenait en outre que la bande dessinée privilégie le spectaculaire sur le narratif, le geste qui « fait image » sur celui qui se contente de dénoter.
Je garderai ici la notion de gestuaire pour désigner le répertoire des gestes prêtés à un personnage, mais en modifiant quelque peu la perspective : Brémond voyait les personnages dessinés comme des actants mus par un code, je les vois plutôt, pour ma part, comme des acteurs développant un jeu.
gigantisme
C’est un paradoxe fécond : la bande dessinée, art des petites images enfermées dans un format contraint, a toujours eu recours au gigantisme, c’est-à-dire à la présentation d’objets, d’êtres, de décors démesurés, hors de proportion. On en trouve des exemples dans les histoires comiques, dans les récits oniriques ou fantastiques et, bien entendu, dans la science-fiction.
En apprendre plusguerre
Sous ce terme faussement monolithique se cache une impressionnante diversité (historique, technique, thématique, idéologique) qui a donné lieu à un corpus bibliographique d’une ampleur insondable dans lequel la bande dessinée a décliné le phénomène guerrier sous d’innombrables formes. Toutes les guerres, qu’elles soient antiques, médiévales, modernes, totales, mondiales, froides, coloniales, des gangs, des mondes ou de super-héros, ont été dépeintes sous toutes les approches imaginables : historiques, politiques, pédagogiques, réalistes, fantaisistes, humoristiques, héroïques, propagandistes, antimilitaristes, etc.
S’il fallait se demander pourquoi la guerre est si présente dans la bande dessinée, sans doute faudrait-il alors rappeler qu’en tant que creuset de l’histoire de l’humanité, la guerre fait l’objet d’une constante fascination à laquelle aucun art ni média n’a jamais su résister ni échapper. Pétrie du « caractère essentiel du sacré » (Caillois), la guerre est l’une des rares puissances propres à faire et à défaire des empires et des civilisations. Théâtre de toutes les passions, des plus viles aux plus nobles, et spectacle de toutes les déraisons, la guerre est aussi porteuse de valeurs universelles telles que le patriotisme, l’héroïsme, la fraternité, la virilité, la force, le courage, le sacrifice ou l’esprit d’aventure. Chargée de l’électricité qui galvanise les pulsions de vie et de mort qui œuvrent au cœur de la psyché des hommes, la guerre suscite l’exaltation autant que la répulsion.
Aussi généralistes que peuvent être ces propos préliminaires, ils contribuent déjà à expliquer pourquoi un médium narrativo-visuel comme la bande dessinée a immédiatement cédé au chant des sirènes de la guerre. En second lieu, il convient d’ajouter que la bande dessinée a longtemps été produite conjointement à des organes de presse généraliste et donc pensée comme un média culturel populaire dans lequel le sensationnel y était accueilli avec complaisance. Enfin, il faut se garder d’oublier que la bande dessinée s’est longtemps adressée en priorité à un lectorat juvénile et masculin volontiers attiré par l’aventure, l’action et les faits d’armes. L’addition de tous ces ingrédients aide à comprendre en quoi la guerre constitue l’un des sujets fétiches du neuvième art, un véritable pivot thématique et générique qui l’accompagne depuis ses débuts.
h

héros
Dans l’économie d’un récit dessiné, le héros est d’abord celui-à-qui-il-arrive-quelque-chose.
On ne lui demande pas nécessairement d’être intelligent (le nom d’Annaïk Labornez, dite Bécassine, en dit suffisamment sur ses capacités intellectuelles), honnête (les Pieds Nickelés sont de sympathiques filous) ou beau (la petite taille d’Astérix, la laideur proverbiale de Popeye en témoignent), ni même nécessairement humain (un animal, un robot, un légume – le Concombre masqué de Mandryka – ou… une voiture, telle la Rosalie de Calvo, font aussi bien l’affaire).
histoire
Les liens entre bande dessinée et histoire continuent de faire couler de l'encre... Face à l'importance des évolutions dans le domaine particulièrement dynamique, Neuvième Art a jugé pertinent de mettre à jour et compléter la notice initiale de Philippe Videlier, pour prendre en compte les dernières tendances de la création et de la recherche. La notice initiale, qui garde tout son intérêt, est ainsi complétée d'un addendum signé Margot Renard.
En apprendre plushors-champ
Au cinéma, le terme de hors-champ désigne ce qui n’apparaît pas dans le champ, c’est-à-dire « cette partie de l’espace, théoriquement sans limites, que la pellicule n’enregistre pas » (Baetens & Lefèvre 1993 : 26). La caméra cadre une zone correspondant à ce que l’on veut montrer, occultant tout ce qui se trouve autour.
Dans la mesure où la case de bande dessinée est elle aussi bordée par un cadre (fût-il, quelquefois, virtuel), l’espace qu’elle délimite peut-être prolongé, mentalement, au-delà de ce qui est représenté.
i
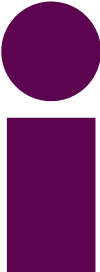
imaginaire
On parle communément de l’imaginaire d’une œuvre, d’un peuple, d’un créateur, d’une époque. Mais existe-t-il quelque chose comme un imaginaire propre à un art, à un médium ? Est-ce que l’ensemble des productions, accumulées depuis bientôt deux siècles, qui relèvent de ce que nous appelons aujourd’hui la bande dessinée, dessine les contours d’un imaginaire spécifique ?
Et s’il y a bien un « imaginaire BD » (on utilisera ici ce raccourci, par commodité), comment peut-il être défini ?
improvisation
Le travail du dessinateur de bande dessinée s’accomplit presque toujours sous l’impulsion et le contrôle de l’instance programmatique que l’on appelle le scénario. Quelle que soit la forme prise par ce document prescriptif, il s’agit de le servir au plus près, au plus juste, en évitant les « sorties de piste ». Dans la bande dessinée classique, l’image se trouve donc assujettie à un dessein narratif, et sa réalisation procède de la création sous contrainte.
Pour le dessinateur, l’improvisation apparaît comme une alternative à cette procédure habituelle. Entreprendre une page de bande dessinée, ou un récit plus long, en se laissant porter par le dessin même, en obéissant à ses suggestions, en faisant porter à conséquence les « accidents du crayon » (pour reprendre une expression d’Hergé), c’est – au risque de se perdre, ou de n’arriver nulle part – reconquérir une forme de liberté.
L’image cesse alors d’être serve et redevient motrice.
j
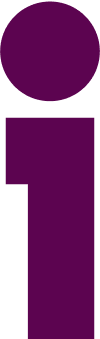
jungle
Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, en Europe occidentale comme en Amérique du Nord, toute une littérature d’exploration et d’aventures exotiques a érigé la « jungle » en terrain privilégié pour des péripéties haletantes. On songe par exemple aux exploits du journaliste anglo-américain Henry Morton Stanley au sein de la forêt équatoriale africaine, largement diffusés, aussi bien par ses articles dans le New York Herald, que dans des livres aux intitulés évocateurs, comme : À travers le continent mystérieux. Ce reporter s’était notamment rendu célèbre lorsqu’en 1870, parti à la recherche du missionnaire écossais David Livingstone, il avait parcouru savanes et jungles depuis Zanzibar jusqu’aux rives du lac Tanganyika.
Le roman d’aventures exploite rapidement le filon des récits de jungle, ce qui n’est guère étonnant puisqu’il entend distraire les lecteurs en les dépaysant, mais aussi initier les jeunes garçons à des valeurs supposées viriles, voire former les futurs agents des empires coloniaux. Le Livre de la jungle, publié en 1894 par Rudyard Kipling, qui avait fait ses débuts comme écrivain dans l’Inde britannique, vient immédiatement à l’esprit. À travers le destin du jeune Mowgli et des animaux sauvages qui l’aident ou le menacent, l’auteur livre un récit épique, mais aussi un conte moral, qui sera adopté comme manuel éducatif par le scoutisme. L’enfant élevé par les loups annonce à certains égards une autre figure incontournable du récit de jungle, plus dominatrice et visant un public plus âgé : Tarzan.
C’est en 1912 qu’Edgar Rice Burroughs publie le premier d’une longue suite d’ouvrages qui mettent en scène le « Seigneur de la jungle ». Mais d’autres auteurs déclinent, au sein du même environnement « sauvage », d’autres types de héros. Nous pensons notamment à Rider Haggard, qui avait vécu en Afrique du Sud, et impose avec Allan Quatermain, roman publié en 1887, la figure du chasseur de fauves aventureux qui parcourt l’Afrique à la recherche d’éléphants à traquer, mais aussi de mystères à résoudre. Il convient enfin de souligner que le cinéma s’est très rapidement emparé de tels récits, et qu’il en a largement amplifié l’écho. Tarzan of the Apes a ainsi été adapté pour la première fois sur les écrans dès 1918, soit six années seulement après la parution du roman.
justesse
J’ai emprunté, en plusieurs autres textes, une distinction formulée par Emmanuel Kant dans sa Critique de la faculté de juger, celle qui oppose deux formes de beauté, la « beauté libre » et la « beauté adhérente ». Cette dernière est définie comme la beauté de l’objet subordonné à une fin, laquelle « détermine ce que la chose doit être et par conséquent un concept de sa perfection ». Dans la mesure où le dessin de bande dessinée est assujetti à un projet narratif, dans la mesure où il obéit à un scénario et se met au service de l’histoire, on peut certainement dire de lui qu’il est, en effet, déterminé par une fin. Ce qui m’a conduit à suggérer que, pour ce qui le concerne, la notion de beauté – fût-elle « adhérente » – doit sans doute être requalifiée en justesse. Le terme, du reste, se rencontre fréquemment dans la bouche et sous la plume des dessinateurs.
En apprendre plusl
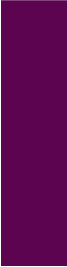
lettrage
Le lettrage désigne en bande dessinée l’ensemble des figures sous lesquelles le texte apparaît dans l’espace graphique, qu’il occupe des zones spécifiquement délimitées à cet effet (cartouches ou bulles) ou qu’il vienne au contraire s’inscrire directement sur le fond même de l’image. Il comprend le paratexte (titres, signatures, numérotation), les interventions du narrateur (récitatifs, didascalies, commentaires), toute la notation des sons (dialogues, onomatopées, bruits) – le lettrage assume ainsi une part très importante du « régime sonore » de la bande dessinée, au point que l’on appelle « muettes » les bandes dessinées qui n’en comportent pas du tout (puisque le lettrage n’est pas indispensable à la réalisation d’une bande dessinée). Mais il sert aussi un régime mixte dans lequel on trouve à la fois les « bulles de pensées » (qui codent du verbal non sonore) et les formes hybrides qui occupent la frontière entre le bruit écrit et le signe dessiné (ainsi les pictogrammes, qui font apparaître du dessin au milieu des lettres, comme c’est parfois le cas pour noter les jurons dans la tradition franco-belge).
En apprendre plusligne claire
Baptisée en 1977 par Joost Swarte à la faveur du catalogue d’une exposition présentée à Rotterdam, la klare lijn − en français : ligne claire – désigne, au sens le plus restrictif, le style d’Hergé, et, dans son acception la plus large, une mouvance aux contours assez flous regroupant de nombreux artistes de bande dessinée et illustrateurs animés par un même souci d’épure, de lisibilité, une même confiance dans le cerne, le trait net et la couleur en aplat.
m

manga
Historiquement attaché à Hokusai (même si quelques occurrences antérieures existent au Japon), le terme « manga » apparaît en 1814 et désigne tout d’abord une série de quinze carnets de dessins que le maître réalisait en marge de sa production d’estampes. Derrière ce qualificatif d’« images dérisoires » ne se trouve pas à proprement parler de narration, mais plutôt une accumulation de scènes du quotidien, ainsi qu’un certain nombre d’illustrations explorant le folklore fantastique japonais.
En apprendre plusmigrants
La bande dessinée semble être dès les débuts de son histoire et à bien des égards, une forme d’expression liée à l’immigration. Il faut dire que de nombreux pionniers du comic strip américain étaient eux-mêmes migrants ou descendants d’immigrants. Dès la dernière décennie du XIXe siècle, leurs conditions de vie apparaissaient au cœur de cette jeune forme d’expression publiée dans les suppléments couleur hebdomadaires des journaux américains comme le New York World de Joseph Pulitzer, homme de presse d’origine hongroise, le New York Journal ou le Los Angeles Examiner de William Randolph Hearst. On y trouvait notamment le Yellow Kid de Richard Felton Outcault, racontant la vie des immigrants irlandais de Hogan’s Alley, les aventures des Katzenjammer kids : Hans et Fritz, deux garnements d’origine allemande (Pam et Poum dans la version française), de Rudolph Dirks, ou encore les histoires de Jiggs, un ancien maçon émigré irlandais, dans Bringing Up Father, de George McManus...
En apprendre plusmode
La question du costume apparaît comme centrale dans la bande dessinée. Elle l’est, de toute évidence, dans les récits historiques, où l’effet de véridicité passe par la reconstitution de la manière de se vêtir propre à telle ou telle époque du passé. (Ce n’est sans doute pas un hasard si l’on doit à des auteurs de bande dessinée, le couple Liliane et Fred Funcken, une série d’ouvrages consacrés à l’uniformologie militaire – un sujet pour lequel Hugo Pratt s’est passionné lui aussi.) Elle se pose également en rapport avec les différents genres de l’aventure, dont les « emplois » – mousquetaire, cow-boy, pirate, explorateur ou pilote – exigent une tenue appropriée, archétypale. Elle surgit sitôt que le héros ou l’héroïne voyage et se confronte à d’autres cultures, dont il est tentant d’accuser la différence en allant du côté du folklore, du costume soi-disant typique.
En apprendre plusn

neuvième art
Le système des Beaux-Arts par rapport auquel la bande dessinée revendique le neuvième rang n’est plus, dans la culture contemporaine, une évidence admise, une référence commune. Qui pourrait citer le troisième art ? Le cinquième ? De fait, la bande dessinée s’est choisie ce drapeau en pensant au seul « 7ème art », le cinéma, avec lequel elle a d’ailleurs en commun d’être un art du récit en images.
En apprendre plusnonsense
L’origine de l’absurde ou nonsense est bien identifiée : il s’agit d’un genre littéraire, né en Angleterre au XIXe siècle. Il apparaît dans le contexte particulier, qui voit l’école devenir l’appareil de domination de la classe bourgeoise, et il remplit ainsi un rôle de contestation, s’attaquant à la langue, à la tradition littéraire classique, à la réalité et à l’institution politique, tout en les confirmant, jouant avec les limites du langage, du récit, de la littérature mais pour les ramener dans les limites du bon sens (Lecercle, 1995). En conséquence, le nonsense serait d’abord et avant un jeu sur le langage et ses limites et donc tout à fait spécifiquement littéraire.
Pour autant, on sait que dès ses premières manifestations, il a été fortement lié à l’image. Qu’Alice rappelle dès les premières pages de ses aventures qu’il ne saurait y avoir de livres sans images (« À quoi peut donc bien servir un livre sans images ? ») n’est pas anodin : l’image joue un rôle central dans le travail sur le langage livré par les auteurs nonsensiques ; elle vient compléter l’information pour supprimer les ambiguïtés de la langue. Aussi tous les limericks d’Edward Lear associent-elles un dessin qu’ils paraphrasent, de même que tous les textes de Lewis Carroll paraissent illustrés.
nu
La question du nu ne s’est guère posée, dans la bande dessinée européenne, avant les années soixante. Il faut attendre, d’un côté, les albums destinés aux adultes publiés par Eric Losfeld (Barbarella, Valentina, Jodelle, Epoxy, Saga de Xam…) et, de l’autre, les « pockets » italiens (Isabella en 1966, suivie de la cohorte des Jungla, Lucrezia, Messalina et autres Lucifera) pour que le corps, et singulièrement le corps féminin, apparaisse dévêtu.
Longtemps, l’érotisme dessiné avait été strictement anglo-saxon ; il y avait celui des adventure strips américains (les personnages féminins, Dale Arden dans Flash Gordon, Diana Palmer dans Le Fantôme, Narda dans Mandrake…, n’y dédaignant de prendre des poses suggestives), et celui des comic books (Sheena, Queen of the Jungle, en 1937, Tiger Girl et les autres jungle girls ou queens arborant de seyants bikinis en peaux de bêtes, puis Catwoman aux côtés de Batman dès 1940), sans oublier Jane, l’héroïne britannique de Norman Pett (dès 1932), régulièrement dessinée en sous-vêtements, et dont le premier nu intégral survint en 1943.
nuit
Pierre McOrlan définissait la photographie comme un « art solaire au service de la nuit ». La bande dessinée n’a peut-être pas la même relation ontologique à l’obscurité, mais il est peu contestable que la nuit – la nuit d’encre – inspire les dessinateurs. On peut même dire qu’il existe une famille de « dessinateurs de la nuit », qui comprend notamment (pour me limiter aux artistes francophones) Chabouté, Comès, Mathieu, Tardi ou Varenne.
En apprendre pluso

onomatopée et son
Étonnant paradoxe auquel nous confronte la bande dessinée : privée par nature de son, comment peut-elle, par la magie du trait et du dessin, faire retentir des bruits et donner à entendre des mélodies ?
Historiquement parlant, le lien entre le son et l’image intervient assez tôt. Dès la période carolingienne, des signes abstraits sont directement inscrits dans l’image pour évoquer la musique. Au IXe siècle, le chant comme le son des trompettes sont représentés systématiquement par des tirets parallèles, avec des variations de couleurs ou de formes exprimant des différences de volume sonore. Bien avant l’apparition de la parole en lien avec l’image, l’expression du son (comme de l’odeur) se manifeste par des signes ou des pictogrammes. C’est au XVe siècle qu’apparaît la représentation de la portée musicale où figurent des notes de musique (Livre du trésor de Vénerie) et des onomatopées (Calendrier des bergers). Il semble que les enlumineurs aient cherché à doter leurs images d’une expression sonore afin de leur donner une plus grande efficacité narrative. Même si les exemples de sons transcrits dans l’image sous forme d’onomatopées ou de symboles graphiques ne sont pas si nombreux (quelques dizaines d’exemples sur plusieurs centaines de milliers d’images médiévales), le phénomène mérite d’être relevé. Car ces conventions vont nourrir les créateurs d’images à venir. On retrouvera ainsi cette expression pictogrammatique du son dès les débuts de la bande dessinée avec Rodolphe Töpffer en 1831 (Histoire de M. Jabot, p. 30 : « M. Jabot rêve à des airs de mazourke »).
En créant une bande-son qui illustre des actions non verbales – nous excluons de cet article le son en tant que paroles des personnages –, la bande dessinée s’appuie donc sur une convention validée par la tradition. Cet artifice que tout lecteur accepte par connivence se développe selon des procédés multiples variant suivant les époques et reposant sur des codes précis issus d’un contexte et d’une histoire. La bande-son sans cesse renouvelée par les auteurs de bande dessinée invite le lecteur à une expérience sensorielle augmentée, en l’immergeant dans une ambiance particulière, en stimulant son imaginaire.
oubapo
L’Oubapo, l’Ouvroir de Bande dessinée Potentielle, rassemble une communauté d’auteurs et de théoriciens qui ont à cœur d’explorer les potentialités de la bande dessinée dans un esprit ludique.
François Ayroles, Anne Baraou, Gilles Ciment, Jochen Gerner, Thierry Groensteen, Patrice Killoffer, Etienne Lécroart, Jean-Christophe Menu et Lewis Trondheim constituent son noyau dur, malgré le départ de Thierry Groensteen en 1999. Autour de ces membres, les collaborateurs occasionnels sont nombreux : Stanislas Barthélémy, Emmanuel Guibert, Mattt Konture, Vincent Sardon, etc. Fort de son succès et de l’intérêt qu’il suscite, l’Oubapo compte maintenant des membres étrangers, Matt Madden, américain, Sergio Garcia, espagnol, ainsi qu’Alex Baladi, Ibn El Rabin et Andréas Kündig, tous trois suisses.
p

paratexte
Le paratexte est, selon la double étymologie du préfixe grec para-, l’ensemble des pages et messages qui entourent et protègent le texte. Sa fonction relève autant de la protection physique (couverture, pages de gardes) ou symbolique (prologue, préface, postface, épigraphe, etc.), que de l’identification (nom de l’auteur, titre de l’ouvrage, nom de l’éditeur, lieu et date d’édition, lieu d’impression, nom de la collection, code barre, etc.), de l’organisation (table des matières, bibliographie, répertoire, index, annexes), de la distinction (couverture souple ou rigide, format du livre, choix du papier) ou de la séduction (jaquette, illustration de surface, graphisme, etc.).
En apprendre plusparodie
Innombrables sont les récits dessinés qui se moquent d’un film, d’un roman, d’une série télévisée, d’une bande dessinée antérieure, ou encore d’un personnage mythique, que son statut d’icône de la culture (savante ou populaire) a conduit à s’incarner dans différents médias.
Dans le champ de la bande dessinée, le phénomène de la parodie a un caractère massif. Il est aussi ancien que l’art du récit dessiné, et son développement s’explique par ce que le critique américain Joseph Witek analyse comme « le penchant [des comics] pour le grotesque, l’exagération et l’extrapolation fantaisiste ».
paysage
La catégorie du paysage n’est pas de celle auxquelles on pense immédiatement en rapport avec la bande dessinée. En effet celle-ci a toujours privilégié le personnage, pivot et moteur du récit, point focal de l’action et de la mise en scène. Le décor dans lequel le personnage se meut peut être réduit à sa plus simple expression : quelques brins d’herbe, un arbre, une niche, un pupitre d’école, tels sont les éléments qui, dans Peanuts, suffisent à évoquer le lieu de l’action, à « planter le décor ». Chez les dessinateurs réalistes, il peut au contraire être profus, chargé de détails s’étageant sur plusieurs plans, voire somptueux ou spectaculaire (que l’on songe simplement à Prince Valiant).
L’une des questions qui se pose est de savoir si le personnage évolue dans le décor ou devant un décor. Dans ce dernier cas, le décor est un simple fond sur lequel il se découpe comme une forme prégnante. Dans l’autre hypothèse, le décor est à proprement parler un environnement. Non plus seulement un lieu mais un milieu. Nous verrons qu’il peut même accéder au rang d’acteur.
petit format
Dans l’Histoire de la bande dessinée, le « petit format », désigné comme entité spécifique, ne se réfère pas seulement aux dimensions physiques de ses productions mais renvoie à une catégorie de bande dessinée et une famille d’éditeurs, objectivement non définies. Le spécimen le plus courant est un périodique mensuel publiant, au format 13 x 18, deux ou trois récits complets en noir et blanc.
En apprendre plusphilosophie
La question des rapports entre bande dessinée et philosophie reste relativement inexplorée : les travaux déjà existants sont peu nombreux et l’on ne peut pas dire qu’il se dégage des thèses reconnues ou faisant autorité sur le sujet. Cet article se propose donc de procéder en deux temps. Tout d’abord, il s’agira d’envisager une classification des rapports possibles entre bande dessinée et philosophie. Ensuite, seront proposées des hypothèses sur les moyens de philosopher propres à la narration séquentielle.
En apprendre plusphotographie
Bande dessinée et photographie ont le même âge, l’invention de la « littérature en estampes » par Rodolphe Töpffer étant absolument contemporaine de la réalisation de la première photographie par Nicéphore Niepce en 1827 (l’année même où le Genevois dessine la première version de l’histoire de M. Vieux Bois). Dix ans plus tard, le daguerréotype de Louis Daguerre réduit le temps de pose de plusieurs heures à quelques dizaines de minutes. Et Töpffer prend une part active au débat que suscite immédiatement cette révolution des images. Il rédige dès 1840 un essai intitulé De la plaque Daguerre. À propos des excursions daguerriennes, dans lequel – fidèle à son opposition de principe à toute forme de progrès industriel – il fustige ce « procédé mécanique » qui ne peut proposer qu’une imitation plate et sans art de la nature. Selon lui, la « machine Daguerre » ne donne que « l’identité » au lieu de donner « la ressemblance » sentie, laquelle suppose « le concours de l’esprit », « le sceau de la pensée humaine et individuelle », la subjectivité d’un artiste. Pour Töpffer, l’imitation ne saurait être que le moyen de l’art, en aucun cas sa fin.
Pourtant, au nombre de ses successeurs immédiats figure Nadar (auteur en 1848 de la bande dessinée politique Histoire de Mossieu Réac). Et ce dernier, quoique reconnu pour ses talents de caricaturiste, délaissera le dessin pour… la photographie, faisant, dès 1850, poser devant son objectif les plus grandes célébrités de son temps. Pour être exact, Nadar exerce, un temps, les deux disciplines en parallèle, et avec le même dessein : constituer un « panthéon » du Romantisme (les quatre planches lithographiques de grand format du Panthéon Nadar, 1858, regroupent des portraits-charge de quelque 300 artistes et autres grands hommes).
physiognomonie
« Quand j’étais un enfant qui dessine des bonhommes sur ses cahiers, j’avais un moment solennel. C’était quand je mettais à mes bonhommes, des yeux. Et quels yeux ! Je sentais que je leur donnais la Vie et je sentais la vie que je leur donnais. J’avais les sensations de celui qui souffle sur la boue. » Ainsi s’exprimait Paul Valéry dans ses Cahiers (1988 : 29-30).
L’expérience rapportée dans ces lignes est sans doute l’une des plus communément partagées par tous ceux qui, à l’âge adulte ou dans l’enfance, en professionnels ou en simples amateurs, se sont mêlés de dessiner. On éprouve un sentiment de miracle devant le fait que quelques traits suffisent à simuler la vie, à donner de l’expression. Et pas n’importe quelle expression mais, Töpffer y insistait, toujours et nécessairement « une expression quelconque parfaitement déterminée ». L’historien d’art Ernst Gombrich validera et baptisera du nom de « loi de Töpffer » cette observation faite par l’artiste genevois : même jetée sur le papier sans intention particulière, une tête humaine, « par le seul fait qu’elle a été tracée », ne peut pas ne pas donner à voir, a posteriori, une expression précise, qu’il est possible de lire, d’identifier, de décrire.
planche originale
Objet depuis une trentaine d’années d’un intérêt qu’elle n’avait jamais connu auparavant − on la vend, l’achète, la restaure et l’expose −, la planche originale de bande dessinée, considérée en elle-même, a un statut ambigu : elle est dans la plupart des cas un moment dans un récit qui comptait d’autres planches avant et après elle ; elle est souvent en noir et blanc, alors que la page dans sa version finale est imprimée en couleur ; parfois les bulles de texte sont vides, car le texte est calligraphié sur support séparé. La planche originale est donc un document incomplet, étape parmi d’autres dans la réalisation d’une œuvre dont le but final est d’être imprimée et d’exister comme multiple, en tant qu’album ou dans les pages d’un périodique. Pour cette raison, et à une époque où la bande dessinée, vilipendée et méprisée, n’était pas reconnue comme un art, l’original a longtemps été considéré, y compris par les dessinateurs eux-mêmes, comme un document de travail ne méritant aucun respect.
En apprendre pluspoche [format de]
En littérature française, la réédition au format de poche existe depuis le dix-neuvième siècle. C’est en effet en 1838 que Gervais Charpentier entreprend de publier des classiques à prix réduit et à un format in-18. Les principes modernes de cet objet ont été définis par les éditions Hachette pour la collection du “Livre de Poche” au début des années 1950 : impression brochée et accès à la grande distribution. Ce label, inspiré par les éditeurs anglo-saxons, est ensuite imité par tous les concurrents, au point que l’édition traditionnelle devient tributaire des droits dérivés promis par le poche.
Cette économie spécifique a fait rêver certains bédéphiles. Elle pouvait d’abord procurer à la bande dessinée une rentabilité financière nouvelle. Les collections de poche ont aussi permis de constituer un corpus de référence en littérature et en sciences humaines, et elles promettaient de rendre tout aussi accessible, durablement et massivement, un fonds classique du neuvième art. Plus immédiatement, ces poches devaient aussi amener à l’édition de bande dessinée un nouveau public populaire, en étant distribués ailleurs qu’en librairie, dans les maisons de la presse et les kiosques de gare.
Cependant, la bande dessinée de poche a toujours conservé une marginalité exceptionnelle dans l’édition française, même si des expériences ont lieu presque en continu depuis les années 1960. C’est que plusieurs obstacles esthétiques et économiques s’y opposent. Pour une tradition fondée sur le grand format et la couleur, la réduction implique un renversement des valeurs qui ne va pas de soi. Le poche littéraire, déjà, avait dû envisager d’abréger les écrits et la mention « texte intégral » ne s’est imposée que tardivement ; mais la question est autrement plus douloureuse quand il s’agit d’adapter une narration visuelle. D’autre part, le marché du poche est fondamentalement différent de l’industrie historique de la bande dessinée. Le premier est construit sur des collections très générales avec des livres indépendants, que les lecteurs achèteront sur leur renommée ou sur celle de leur auteur ; la seconde repose sur une logique de série entretenue par des nouveautés et dynamisée par des personnages. Pour ces deux raisons, les tentatives de collections de bande dessinée de poche ont toujours hésité entre le modèle canonique de l’édition généraliste et les logiques propres aux fictions populaires. Leur histoire permet aussi d’évaluer la distance entre les deux marchés et leur rapprochement.
poésie
« Souvent, en bande dessinée, la poésie vire au poétisme, à l’émerveillement standard », prévenait naguère Christian Rosset. De belles images décoratives, des tons pastels : on verse facilement dans la mièvrerie, dans la joliesse convenue et fade.
Pourtant, si la bande dessinée a su s’imposer comme une littérature à part entière, si elle a annexé l’autobiographie et l’essai, on ne voit pas pourquoi il lui serait interdit d’emprunter les chemins de la poésie. Töpffer n’écrivait-il pas, dans une lettre à Sainte-Beuve datée du 29 décembre 1840 : « Il est certain que le genre est susceptible de donner des livres, des drames, des poèmes tout comme un autre, à quelques égards mieux qu’un autre… » ?
pop art
Pour l’amateur de bande dessinée, le Pop Art correspond à ce moment un peu singulier où la bande dessinée fait irruption avec fracas (et généralement accompagnée de tonitruantes onomatopées) dans la peinture, pour en devenir l’un des motifs. Du côté du neuvième art, on y décèle tantôt un hommage, tantôt une parodie, voire un plagiat pur et simple.
Dans ce contexte, Roy Lichtenstein (1923-1997) est le premier à qui l’on pense. Presque vingt ans après sa mort, ses peintures suscitent encore l’indignation et la controverse dans le milieu de la bande dessinée. En écho à la rétrospective de Roy Lichtenstein à la Tate Modern de Londres en 2013, le critique de bande dessinée Paul Gravett publie un article sur son blog, revenant sur l’héritage artistique et intellectuel laissé par l’artiste. Cette rétrospective ayant également eu lieu au Centre Pompidou à Paris, le journaliste Didier Pasamonik lui emboîte le pas sur le site ActuaBD. Les deux textes renvoient au travail de fourmi de David Barsalou : Deconstructing Roy Lichtenstein, qui recensa patiemment les emprunts de l’artiste aux comics des années 1950 et 1960.
présence
« De même que les portraits ne parlent pas ni les mélodies ne regardent, de même les sculptures sont immobiles et les danseurs sans visage ni voix, de même les poèmes se dérobent au sens et le cinéma s’emporte dans son propre mouvement. Ce qu’on nomme œuvre de l’art expose chaque fois une manière singulière de se soustraire à la présence… », écrit le philosophe Jean-Luc Nancy (2006 : 125). La bande dessinée ne fait pas exception, sans doute, même si cette soustraction à la présence est évidemment relative. Dans la mesure où elle est à la fois un art du récit et un art mimétique, nul doute en effet que la bande dessinée nous rend présents, par l’action et la figuration, ses personnages de papier. Si tel n’était pas le cas, leurs aventures nous laisseraient indifférents. La participation du lecteur au récit repose, comme l’on sait, sur l’empathie, poussée, dans certains cas, jusqu’à l’identification. La fierté et la ruse de Tintin sont les nôtres, tout comme les emportements du Capitaine Haddock. Nous sommes désolés pour Charlie Brown et pour Jimmy Corrigan.
En apprendre plusproduits dérivés
Généralement connotée de manière négative, l’expression « produit dérivé » désigne les objets conçus chronologiquement après une œuvre originale et qui exploitent souvent les images des personnages principaux. L’ampleur et la variété de ces marchandises témoignent de la popularité d’une bande dessinée qui se voit ainsi déclinée sous de multiples formes. Des chaussettes Mickey aux posters de super-héros américains, des cartes à collectionner Pokémon aux biscuits Titeuf, la matérialisation des personnages dans le quotidien des enfants consommateurs semble presque infinie. Mais elle se retrouve aussi dans un nombre considérable d’objets à collectionner pour les adultes.
En apprendre plusr

réalisme
Le champ de la bande dessinée est structuré par un clivage pour ainsi dire institutionnel entre, d’un côté, la production dite réaliste et, de l’autre côté, la bande dessinée d’humour. Ces catégories sont doubles : elles désignent à la fois des contenus (les bandes dessinées d’aventures, épiques ou dramatiques, mais aussi, plus récemment, les œuvres affichant vis-à-vis du réel une fidélité d’ordre documentaire : reportage, autobiographie… en tant que les unes et les autres s’opposent à celles qui cultivent la satire, le gag, recherchant l’effet comique au prix de toutes les outrances, extravagances et invraisemblances) et des modes de représentation, des styles graphiques.
Cependant, dès qu’on examine ces catégories de plus près, elles apparaissent floues et peu opératoires. Comme l’ont observé Bruno Lecigne et Jean-Pierre Tamine, chez bien des auteurs classés comme réalistes – Tardi, Golo, Loustal… −, on trouve des « composantes graphiques issues de la caricature » (1983 : 9). Par ailleurs, on ne sait trop quel sort réserver aux « aventures humoristiques » (dont les aventures de Spirou et Fantasio sont un bon exemple), qui partagent avec le récit d’aventures traditionnel une certaine ampleur, le recours au suspense et aux situations dramatiques, mais qui sont par ailleurs empreintes de fantaisie et d’humour et dessinées dans un style caricatural. Tome et Janry ont tenté l’expérience d’un Spirou plus sombre, plus « réaliste », avec l’épisode Machine qui rêve (album paru en 1998), mais cette proposition est restée sans suite et le duo a ensuite abandonné la série.
religion
La presse confessionnelle a joué un rôle très important dans la gestation de la bande dessinée francophone. Celle-ci, on le sait, s’est développée en premier lieu comme un genre destiné aux enfants. Or, durant l’entre-deux-guerres, en France, et plus encore en Belgique, jeune royaume moins marqué par l’esprit laïque, l’Église catholique contrôlait une grande part des périodiques pour la jeunesse. Des auteurs aussi importants qu’Hergé et Jijé publient leurs premiers récits avec des bulles dans des hebdomadaires chrétiens : Le Petit Vingtième pour le premier, Le Croisé de Namur pour le second. Et la presse catholique joue par exemple un rôle essentiel dans la diffusion des aventures de Tintin dans l’Hexagone. Dès 1930, soit un an seulement après leur création à Bruxelles, les exploits du petit reporter à la houppette sont en effet repris au sein de Cœurs Vaillants, hebdomadaire émanant des « patronages » français pour les garçons. Les réseaux ecclésiastiques, bien structurés, font preuve d’efficacité autant que d’inventivité. C’est ainsi que les aventures de Tintin sont aussi diffusées dans les patronages français sous la forme d’« images fixes », sorte d’ancêtres du dessin animé.
En apprendre plusrêve
Le dessin est apparu très tôt comme un moyen de donner consistance aux images dont sont tissés nos rêves. À notre connaissance, le premier rêve authentique retranscrit sous cette forme est de la main de Dürer : un déluge d’eau évoqué dans une aquarelle. À l’époque moderne, des peintres surréalistes comme Ernst, Dali ou Magritte se sont inspirés de rêves, empruntant cette « voie royale qui mène à la connaissance de l’inconscient » − pour reprendre les mots de Freud – et qui lève les censures de la raison. Les dessinateurs humoristes n’ont pas été en reste (Voyages du rêveur, de Maurice Henry, 1979). Quant à la bande dessinée, elle a scellé un pacte entre l’imaginaire et l’onirisme dès 1905 avec le chef-d’œuvre de Winsor McCay Little Nemo in Slumberland.
En apprendre plusroman en gravures
Quelques initiatives éditoriales récentes, aux États-Unis comme dans plusieurs pays d’Europe, ont remis en lumière un genre apparu vers 1920 et qui s’est éteint dans les années 50, le roman en gravures. La raison de ce regain d’intérêt est qu’à l’heure où fleurissent des albums de bande dessinée sans texte (voir l’article sans paroles), ces œuvres du passé, quoique produites en marge de l’industrie du divertissement et relevant plutôt de la « grande culture », sont perçues comme l’une des sources lointaines de ce que l’on nomme aujourd’hui le roman graphique. Pour Art Spiegelman, elles relèvent d’une « histoire secrète » de la bande dessinée, et Scott McCloud y voit les « chaînons manquants » de l’histoire du neuvième art.
En apprendre plusroman graphique
Traduction littérale de l’appellation graphic novel, la catégorie du « roman graphique » s’est imposée dans le vocabulaire des éditeurs et des médias, ce qui ne l’empêche pas de rester entachée d’un certain flou.
En apprendre pluss

sans paroles
Dès la parution des premières planches dans Métal hurlant No.1 en 1975, Arzach, de Moebius, fit sensation, en raison de sa beauté plastique, du caractère énigmatique du récit proposé, mais surtout de son mutisme. Il s’agissait d’une bande dessinée sans « bande son », d’un spectacle purement visuel. La bande dessinée muette avait déjà une longue histoire derrière elle, mais à l’époque de la réception d’Arzach, le projet d’une bande dessinée sans paroles passa pour être d’une grande audace. Peu de lecteurs se souvenaient d’un récit également silencieux de Raymond Poïvet, demeuré assez confidentiel, Allô ! Nous avons retrouvé M.I.X. 315 ! Il est vivant. Nous allons le sauver !! Dessinées en 1965 mais publiées pour la première fois en octobre 1971 dans le No.5 du prozine Comix 130, ces douze planches répondaient à la volonté de l’auteur d’explorer les possibilités d’une bande dessinée « pensée graphiquement », qui ne soit plus inféodée à une intrigue, un prétexte anecdotique. Comme l’a justement relevé Philippe Lefèvre-Vakana, de nombreux éléments de l’histoire de Poïvet se retrouvent dans Arzach : « le singe géant, la végétation tentaculaire, les habitations troglodytes aux ouvertures circulaires, les oiseaux-montures, l’arche en ruine… On retrouve même cette étrange sensation d’un monde qui se meut au ralenti. »
En apprendre plusscénario
Techniquement parlant, un scénario est un document de travail qui préexiste à l’étape de la mise en images ; il fixe et décrit le contenu du récit (intrigue, personnages, péripéties, détail de chaque scène), comprend les dialogues et les indications à partir desquelles les images vont être réalisées. Cette définition vaut aussi bien pour un film que pour une bande dessinée, et plus généralement pour toute forme de récit visuel. Mais le terme est communément utilisé dans une acception moins précise, comme synonyme d’histoire (« par exemple : « le dessin m’a plu mais je n’ai pas accroché au scénario »). Dans ce cas, le scénario n’est plus assimilé à un document intervenu au début du processus de création mais à une forme ou couche de sens qu’il serait possible de dégager a posteriori, au terme de la lecture. Il va sans dire que ce qui est désigné alors ne saurait coïncider exactement avec le scénario au premier sens du terme.
En apprendre plusscience-fiction américaine
Certains théoriciens ont pu décrire la science-fiction américaine (écrite) comme reposant sur la réduplication d’un schéma narratif unique, déguisée par les variations de surface de la fable (Riche et Eizykman, 1976 : 12-20), et ont cru voir dans la bande dessinée américaine de science-fiction l’acmé d’un tel phénomène de recyclage, du fait que l’image narrative amplifie les possibilités de variation anecdotique, mais implique en retour une rigidification du schéma narratif (id. : 20-22).
Une vision moins idéologique et mieux informée de l’anticipation américaine en bande dessinée conduit à des conclusions à peu près inverses. Trois observations liminaires s’imposent à cet égard. La première sera fort brève, elle porte sur les rapports privilégiés que les littératures dessinées entretiennent avec les littératures de l’imaginaire. La seconde et la troisième amèneront à davantage de développement car elles sont relatives, respectivement, au parallélisme historique entre les science-fictions écrite et dessinée et à la spécificité de la bande dessinée dans la conception des récits. Il faut soigneusement séparer ces deux aspects de la question, sous peine de retomber dans l’erreur consistant à voir dans la science-fiction dessinée un démarquage simplifié de la littérature écrite, et de surcroît anachronique, ou du moins accusant un retard chronologique, par rapport à cette littérature écrite.
science-fiction dans les mangas
Certains évoquent, pour l’apparition de la science-fiction au Japon, le conte d’Urashima Tarô, qui est évoqué pour la première fois en 720 de notre ère. Dans cette fable (dont Lafcadio Hearn donne une version dans le premier chapitre de son ouvrage Out of the East – Reveries and Studies in New Japan, 1895), Urashima Tarô, un jeune pêcheur, visite un palais sous-marin. Il y passe trois jours mais découvre en rentrant à son village que trois cents ans ont passé – sa maison en ruine, ses parents morts et lui-même oublié depuis longtemps. Pour autant, cela en fait-il véritablement un récit de science-fiction ? Ou faut-il y voir une nouvelle illustration de la frontière ténue qui existe entre fantastique et science-fiction – notions que les Anglo-saxons regroupent d’ailleurs parfois sous le même terme de fantasy ?
En apprendre plusscience-fiction européenne
Le terme de science-fiction est étroitement circonscrit temporellement. En France, il faut attendre l’après-guerre pour qu’on parle d’« une science-fiction », en voulant dire un récit (écrit) de science-fiction. Désigner comme relevant de la science-fiction une bande dessinée antérieure aux années 1950 reposant sur une extrapolation à partir d’une donnée scientifique relève donc, sinon de l’anachronisme, du moins de la construction d’un objet d’étude, nullement d’une description neutre. L’inconvénient est que, ainsi désigné, cet objet est défini implicitement en référence à la littérature équivalente aux États-Unis. Or les littératures européennes et américaines diffèrent très sensiblement, comme on le verra. Une expression moins connotée serait celle de « récit d’imagination scientifique », équivalent approximatif du scientific romance britannique. Cependant une telle désignation est elle-même assigné temporellement (elle correspond en gros à la Belle-Époque).
En apprendre plusséquence
La bande dessinée a été définie par certains comme étant essentiellement un art hybride, le résultat d’une collaboration entre le texte et l’image. D’autres spécialistes ont suggéré que son fondement était à chercher du côté de son dispositif tabulaire, de son mode d’occupation de l’espace. Il y aurait bande dessinée dès que des images juxtaposées seraient proposées à la vue dans un espace compartimenté. Cette définition, il est important de le noter, admet la possibilité d’une bande dessinée abstraite ou non narrative, puisque que le « multicadre » (pour reprendre le terme proposé par Henri Van Lier), en son principe même, suffirait à signer une occurrence du média, quels que soient les contenus présentés.
Toutefois, c’est la notion de séquence qui a cristallisé les définitions les plus usuelles, dans le sillage des ouvrages de Will Eisner Comics and Sequential Art (1985) et Understanding Comics, de Scott McCloud (1993). Eisner définissait l’art séquentiel comme « l’art et la forme littéraire qui procède par arrangement d’images et de mots pour narrer une histoire ou dramatiser une idée ». La bande dessinée en était, selon lui, la forme moderne dominante, et sa principale « application au support papier ». Scott McCloud, qui s’est expressément rangé sous le patronage d’Eisner, donnait pour sa part de la bande dessinée la définition suivante : « images picturales et autres, fixes, volontairement juxtaposées en séquences ».
série
L’industrie de la bande dessinée est structurée depuis longtemps par un double principe : celui de genre et celui de série, avec tous les effets de standardisation de la création que ce fonctionnement induit. Il suffit de consulter les catalogues des grands éditeurs pour le vérifier.
En apprendre plusshoah
Shoah signifie catastrophe en hébreu et désigne, en France, depuis la sortie du film éponyme de Claude Lanzmann en 1985, l’assassinat de près de six millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les pays anglo-saxons, c’est le terme d’Holocauste qui est toujours majoritairement employé pour évoquer le génocide du peuple Juif. Pour certains historiens, comme Paul-André Rosental, la Shoah « s’étend au-delà de la Seconde Guerre mondiale, aussi longtemps qu’elle exerce des conséquences directes sur les personnes qu’elle concerne, bourreaux et victimes, morts et survivants, natifs de l’avant ou l’après-1945 ».
En apprendre plussouterrains
Si l’on devait dresser une typographie des lieux favorables à l’imaginaire, sans doute que le souterrain y tiendrait une des toutes premières places, aux côtés du labyrinthe, avec lequel il se confond souvent. Sur ce sujet, comme on va le voir à travers un petit parcours anthologique limité, pour l’essentiel, au domaine francophone, la bande dessinée se montre digne héritière des littératures de l’imagination. Elle se voit redevable d’un topos vieux de plusieurs siècles et qui remonte même, comme tout ou presque, au berceau de l’humanité. Nous serons amené à distinguer le souterrain infernal, le souterrain gothique, le monde-bulle du souterrain de la Terre creuse, et enfin le souterrain initiatique.
En apprendre plusstyle
Quelquefois tenu, dans les milieux artistiques, pour intrinsèquement daté (l’art moderne et contemporain l’ont abandonné, au même titre que celui du beau), le concept de style fait pourtant éternellement retour. Il insiste. Dans l’usage courant, rien n’est plus fréquent que d’évoquer le « style » de tel ou tel dessinateur. Dans la littérature critique, il est difficile d’en faire l’économie.
En apprendre plussuper-héros
Pour le fandom, la bande dessinée de super-héros naît « officiellement » avec la création de Superman, en juin 1938, dans le premier numéro du comic book Action Comics, publié par la firme Detective Comics.
Ainsi envisagé stricto sensu, le super-héros est un personnage « indigène » de la bande dessinée, il ne se comprend qu’à l’intérieur du média qui va populariser le concept, l’incarner graphiquement et le faire fructifier jusqu’à ce qu’il se confonde avec un de ses genres les plus féconds.
Mais l’idée du surhomme est en réalité beaucoup plus ancienne, et si le super-héros dessiné présente certains traits originaux (question qui est proprement l’objet de cet article), il n’en puise pas moins ses racines dans des traditions multiples et hétérogènes, dans la mythologie et dans la littérature. On peut distinguer à cet égard la mythologie gréco-romaine, les sources bibliques et le merveilleux chrétien, et enfin une littérature d’aventures remontant au tout début du XXe siècle américain.
surréalisme
Roger Sabin a observé que l’épithète « surréaliste » a pu et peut être appliquée à des bandes dessinées très différentes, en particulier des récits de rêve, ou présentant des juxtapositions inattendues, mais également des récits cherchant à exprimer une conscience psychédélique ou une forme d’hyperréalité (Sabin 2012). Cependant, il n’existe aucune instance habilitée à délivrer des certificats de surréalisme, et la frontière est souvent difficile à tracer entre ce qui peut être appelé surréalisme et ce qui relève du merveilleux, de la fantasy, de l’absurde, du psychédélisme, de l’onirisme.
En apprendre plussuspense
A priori, l’ensemble des médias capables de raconter une histoire partagent un certain nombre de traits communs, parmi lesquels figure une caractéristique essentielle pour les récits de fiction : ces derniers doivent être capables de construire un monde dans lequel le récepteur (lecteur, auditeur, spectateur) peut s’immerger par l’imagination. Sur la base de cette immersion, il devient possible de nouer une intrigue, c’est-à-dire de produire une tension orientée vers un dénouement, ce qui revient à dynamiser la durée de la représentation ou du spectacle, à lui imprimer un rythme fondé sur l’intérêt du récepteur concernant la suite du récit. Pour être plus précis, certains narratologues considèrent qu’il existe trois types d’« intérêt narratif », que l’on peut aussi considérer comme trois modalités distinctes de la « tension narrative » (Baroni 2007) : 1. le suspense, qui est orienté en direction du futur de l’histoire racontée, en lien avec le développement incertain d’une action, ce qui pousse le récepteur à se demander « que va-t-il arriver ? » ; 2. la curiosité, qui joue sur une représentation mystérieuse des événements, de sorte que l’on s’interroge sur la nature de ce qui arrive ou de ce qui est déjà arrivé ; 3. la surprise, qui est un effet limité dans le temps, lié aux développements imprévus de l’histoire.
En apprendre plust
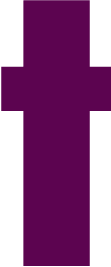
théâtre
Théâtre et bande dessinée ont une histoire commune qui remonte au XIXe siècle. Inventeur de la littérature en estampes, Rodolphe Töpffer était aussi un auteur dramatique. Dans les mêmes années qui le virent composer ses albums, il écrivit quelque huit pièces, des comédies jouées dans la pension qu’il dirigeait à Genève, dans lesquelles il figurait lui-même en tant que comédien. Ses talents d’acteur comique régalaient ses proches. On imagine qu’il se souvenait des moyens de produire tel ou tel effet sur le public quand il dessinait ses personnages et inventait pour eux des saynètes bouffonnes.
En apprendre plusu

underground
Littéralement « bandes dessinées souterraines », les underground comics que l’on peut également raccourcir en « UG Comix », sont des bandes dessinées produites aux États-Unis de la fin des années 1960 jusqu’au milieu des années 1970. Si l’on excepte les Tijuana Bibles (petits livrets pornographiques distribués sous le manteau entre la fin des années 20 et celle des années 1940, également appelés eightpagers, car ils ne comportaient que huit pages), les comics underground sont la première manifestation d’envergure d’une production faite en dehors des circuits commerciaux traditionnels de la bande dessinée US. La naissance et le développement du mouvement underground se fait dans le contexte général d’une remise en cause du modèle de vie américain hérité des années 1950. Le mouvement hippie, les luttes pour les droits civiques et la contestation de la guerre du Viet Nam forment la toile de fond sur laquelle se déploient les BD underground, qui en seront marquées dans leur contenu.
La date communément admise de la naissance de l’underground est 1968, avec la parution du premier numéro de Zap Comix (avec un « x », pour se démarquer des comics classiques), entièrement de la main de Robert Crumb et vendu par lui-même dans le quartier d’Haight-Ashbury, à San Francisco, mais certains historiens signalent que, dès 1964, les dessinateurs Jaxon et Frank Stack publièrent chacun de leur côté un comic book qu’on peut qualifier d’underground. Il n’est d’ailleurs sans doute pas indifférent que ces deux publications pionnières (God Nose et The New Adventures of Jesus) soient toutes deux des satires radicales de la religion chrétienne.
v
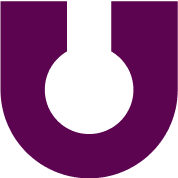
ville
Un lecteur contemporain de bande dessinée repère presque naturellement ce qui en elle est « urbain » : l’asphalte, les pavés de ses rues, la pierre, la brique de ses murs, le verre et l’acier de ses buildings sont les matières où son corps vient se heurter chaque jour et, en les reconnaissant dans les albums, il reconnaît son environnement naturel. Son regard est plus encore habitué aux lignes de fuite de ses avenues, de ses rails de tramways, toujours arrêtés par le visage d’une façade voire par l’élévation imposante d’un monument. Il y a dans ce mobilier urbain, dans ces panneaux de signalisation, ces réverbères, ces affiches, ces vitrines d’un magasin, une présence diffuse, un décor qui fait que le lecteur contemporain se reconnaît et sait qu’il est « en ville ».
En apprendre plusviolence
Étymologiquement, « violence » vient du latin violencia, du verbe vis (« vouloir ») lui-même dérivé du grec bia signifiant « la force ». La violence mesure l’écart, dans une situation donnée, entre la puissance de la force déployée et la norme du contexte où elle se déploie.
Toute violence est donc avant tout relative et sujette à réévaluation. C’est encore plus vrai quand cette violence est mesurée à l’intérieur d’une représentation, cette représentation pouvant être violente en elle-même ou parce qu’elle représente des actes ou des situations de violence.
Passées les expérimentations d’un Töpffer ou d’un Caran d’Ache, les premières bandes dessinées sont produites dans le but de distraire les enfants (dans le domaine de la presse enfantine) ou les adultes (dans la presse quotidienne, en particulier aux États-Unis ou au Japon). Cette vocation à distraire n’en fait pas un réservoir à représentations d’acte de violence, au contraire. Les premiers temps du médium voient en revanche la mise en place de signes iconiques surnuméraires (droites et courbes indiquant le mouvement, étincelles, étoiles, tourbillon et ondulations de lignes…) qui sont vécus comme une véritable violence par une partie du public, avant d’être adoptés. Cette logique guide les premiers ennemis durables de la bande dessinée (Ralph Bergenbren aux États-Unis ou l’abbé Bethléem dans le domaine franco-belge) : la violence de la bande dessinée qu’ils dénoncent est celle ressentie par des lecteurs confrontés à une lecture dont ils ne maîtrisent pas les codes, qui ne s’inscrit pas dans la norme de ce qu’ils considèrent comme de la lecture classique. On retrouvera ces mêmes réflexes de condamnation à partir de la fin des années 1980 quand le manga s’imposera en Occident. Présentant ou non des actes de violence, le manga fait avant tout violence parce qu’il bouscule les standards de la bande dessinée américaine ou franco-belge qui se sont imposés aux lecteurs.
w

western
Même s’il a existé sous d’autres formes, du roman à la comédie musicale, le western est, plus que tout autre genre, étroitement lié dans notre imaginaire à l’art cinématographique. Les films de Walsh, Ford, Hawks, Mann, Peckinpah, Leone et quelques autres, avec leurs grands espaces et leurs acteurs de légende, leurs chevauchées fantastiques, leurs faux et leurs vrais indiens, ont fait rêver des générations, créant une véritable mythologie. (Kurtzman et Elder en parodièrent les clichés dans « Cowboy ! », Mad No.20, 1955.)
La bande dessinée ne peut pas nous offrir Monument Valley au format Cinémascope, mais les rochers de l’Arizona ont tout de même fourni à Krazy Kat un décor mémorable.







