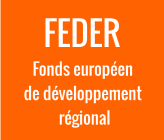Thomas Dassance - Entretien bédéphile
Retranscription de l’entretien avec Thomas Dassance, mené par Maylis Cazayus-Claverie, étudiante en master 2 « Bande Dessinée : Edition, Théorie et Critique » de l’université Bordeaux Montaigne, le 20 janvier 2023.
Maylis Cazayus-Claverie : Quelle a été ta première expérience de lecture de bande dessinée ? À quand ça remonte, en fait ?
Thomas Dassance : Enfant, comme je pense la majorité des gros lecteurs BD. Et moi, le vrai flash en tant que lecteur, c'est quand je devais avoir 9-10 ans. J'ai eu en même temps en cadeau deux abonnements à des revues de bande dessinée de l'époque : Le Journal de Tintin d'un côté et Pif Gadget. Pendant un an, j'ai été nourri avec des revues qui arrivaient, une le mercredi et une le samedi, et je me souviens qu’il y avait le plaisir de lecture et aussi le plaisir de recevoir. À l'époque, on allait en classe le samedi matin. J'étais à l'école primaire, donc je devais être en CM2, je rentrais le samedi midi et elle m'attendait sur la table. Je n’avais même pas envie de manger, j'avais envie de lire la revue. Et pas juste un titre en particulier, même s'il y avait Rahan et Placid et Muzo. Mais après, c'était vraiment aussi lié au plaisir de le recevoir à la maison et d'avoir à chaque fois un nouveau truc à lire. Et voilà, ça a été ça, on va dire, le gros début en tant que lecteur de BD.
MCC : Et après, tu es resté abonné ?
TD : Non, ils ne m’ont pas réabonné. C'est dommage. Par contre, il y avait le fils de ma marraine qui avait une collection gigantesque de Pif, et donc, ça, j'en ai hérité. J'en ai eu, mais des centaines d'exemplaires d'un seul coup. Ça, et puis il avait aussi des hors-séries de Placid et Muzo. Ça m’a longtemps alimenté. Après, je me suis tourné vers Tintin et pas mal d'autres titres. Mais là déjà, c'était en album en fait, plus qu’en revue.
MCC : Ah oui d’accord, tu es passé de l’abonnement aux albums assez vite finalement ?
TD : Ouais voilà. Et puis le rôle des bibliothèques, aussi. Je me suis rendu compte qu'en bibliothèque, il y avait pas mal de BD. J'ai eu deux étapes en fait : une étape enfant, où j'allais à la bibliothèque souvent le samedi avec mon père et je prenais toujours une ou deux BD ; et après, période collège, plus du tout. C'est à la fac que j'ai redécouvert la bibliothèque de ma ville et que j'ai découvert qu'ils avaient un secteur indépendant. J'étais parti à fond sur la bande dessinée indépendante à l'époque de la fac et j'ai vu qu'ils avaient du Baudouin et plein de trucs que j'avais envie de lire.
MCC : Où ça ?
TD : À Orthez. Je faisais mes études à Pau mais j'y allais les week-ends ou pendant les vacances. J'ai pillé la bibliothèque d'Orthez, je pense. Il y a eu un été, notamment, où j'y suis allé et j’étais là : « Putain, mais en fait ils ont plein de trucs hyper bien que j'ai jamais lus ! » Et c'est là que je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi ce secteur BD que j'avais pas du tout exploré étant gamin, et qui n’existait peut-être même pas à l’époque. Ça a été une bonne source de lecture.
MCC : Et est-ce que à ce moment-là, quand tu étais en train de faire tes études, tu avais déjà envisagé de faire un parcours vers la bande dessinée, ou pour l'instant c'était un loisir ?
TD : Au début, non pas du tout. C'est venu après, au fur et à mesure. J'en lisais de plus en plus, on faisait des festivals BD, dont Angoulême tous les ans et un festival à Bordeaux qui s’était fait une ou deux fois. On allait surtout dans la bulle New York à Angoulême et c’étaient les débuts de La Cinquième Couche, les débuts de FRMK… Ils étaient hyper militants, ils disaient : « mais il faut s'y mettre, il faut que vous éditiez vous-même si vous avez des choses à dire ». C'est là qu’avec des potes, on a commencé à avoir envie. Et après, quand je suis arrivé en fin de parcours universitaire…
MCC : Tu faisais de l'histoire, c'est ça ?
TD : Ouais j’étais en histoire, et après ma maîtrise, je me suis demandé si j'avais vraiment envie de devenir prof. Non, de moins en moins (rires). Je me voyais plutôt faire un truc dans l'édition et à la fin de ma maîtrise, j'ai passé le concours pour rentrer à l'IUT métiers du livre à Bordeaux. Mais en même temps, je m'étais inscrit en DEA avec une option pour partir faire des recherches en Argentine. J'ai eu les deux et ça a été un dilemme. Mais l'Argentine était trop attirante, du coup je suis parti en Argentine.
MCC : Et quand tu es parti, est-ce que tu avais envie de faire quelque chose dans l'édition ou tu voulais juste découvrir ce pays ?
TD : Un peu des deux. Je suis parti en Argentine en me disant que j'allais sûrement découvrir des œuvres et des auteurs qui n’étaient pas parvenus jusqu’en France. Mais je ne pensais pas que ce serait possible de faire quelque chose dans l'édition puisque je partais du côté des études historiques. J'avais écrit à Mosquito, au Chien Rouge, à plusieurs petites maisons d'édition qui me semblaient pouvoir être intéressées par des auteurs argentins et je leur avais dit : « je pars en Argentine, je vais peut-être découvrir des auteurs ou des œuvres, si ça vous dit je peux vous les envoyer ». Et ils m'avaient répondu très gentiment que non, que ce n’était pas la peine.
MCC : On n’a pas besoin de toi ? (rires)
TD : Je ne sais pas si c'était la teneur du message, mais c'était : « on est de trop petites maisons d'édition, ce qu'on a à éditer nous suffit ». Et ils avaient décliné. Donc oui, j'étais un peu parti avec l'idée d'être un passeur, d'essayer de connecter des gens. C'est d'ailleurs comme ça qu’est né Ex Abrupto, dans l'idée que je me voyais comme passeur de certains auteurs, certaines cultures, plus que dans l'optique de vraiment être un éditeur.
MCC : Du coup, la revue c'est quelque chose qui permettait ça ?
TD : Ouais. Et ça, c'est né parce que ces maisons d'édition françaises m'avaient dit non. Quand je suis arrivé là-bas, c'était juste avant la crise de 2001. Le secteur édition BD était TOTALEMENT détruit en Argentine. Il n’y avait plus aucune maison d'édition qui publiait de la bande dessinée. Les dernières avaient fermé ou ont fermé juste après mon arrivée. Il ne restait qu’un éditeur, mais qui ne faisait pas vraiment de la bande dessinée. Il faisait de l'humour graphique et c'était celui qui vivait grâce à Mafalda. C'était De La Flor, et tous les autres avaient disparu. Et malgré tout, en allant dans une librairie bande dessinée qu’il y avait à la Plata, puis dans une qu’on avait découvert à Buenos Aires, on s'est rendu compte qu’il y avait une scène alternative. Donc c'était assez surprenant parce qu’en France, la scène alternative avait l'air de ne pouvoir exister que parce qu'il y avait un marché avec des gros éditeurs, alors que là, c'était un « marché » qui fonctionnait sans gros éditeurs, uniquement sur la base de l'alternatif, du fanzinat, etc. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des festivals, des rencontres, des journées… J'ai commencé à y aller. C'était assez facile de rencontrer les auteurs qui étaient un petit cercle. Je suis devenu amis avec certains d'entre eux. Ça m’a permis d’imaginer la possibilité de faire connaître leur travail en France, je ne me voyais pas faire ça en Argentine. Alors j’ai eu l’idée de faire une revue binationale où on mélangeait des auteurs français et des auteurs argentins.
MCC : Et tu disais que tu avais commencé un peu en France avec tes amis, c'est ça ? Est-ce que tu as fait partie d'un collectif ou c'était beaucoup plus informel ?
TD : C’était juste resté juste à l’état de projet. On était vraiment trop étudiants, avec tout ce qui allait avec... donc les soirées, etc. Plein de grands projets et qui, en général, ne se concrétisaient pas le lendemain parce que le lendemain, il y avait la gueule de bois et il y avait beaucoup moins d'envie de le faire. Mais le soir, on était très motivés et on avait plein de projets. Par contre, avec deux copains dessinateurs, on avait entamé des BD, des projets de revues, des trucs comme ça, mais rien qui ait jamais tenu plus que les premiers temps de l'envie.
MCC : Ça n’a pas résisté au temps ?
TD : Non, jamais.
MCC : Tu as organisé un festival en Argentine. Donc ça a été, une fois que tu es rentré dans ce milieu ?
TD : Ça s'est fait après, en fait. Il y a d'abord eu l'étape de création de la maison d'édition. Je ne pensais faire qu'une revue, pas une maison d'édition. C'était la revue Ex Abrupto, qui avait dans l'idée de mélanger des auteurs français et des auteurs argentins, de les faire vivre dans un même espace papier et d’essayer de voir quels types de d'échanges il pouvait y avoir à travers tout ça. Cette revue devait être publiée à la fois en Argentine et en France, donc c'était vraiment un projet avec un pied de chaque côté. Avant la revue, le premier bouquin qui est sorti était un recueil d'adaptations de nouvelles littéraires, car c'était plus facile à faire et à mettre en place pour faire connaître la maison d'édition. Ce livre n’est sorti qu’en France. Grâce à ça, on arrive à se capitaliser, entre guillemets, mais ça permettait, vu les prix en Argentine, d’imprimer là-bas. Je fais donc imprimer le premier numéro de la revue en France et en Argentine. Et en France, soit l'imprimeur m'a pris des thunes et n'a jamais imprimé, soit il a fait imprimer et ça s'est perdu, mais le distributeur a dit qu'il ne les avait jamais reçues. J'ai totalement perdu la mise de ce qui avait été imprimé et ça m’a fait comprendre que la distance, sans personne qui représente la revue en France, ça allait être impossible. Je recentre alors sur l'Argentine, où je continue le projet, et ça m'amène à participer à Viñetas con Altura, un festival qui se faisait à La Paz. J’y rencontre un éditeur chilien, Carlos Reyes, scénariste de Nous les Selk’Nams, et Frank Arbelo, un éditeur cubain installé en Bolivie. On décide au cours de cette rencontre de créer une revue sud-américaine, parce qu'on se rend compte qu’aucun des pays sud-américains n'avait idée de ce qui se passait dans les pays limitrophes.
MCC : Ah oui, les pays n’étaient pas connectés ?
TD : Pas du tout. C'était très fermé, chacun sur soi, et puis tous à boire l'influence des États-Unis avec les comics américains – il n’y avait pas encore l'influence du manga. Et on s’est dit que c'était trop dommage, vu les scènes alternatives dans chaque endroit. Et donc à trois, on a travaillé. À l'époque, c'étaient les débuts d'Internet en Amérique du Sud, on faisait des chats sur ICQ.
MCC : Je ne sais pas ce que c’est ! (rires)
TD : Ben non ! C'est normal, c'est de l'archéologie ! (rires) Et on chattait des nuits entières sur ICQ à s'envoyer les noms d'auteurs, on s'envoyait par mail des pages d'exemple mais qui mettaient trois heures à passer… Fallait en vouloir. Et on a fait une revue qui s'appelait Suda Mery K. !, dans laquelle on arrivait à regrouper des auteurs d'Argentine, Bolivie, Chili, Pérou, Brésil, Colombie et qui a pas mal marqué, en Argentine. C'est devenu un peu une revue culte.
MCC : En Argentine et ailleurs, ou surtout en Argentine ?
TD : Ça devait se publier dans les trois pays en même temps. Mais ils n’ont jamais eu les thunes pour le faire et du coup c'est sorti qu’en Argentine. On a fait cinq numéros qui se sont pas ultra bien vendus. J’avais un « socio », un partenaire, qui mettait les thunes et qui était celui qui faisait les publications, et quand il a dit : « bon, on arrête les frais », il les a mis chez des soldeurs où elles se sont toutes vendues. Et c’est là qu’on a eu un retour du public qui était : « Ah mais c'est incroyable cette revue ! Quand est-ce que vous sortez la prochaine ? » Bah non, il y en aura plus, c'est fini, il fallait l'acheter au bon moment quand ça sortait et voilà. C'est pour ça que c'est devenu un peu culte : parce que ça a beaucoup circulé APRÈS sa diffusion, et avec des auteurs à l'époque totalement inconnus qui, aujourd'hui, sont devenus des auteurs majeurs sud-américains. On avait sorti par exemple Marcelo D’Salete, qui aujourd'hui sort chez Ça et Là, qui a gagné le prix Eisner. Mais en fait, on a été les premiers à le publier.
MCC : Donc tu étais tout seul en Argentine, mais ça a pu se faire parce que vous étiez aussi un réseau ?
TD : Ah oui, ça a pu se faire parce qu'on était trois et que chacun avait son propre réseau et qu’on faisait tous de la recherche d'auteurs. On prenait des récits courts qui avaient déjà été faits par ces auteurs-là et qui avaient pu être publiés au Brésil, au Pérou, etc., mais qui n'avait jamais circulé en Argentine, au Chili…
MCC : Ce n'était pas forcément des histoires inédites, mais ce qui était inédit, c'est qu'elles soient regroupées ensemble ?
TD : Ouais, tout à fait. Même si parfois on avait certains auteurs qui nous disaient : « ben non, je veux faire un truc spécial pour vous ». Aussi, dans cette revue-là, on faisait à chaque fois un focus sur un auteur de l'indépendant européen qu’on faisait découvrir au public sud-américain. On avait eu Thomas Ott, Miguel Brieva d'Espagne, Martin Tom Dieck d'Allemagne, le quatrième c'était Nicolas de Crécy, et le cinquième c'était Frédéric Bézian.
MCC : D’accord, donc c’était à la fois pour réunir les pays entre eux en Amérique latine mais aussi avec l'Europe ?
TD : Oui. Le premier quart de la revue, c'était l'auteur européen, quelqu’un de pas connu en Amérique latine, mais qui était déjà relativement connu en Europe. On prenait le temps pour une interview le présentant et une bande dessinée d'une vingtaine de pages. Ensuite, les cent et quelques pages suivantes, c'était que des auteurs latino-américains.
MCC : Comment ton entourage percevait tout ça ? Est-ce qu’il comprenait déjà que c'était professionnel malgré la distance ?
TD : C'était pas vraiment professionnel : ça ne l'a jamais été pendant longtemps parce que j’avais d’autres activités qui me permettaient de vivre. Ça, c'était vraiment par passion, par envie, et en faisant toutes les conneries que pouvait faire quelqu'un qui n'avait pas été formé au métier du livre.
MCC : Et ton autre activité, est ce qu'elle était liée à l'édition ?
TD : Pas du tout. J'ai donné des cours de langue et j'ai travaillé dix ans dans le marketing web. Pour revenir à ta question originale sur le festival : en fait, il apparaît de lui-même, à force de faire des actions culturelles autour de nos sorties, et notamment autour de la revue Suda Mery K!. Comme on présentait des auteurs européens, j'ai commencé à démarcher les différents instituts culturels à Buenos Aires : l'institut culturel espagnol ou encore les Allemands du Goethe Institut pour faire venir Martin Tom Dieck. On avait réussi à faire venir Miguel Brieva pour la sortie de la revue et ensuite de son bouquin, parce qu’en fait dans la revue, on présentait, et souvent la réponse des gens était suffisamment bonne pour qu'on sache qu'il fallait en sortir un bouquin. On a sorti un bouquin de Thomas Ott, on a sorti un bouquin de Miguel Brieva, mais quand on sort la revue où était présenté Martin Tom Dieck, le Goethe Institut prend note et nous dit : « non, nous on fonctionne pas comme ça : on fait venir des auteurs mais uniquement quand ça intègre toute l'Amérique latine », ce qui est hyper contraignant parce qu'il font venir des auteurs qu’ils font voyager partout. Donc le mec, il faut qu'il ait quasiment un mois de libre, et qu’il soit prêt à devenir esclave du Goethe Institut parce qu’ils te font venir mais c'est pour bosser ! C'est pas pour les vacances… Et l'année suivante en 2007, ils m'approchent séparément, autant les Espagnols que les Allemands et les Français – parce que j’avais été en contact avec eux, que je leur avais proposé des actions culturelles, on avait déjà bossé ensemble – pour me dire qu’ils ont envie de créer un festival de bande dessinée, et ils veulent que je m’en charge.
MCC : Ah, donc pas une commande mais presque ?
TD : Ouais, et donc la première qui m’en parle, c’est la directrice de l’Institut Culturel espagnol. Mon fils était sur le point de naître, ma femme était enceinte et je fais : « Ouais non, là c’est pas trop le moment... » Juste après, l’ambassade de France m’appelle. L’attaché culturel avait changé, c’était celui qui était en Bolivie au moment où se faisait le festival Viñetas con Altura, il avait envie de refaire la même chose à Buenos Aires et on lui avait passé mon contact. Du coup il m’appelle pour me dire qu’il veut faire le festival. Là je me dis : DEUX qui m'appellent…
MCC : Ça commence à faire…
TD : Voilà, et je lui dis : « je sais pas, je vais y penser, je vais y réfléchir ». Et juste après, le Goethe Institut m'appelle pour me dire : « on fait venir Martin Tom Dieck, vous nous aviez contacté l’année précédente, par contre il faudrait que ça se fasse dans le cadre d'un festival ». Là je me dis bon… TROIS en peu de temps qui m'appellent pour les mêmes choses... La troisième fois je dis : « Bon ok, on va faire un festival. Par contre ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez tous la même idée, donc on va tous se réunir et on va travailler ensemble. »
MCC : Et t’as été payé pour euh…
TD : J’ai été payé, mais la première fois c'était un petit festival et je ne savais pas faire, mais VRAIMENT PAS, j'avais aucune idée. J'avais créé l'association Viñetas Sueltas avec des potes qui étaient dans le monde de la bande dessinée et qui avaient envie de faire un festival. Et pour la première édition, chaque partenaire culturel avait mis 20 000 pesos [environ 5 000€ de 2024].
MCC : Ça correspondait à ce que tu voulais ? C’était plus, c’était moins ?
TD : Pas du tout, c'était moins, mais en même temps je ne savais pas comment dire combien je voulais. Ça a été malgré tout suffisant mais effectivement, pour que ça marche, il a fallu qu'on mette beaucoup d'énergie et de temps pour remplacer l'argent qu'il n’y avait pas. C'est nous qui avons fait les encadrements des expos, c'est nous qui avons fait plein, plein de trucs. J'ai découvert après qu'en fait, ben non ! On fait pas ça : on envoie, on engage des mecs spécialisés, on fait faire, ça se fait longtemps à l'avance. Alors que là, on a tout fait. Mais bon, c'était vraiment un festival né de l'urgence parce qu’ils étaient tous d'accord pour faire un festival : on s'est réuni en février ou mars 2008 et le festival s'est fait en mai !
MCC : Oh ! C’est très très court !
TD : Ah oui oui ! Non mais ça a été un truc…
MCC : C’est formateur en vrai ! (rires)
TD : Après, j’ai découvert aussi que c’était qu’en Amérique du Sud que ça peut fonctionner comme ça ! Il y a une dynamique là-bas où les gens sont moins cadrés qu’en Europe, c’est le mauvais côté. Par contre ils sont beaucoup moins procéduriers. Si ça doit se faire, ça se fait. Alors qu’ici, tu dis moins d’un an, ils sont là : « QUOI ? Ah ben non mais c’est pas possible ! » Là-bas, ça fait peur à personne. Le mauvais côté, c’est que si tu veux avoir un peu de prévisibilité, tu ne l’as pas. Quand tu dis un an à l’avance : « on va faire le festival, quel budget ? », on te répond : « Ah pff ! Ben on verra, on a le temps ! » Ah, d’accord mais… Donc voilà, ça s'est fait en deux trois mois, et ça a très bien marché pour ce que c'était. Mais ça a tellement bien marché qu’on a été obligé de changer d'espace dès la seconde année parce qu'on était au Centro Cultural Rojas et... en fait on a explosé le Centro Cultural. Donc ils nous ont dit : « on ne peut pas le refaire là parce que comme on veut que ça grandisse, il faut le faire ailleurs ». Alors on l'a fait au Recoleta où, grâce à l'ambassade de France qui avait ses entrées avec le ministre de la Culture de la ville de Buenos Aires, on a réussi à avoir la moitié de tout le centro cultural, et là ça a été un gros, gros festival, dans le sens où on a réussi, dès la deuxième année, à mettre et à agglutiner ensemble beaucoup d'institutions étrangères. La première année, c'était France, Espagne et Allemagne ; et la deuxième année on a réussi à y rajouter les Canadiens, les Italiens, les Suisses en plus des trois de base et on a réussi à avoir le directeur du festival de Montréal, qui est venu avec un auteur canadien. On a réussi à avoir un auteur suisse, on a réussi à avoir les directeurs du festival de Bologne en Italie qui sont venus avec trois auteurs italiens… On a réussi à avoir plusieurs auteurs espagnols avec une grosse expo espagnole, qui était une expo itinérante montée par les Espagnols pour la diffuser partout dans le monde et le premier endroit c'était à Buenos Aires pour ensuite faire tout le tour de l’Amérique du Sud. On a réussi à avoir Étienne Davodeau cette année-là, qui est venu avec une expo à l'Alliance Française, ça a été un gros festival et qui a tout démonté…
MCC : Ça t'est presque tombé dessus ? C'était pas une stratégie, t'avais pas particulièrement prévu de faire un festival, tu voyais pas forcément ça pour l'évolution de ta vie professionnelle ?
TD : Non, pas du tout. Et c'étaient deux choses séparées : il y avait la maison d'édition et il y avait les festivals.
MCC : Donc à ce moment-là, t’as arrêté tous tes boulots ?
TD : Pas du tout. Parce que le festival ne me rapportait quasiment rien. C’était un moment où, en Argentine, demander un salaire pour la culture, c'était presque : « Quoi ? Mais tu fais ce que tu aimes, je ne comprends pas pourquoi tu veux qu’on te paye ? » Et donc c'était presque un tabou qu'il fallait lever, c'était dire : « Non mais les mecs, si je fais ça, il va falloir que je sois payé ! »
MCC : C’est beaucoup d'heures de travail !
TD : Ouais, et d'ailleurs ce festival 2009, c'est pareil : on avait fait avec des bouts de ficelle. Par chance, on était nombreux dans l'organisation et on avait tous bossé à fond.
MCC : Oui, vous vous êtes entraidés. Tu faisais toujours partie du même milieu que tu avais connu en rentrant dans le monde de la bande dessinée en Argentine ?
TD : Ouais, alors ça avait évolué entre 2008 et 2009 parce qu'il y en avait certains qui s'étaient épuisés sur le festival 2008, et qui étaient des auteurs et qui ont dit : « ben en fait c'est génial, mais nous on a envie d'en profiter en tant qu'auteurs et on se sent pas l'âme d'organisateurs ». Donc on a reconstitué un noyau d'équipe qui était finalement moins des auteurs et plus des gens qui gravitaient autour de la bande dessinée. On était trois éditeurs, deux graphistes et puis des lecteurs qui, après le premier festival, se sont présentés pour dire : « nous on veut vous aider et être volontaires ». Au final on était une dizaine, et on a fait beaucoup pour compenser le manque d'argent.
MCC : Et le festival a duré longtemps ?
TD : Ce qui a été surprenant, c’est que comme tout est politique en Argentine, on a froissé je ne sais pas qui, j'ai jamais pu savoir. Le centre culturel où on avait tout explosé les quatre jours du festival, on y est allé en se disant : « on a eu la moitié, maintenant on va avoir le centre culturel entier ». Et en fait on a eu un rendez-vous assez surprenant avec le directeur du centre qui nous a dit qu’il nous donnait seulement deux salles.
MCC : Donc moins que ce vous aviez eu avant ?
TD : Ouais… Et là on a dit : « ça va pas être possible ». Et donc on est parti sur une autre formule parce qu'on n'a pas réussi à trouver un grand endroit. On a fait ce qui s'est appelé « la Semana Suelta de Viñetas ». Au lieu d'être le festival Viñetas Sueltas, c'était une semaine d'activités avec des auteurs internationaux, dans plein d'endroits différents dans la ville. Ça n’a eu lieu qu’une seule fois.
MCC : Donc l’événement n’a pas survécu d'une manière ou d'une autre ?
TD : C'est compliqué. En 2010, on fait la Semana Suelta de Viñetas, où on fait venir pas mal d'auteurs étrangers. On avait pu travailler avec les Américains et faire venir Peter Kuper. On travaillait encore avec les Français et les Espagnols, etc. On a fait venir pas mal de monde comme ça. Sauf que c'était éclaté dans la ville, et on se rend compte que ça n’a fait venir du monde que pour les auteurs connus. Et comme les auteurs connus, c'étaient des auteurs argentins, les salles, les activités ou les expos n’étaient remplies que pour eux. Les auteurs moins connus comme Peter Kuper n’avait finalement que peu de monde. Ce n'était pas du tout ce qu'on voulait faire : nous, ce qui nous plaisait avec le festival, c'était que les gens viennent pour un truc et repartent avec un autre. Cette espèce d'idée de faire transvaser les connaissances, les cultures, etc. Ce qu’avaient adoré plein de personnes au festival Viñetas Sueltas en 2009, c'était d’être venues, je sais pas, pour Liniers, qui était l'auteur argentin le plus connu à ce moment-là, et d’être reparties complètement hallucinées par l'expo des Italiens ou le travail des auteurs belges. Et on s'est rendu compte que si c'était pour faire cette formule-là [de 2010], on préférait arrêter. Donc en 2011, on se retrouve de nouveau avec le problème d'espace. C'était l'année de naissance de mon second fils. On se retrouve à batailler avec les institutions étrangères qui nous disaient : « Mais si, il faut le faire ! » Et nous, on ne voulait pas, on ne l'a pas fait. C’était pour dire : si c'est ça, on préfère ne pas le faire. Et en 2012, on était partis pour faire un festival low cost ultra indé, où on allait se centrer sur les Argentins et les Sud-Américains. On avait retrouvé un endroit où le faire, et puis d'un seul coup arrive la surprise. L'État argentin avait créé en 2010, pour le bicentenaire de la révolution, Tecnópolis, qui est l'équivalent du Futuroscope on va dire… Et ça avait tellement fonctionné que, un peu comme la tour Eiffel, ce qui devait durer très peu est devenu un parc permanent. Ça s’est pérennisé, ça a grandi, sauf que pour le faire fonctionner toute l'année, il leur fallait des activités. Ils ont commencé à penser à de nouvelles activités, dont des festivals. Et il leur vient l'idée d’en faire un de bandes dessinées. Quelqu'un leur dit : « ben, il faut en parler avec Viñetas Sueltas, parce qu'ils sont en train de préparer un festival », alors viennent nous voir. Et là par contre, c'est l'inverse de ma première réunion. J'y vais en disant : « je veux tant, sinon je le fais pas ». Là, le mec me fait : « C'est tout ? Bon ben, ok ! » J’aurais dû demander le double ! (rires) C'est la première fois où j'ai vraiment été payé pour faire l'organisation d'un festival.
MCC : C’était plus en avance aussi peut-être ? Pas trois mois avant ?
TD : Ça s'est pas fait hyper longtemps à l'avance parce qu’en fait, ces cons, ils sont venus nous voir en cours d'année. En revanche, ils ont bénéficié du fait que nous, on avait déjà commencé à travailler sur l'organisation de notre festival. La seule chose qui changeait c’était le lieu et les moyens, du coup on pouvait penser à faire venir plus d'auteurs. C'était donc en 2012 et c'est quasiment le dernier festival Viñetas Sueltas qui a lieu. Ça a bien marché et Tecnópolis nous dit : « On veut que vous continuiez à garder la main sur la programmation, etc. Par contre, on veut faire grandir le festival, et pour ça c'est nous qui allons nous charger de la partie budgétaire. » Parce que quand on avait travaillé avec eux, on s'était chargé de faire toute la partie budgétaire, recherche de sponsors et d'institutions, etc. À partir de 2013, ça change de nom ça devient Comicópolis. Et à partir de là, c'est l'État qui assigne un budget. Nous, on avait juste à passer commande, et ils nous disaient : « ça rentre, ça rentre pas ». On n’a jamais su quel était le budget total. On en avait une idée mais on ne savait pas vraiment...
MCC : Vous deviez faire sans savoir, mais en fonction de ça quand même ?
TD : On leur disait : « On va faire venir un auteur des États-Unis, on veut faire venir deux auteurs du Brésil, un auteur français, un auteur espagnol. » On présentait des noms, on présentait des projets d'expo, on avait un peu carte blanche là-dessus et ensuite ils nous disaient : « c'est possible, c'est pas possible ». Mais on n'avait pas la main sur combien coûtait le festival parce qu’il y avait beaucoup de frais engagés par le parc Tecnópolis qui mettait en place sa main d’œuvre, qui mettait en place ses producteurs d'événements qui se mettaient à notre disposition le temps du festival, mais qui après bossaient sur un autre festival et ainsi de suite, qui mettait à disposition leurs assurances… Tout ça c’était des frais qui étaient englobés dans le cadre de ce parc Tecnópolis et qui venaient se greffer sur notre festival, et puis après sur un autre.
MCC : Peu à peu, c’est eux qui ont récupéré le festival ou est-ce que maintenant, il n’existe plus ?
TD : Alors j'en reviens à « tout est politique en Argentine ». On a fait 2013, 2014, et 2015. L’édition 2015, c'est l'année la plus forte puisque c'est celle où on fait venir Art Spiegelman. Je crois que ça a été l'équivalent de quasiment 200 000 entrées. C'était un peu bizarre parce qu’on ne savait jamais vraiment combien était venus pour notre festival, et combien venaient pour le parc. Parce que le parc, c'était un ensemble. Mais c'était aussi la question intéressante : on avait un public qui n'était pas amateur de bande dessinée, qui venait pour le parc, qui découvrait qu'il y avait un événement de bande dessinée, qui s’y intéressait pour la première fois et qui achetait des BD pour leurs enfants dans le cadre du festival. Ça, c'était vraiment bien. Et après on a su que de toutes façons, il y avait plein de monde qui était venu pour notre festival parce que, quand on a fait l'interview d’Art Spiegelman sur sa carrière dans un amphithéâtre de 2 000 personnes, on a dû refuser du monde. Il y avait plus de 2 000 personnes, il y en avait dans les travées, les escaliers étaient remplis… En fait on avait prévu de le faire dans une salle de 600 personnes et on a commencé à voir le monde qui venait. Par chance, le parc avait cette ductilité et cette possibilité de faire des changements sur le moment. Ils ont dit : « on ne le fait pas dans la salle de cinéma, on le fait dans la salle de 2 000 ». La salle de 2 000, qui a été pleine, avec du monde rejeté à l'extérieur. Donc on a su qu’il y avait quand même beaucoup de monde qui était venu pour le festival et pas juste des personnes qui étaient de passage. Ceux qui étaient de passage par contre, n’assistaient pas aux conférences. Ça a duré jusqu'en 2015. En 2015, à la fin de l'année, il y avait des élections et ça a été un changement de signe politique. On espérait qu’en 2016, on allait pouvoir refaire le festival parce que ça avait suffisamment bien fonctionné pour qu'ils aient envie de le refaire. Sauf qu’on était marqués du signe de l'autre politique, alors qu’on s'en foutait. Au bout d'un moment, ils ont coupé les conversations, ils ne nous ont plus répondu et on a compris. Donc en 2016, on a refait un festival Viñetas Sueltas, on a réussi à rebondir chez un autre partenaire de l'État, et en 2017 on a fait à la fois un festival Viñetas Sueltas et un festival Comicópolis, les deux dans l’année. Entre-temps, celui-ci était devenu privé. On a essayé d'en faire un festival avec entrée payante, alors qu'avant l’entrée était gratuite, et ça relativement bien fonctionné : on a fait un peu plus de 12 000 entrées je crois. Mais c'était pas assez par rapport aux frais engagés et on s'est rendu compte que ça allait être très dur de faire comprendre aux gens que Comicópolis était devenu payant, parce que dans leur tête c'était gratuit. Il y avait même des gens qui, sur les réseaux sociaux, s'énervaient : « Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est devenu payant ? » Par chance, il y avait d'autres internautes qui répondaient : « Parce qu'il y a eu un changement politique... » On n’avait pas besoin de répondre mais on a compris qu'il y avait quand même une frustration de certaines personnes et ça a été la dernière fois.
Après, l’Argentine est rentrée dans un cycle de crise néolibérale extrême, avec un gouvernement qui ne croyait plus en la culture, qui a même dégradé le ministère de la Culture en secrétariat de Culture… Plus ça allait, moins il y avait de moyens, donc on a compris que c'était fini.
MCC : Justement, est-ce que tu as été confronté à la censure ? On dirait que c'est pas forcément la censure mais… des refus un peu brusques ou des changements politiques, mais frontalement on t'a jamais dit : « non ça c'est pas possible pour des raisons politiques » ? Ça a toujours été un petit peu souterrain ?
TD : Non, on n'a jamais eu de censure. On a même fait des trucs qui ont choqué d'un bord ou de l'autre, mais on n'a jamais eu d'interdits et on n’a jamais eu de censure proprement dite. Par contre, on a souffert des va-et-vient politiques. Mais c'est pas vraiment de la censure : il y a cette espèce de table rase qui a lieu à chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, et comme on était associé à un type de politique en Argentine, on a compris qu'on ne faisait pas partie de la nouvelle équation.
MCC : Vous avez plutôt souffert du manque de continuité ?
TD : Oui, tout à fait.
MCC : Faire ce festival, c'était principalement ton activité par rapport à la BD ?
TD : Ouais, c'était vraiment ça. En parallèle, j'ai toujours édité des BD en Argentine. La période Suda Mery K.! et la période de la revue Ex Abrupto se sont terminées parce que j'ai commencé à publier des récits complets de bandes dessinées d'auteurs : certains d'Argentins, certains liés à la revue Suda Mery K.! avec des Européens. Ça a correspondu au moment du renouveau de l'édition en Argentine, avec l’apparition de jeunes maisons d'édition comme Loco Rabia, Hotel de las Ideas, Historieteca. Ça s'est fait entre 2005 et 2007-2008.
MCC : D’accord ! Je pensais que c’était beaucoup plus ancien.
TD : Non. Je crois que la plus ancienne, Loco Rabia, c'est 2005. Elles se sont directement positionnées sur le fait de publier de jeunes auteurs argentins et j'ai senti que mon rôle était plus légitime dans l'édition d'auteurs européens, et de faire découvrir ces auteurs-là. Je me suis mis à publier des livres dont on achetait les droits.
MCC : C’est-à-dire ? Des livres européens dont vous achetiez les droits pour traduire en espagnol et publier en Argentine ?
TD : Ouais, donc, par exemple, j'ai fait Smart Monkey de Winshluss, j'ai fait Comme une rivière, de Pierre Wazem, j'ai fait Thomas Ott, un peu comme ça. Et puis des auteurs dont on accompagnait la venue dans le cadre du festival et dont les œuvres n'étaient pas publiées en Argentine, et on se disait : « tiens, vu qu'il vient, c'est un bon moyen de faire ». Dans ce cadre-là, on a publié Ivan Brun et Jason. On a fait à chaque fois en fonction de ces auteurs-là, qui pouvaient mobiliser les ventes de ces livres.
MCC : Mais tu ne dépendais pas d'une maison d'édition en particulier ?
TD : C'était ma maison d’édition qui s'appelait d'abord Ex Abrupto, puis elle a muté et elle s'est appelée « 2D ». C'était parce qu’il y a un pote qui est venu m'aider et lui, il n’avait pas envie que ça s'appelle Ex Abrupto. Je lui ai dit : « Comment tu veux qu’on s’appelle ? » Lui, il s’appelait Dominguez, moi Dassance : 2D ? Allez hop, c’est parti ! Donc oui, j'ai continué à publier de la bande dessinée, tout en faisant les festivals.
MCC : Est-ce qu’il y avait au festival quelque chose pour visibiliser la bande dessinée argentine par rapport aux États-Unis ou ça n’entrait pas dans l’équation ? Comment perceviez-vous les États-Unis ?
TD : L’idée du festival Viñetas Sueltas, comme le festival Comicópolis, a toujours été de montrer la bande dessinée sous toutes ses latitudes et sous toutes ses formes. Donc on a toujours essayé d'avoir tous types de bande dessinée. Avec Viñetas Sueltas, on était plus axé sur la bande dessinée indépendante, mais de partout dans le monde. C'est pour ça que dès 2010, on a fait venir Peter Kuper des États-Unis. C’est un auteur à la fois indépendant et grand public parce qu'il a publié Spy vs. Spy dans la revue Mad que plein de monde connaissait, mais qui avait fait à côté de ça le Journal d’Oaxaca sur les révoltes au Mexique, qui avait fait l’adaptation de La Métamorphose de Kafka, etc. Et quand on arrive avec Comicópolis à avoir beaucoup plus de moyens, là on se dit qu’on peut s’ouvrir à encore plus de choses ! On continuait à faire des focus sur la bande dessinée indépendante, mais on a aussi fait venir des grands auteurs de comics américains : le scénariste Peter Milligan, Keith Breyfogle, dessinateur classique de Batman des années 1990, Howard Chaykin, qui a été un grand dessinateur de super-héros aux États-Unis…
À côté de ça, on a fait venir un contingent d’auteurs indépendants complètement inconnus d'Europe du Nord dans lequel il y avait une dessinatrice suédoise, un dessinateur danois, une dessinatrice finlandaise et où on montrait donc encore tout à fait autre chose. On a fait venir un contingent de Chine, de manhua chinois ; on a fait venir Spiegelman d'un côté, mais après on a fait venir Thomas Ott ; on a fait venir des auteurs espagnols comme Max, qui est plutôt indépendant mais à la fois très connu par rapport à la revue El Víbora dans laquelle il publiait… On a vraiment essayé de toujours mixer et mélanger parce que ce qu'on voulait, c'était montrer tout type de bande dessinée. Et ce qui nous intéressait, c'était ce mix : c'était que le mec qui vient pour Keith Breyfogle parce qu'il est fan du Batman des années 1990 reparte en se disant : « Putain mais Thomas Ott, c’est génial ce dessinateur ! » Qu’il y ait des espèces de passerelles, de liens, et avec un gros espace éditeur. On a toujours voulu que tous les éditeurs qui existaient en Argentine et en Amérique latine et qui voulaient venir participer puissent avoir un stand.
MCC : C’était un festival d’éditeur sans libraire ou il y avait les deux ?
TD : On avait fait le choix d'éviter les libraires donc c'était que des éditeurs. On avait tout un secteur fanzine assez énorme, on avait tout un secteur éditeur et on faisait venir, chaque fois qu'on pouvait, des éditeurs latino-américains, pour qu’ils soient présents.
MCC : Qu'est-ce que tu penses des prix et des jurys ? Vous avez monté un prix latino-américain ?
TD : Je n'y suis pas spécialement attaché. Je pense qu'il faut une finalité bien claire pour que ça vaille la peine. Par exemple, quand on faisait Viñetas Sueltas, on n’avait volontairement pas de prix. On s'était posé la question : « Est-ce qu'on veut en faire ? Non, bon. » Quand on a fait Comicópolis, on a essayé de faire un prix… Malheureusement, on n’a pas réussi à trouver le socio, le partenaire dont on rêvait. On s'était intéressé à ce qu'avait fait à l'époque Sinsentido je crois, en Espagne, qui avait fait un prix Fnac Sinsentido pour lequel ils récompensaient une création avec un achat de livres par la Fnac et un accompagnement, où ils faisaient tourner l'auteur partout en Espagne. On s'était dit : « ça c'est plus intelligent ». Mais nous, c'était pas un prix à la création, nous c'était un prix qui voulait récompenser la meilleure édition étrangère, la meilleure édition nationale et la meilleure édition jeunesse : donc un prix avec trois catégories et qui était couplé d'une obligation d'achat par une chaîne de librairies. Sauf que cette chaîne de librairie l’a fait sans comprendre la portée que ça pouvait avoir. Ils l’ont toujours fait plus comme une faveur politique qu’ils rendaient à Tecnópolis, presque par obligation parce qu'ils avaient un gros contrat avec eux qui leur permettait d'avoir une librairie sur place. Il ne se sont jamais dit : « ça peut vendre si on en achète deux cents et que les deux cents, on les accompagne ». C'est pour ça que c'est dommage : ça n’a jamais eu la portée que ça aurait pu avoir. Pour moi, il faut que ça ait une finalité claire : nous, c'était une finalité assez politique finalement, dans le sens de politique-éditoriale-nationale : de vouloir appuyer les éditions nationales de matériel acheté à l'étranger (la publication étrangère), de jeunes auteurs publiés dans le pays (national) et pour la jeunesse, et essayer de faire en sorte qu’une chaîne de librairie porte le projet à l'échelle du pays. C'était pour essayer de vraiment rompre certaines barrières liées au marché argentin, qui n’a rien à voir avec le marché français.
Quand on a décidé de faire le prix latino-américain, c'est parce qu’on s'est rendu compte que si on n’allait pas chercher les œuvres qui nous intéressaient, les œuvres qui nous étaient proposées étaient rarement enthousiasmantes. On recevait des choses qui étaient moyennes, voire très mauvaises, et sachant le vivier qu’il y a en Amérique latine, on s'est dit : « c'est peut-être parce qu'il faut qu'on se fasse connaître, et puis qu'il faut stimuler ». Mais n’être les seuls qu’à le faire (la maison d’édition iLatina), ça aurait ressemblé à un prix qui était un déguisement d'achat de droits, alors qu’on avait envie qu’il y ait une vraie dimension latino-américaine. En travaillant avec des maisons d'édition argentines et brésiliennes, ça permettait d'avoir des acteurs locaux qui portent le projet et qui allaient pouvoir avoir une meilleure communication, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Et puis, ça permettait aussi de faire un prix plus important tout en étant tous des petites structures. L’éditeur brésilien me disait que notre prix était meilleur que le prix Amazon au Brésil par exemple. Ça nous a fait plaisir ! Ah ben tac, tiens on a niqué Amazon : on est contents ! (rires) Ça a été enthousiasmant. Maintenant, il faut qu'on s'y recolle. Mais là, avec Angoulême et tout ça, c'est passé à la trappe, donc ça viendra post-Angoulême. On a reçu l'équivalent de 300 projets, de 12 pays différents… Et c'était une première fois ! On a reçu vraiment plein de bons trucs. Si j'avais pu en publier plus, ce n’était pas deux, mais six livres qui m'intéressaient !
MCC : Donc l'objectif a été plus qu’atteint !
TD : C'est pour ça je parle de finalité : ce n'était pas pour rompre, au niveau des dynamiques locales, avec les problèmes de distribution. Pour nous, c'était pour accéder à un autre type de matériels et de projets qu'on n’avait pas l'habitude de voir ; et de le faire avec des latino-américains, parce que je n'oublie pas que j'ai vécu là-bas, que je suis en contact avec eux et que j'ai encore envie de formuler des projets avec eux pour les aider et qu’ils nous aident en contrepartie.
MCC : Donc finalement la distance n’a jamais été un problème ? Ou ça a été à la fois une force et un problème ?
TD : Ça l’a été au tout début et aujourd'hui ça l’est de moins en moins.
MCC : Maintenant qu’il y a les réseaux et que tu as ton réseau, c'est facilité.
TD : Les médias et les moyens de communication se sont aussi améliorés. Aujourd'hui, envoyer des livres à imprimer, ça peut se faire depuis n'importe où : on peut recevoir des pages scannées en très haute résolution, etc.
MCC : Est-ce que le fait d'être dans le milieu de la BD t'a engagé pour des choix plus politiques ou est-ce que tu as toujours essayé de t'en détacher ? Est-ce qu’il y a certaines choses qui étaient, pas forcément militantes, mais qui t'ont engagé sur le point de vue politique, volontairement ou non ?
TD : Non… jamais de m’en détacher, par contre j’ai toujours été assez clair sur les choses politiques qui m'intéressent et essayer de les retrouver, que ce soit dans mes choix éditoriaux ou dans mes choix au niveau festivals. Mais je ne pense pas que ça m'ait fait bouger là-dessus. En revanche, il y a des rencontres qui ont pu renforcer ou m’apporter d'autres visions de tout ça, étoffer.
MCC : As-tu vu une évolution de la bande dessinée par rapport au début, quand tu as commencé ?
TD : En Argentine, ça a énormément évolué. Forcément, puisqu’on est parti d'un degré zéro de destruction totale à, aujourd'hui, un panorama quand même beaucoup plus riche et fourni, avec des éditeurs qui sont en train d'approcher des 20 ans d'existence et commencent donc à avoir un catalogue assez étoffé. Et après, en France, c'est comme si j'avais eu un hiatus. Je suis parti fin des années 1990, j'étais branché sur un type de bandes dessinées indépendantes qui ont connu leur heure de gloire dans les années 2000 et qui aujourd'hui ont un gros problème, c'est que les grosses ventes des blockbusters de l'indépendant sont aujourd'hui chez de gros éditeurs. C’est très difficile qu’il y ait aujourd'hui un Marjane Satrapi qui ait lieu chez l'Association, parce qu’en fait ce genre d'auteur-là sont maintenant chez des gros éditeurs.
MCC : L’amateur s’est professionnalisé.
TD : Voilà. Les professionnels se sont rendu compte que : « Ah bah, il y a aussi cette part de marché qui nous échappe ! Alors qu'on pourrait l'englober. » Dans le spectre des gros éditeurs, ils ont aussi fait rentrer des auteurs qui n’auraient pas dû être chez eux, et qui aujourd'hui font leur carrière chez eux… Une marge qui s'est resserrée pour les petits éditeurs, avec moins d'espace en librairie, moins de place pour arriver à faire des œuvres qui vont toucher un large public – parce qu’on publie en moins grande quantité. On a moins d'espace en librairie, on a moins de temps, et donc voilà. C’est beaucoup plus difficile. Tous les éditeurs que je connais des années 2000 disent : « ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était ». Rackham dans les années 2000 et aujourd'hui, c'est pas du tout la même. L'Association, c'est pareil. Ce sont des éditeurs qui ont connu l'époque de gloire de l'édition indépendante et qui, aujourd'hui, se rendent compte que c'est…
MCC : … Un peu amer.
TD : Ce n’est pas pour rien que Rackham a décidé de faire une année sans publication ! C'est, entre autres, parce qu’ils ont vu cette évolution et qu’ils se sont demandé comment repenser la distribution. Ça semble très risqué, mais c'est intéressant : c'est l'idée de refuser cette course perpétuelle en avant à la nouveauté dans lequel le fond d'une maison d'édition ne travaille quasiment plus aujourd'hui. Donc ils se sont dit : « on va prendre un an de pause pour essayer de réfléchir à une autre manière ». Je ne sais pas s’ils arriveront à trouver autre chose, mais voilà.
Pour aller plus loin
Entretiens bédéphiles