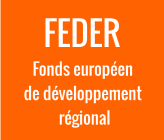Philippe Morin - Entretien bédéphile
Retranscription de l’entretien avec Philippe Morin, mené par Juliette Zeys, étudiante en master 2 « Bande Dessinée : Edition, Théorie et Critique » de l’université Bordeaux Montaigne, durant l'année scolaire 2022-2023.
Juliette Zeys : Comment est-ce que vous en êtes venus à vous intéresser à la bande dessinée ?
Philippe Morin : Vous aviez accès à très peu de moyens d'évasion quand vous étiez enfants dans les années 1960, autres que la culture officielle ou le cinéma ou les choses comme ça. Donc, si vous aviez envie de faire des choses pour le plaisir d'un petit garçon, fatalement vous étiez lecteur de bande dessinée. Il y avait une profusion dans le paysage éditorial de la bande dessinée. Les librairies n'en n’avaient pas, ou très peu, à part les albums de Tintin. En revanche, dans les kiosques, les marchands de journaux, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, la presse bande dessinée était colossale et foisonnante. C'était plusieurs centaines de millions d'exemplaires vendus chaque année. Ça allait des célèbres hebdomadaires que tout le monde connaît, c'est-à-dire Le Journal de Spirou, Tintin, Pif Gadget, Mickey et ce genre de choses, qui s'adressaient plutôt à des jeunes de 7 à 15 ans, à la presse des petits formats, qui étaient des mensuels. Les petits formats faisaient surtout de la traduction de bandes dessinées venues d'un peu partout – Suisse, Italie, Espagne Angleterre, etc. – qui étaient remontées, traduites, pas souvent très bien dessinées. Les scénarios n’étaient souvent pas très bien traduits, mais il y en avait pour tous les lectorats, y compris les filles. Et il y avait des revues de bandes dessinées pour les filles. L'Église catholique en France était un vecteur important de diffusion de bandes dessinées, qui faisait très attention au contenu moral et qui avait une diffusion à la fois en kiosque mais aussi dans les églises. Le dimanche, en sortant de la messe, parce qu'à l'époque, je ne sais pas… la moitié des Français allaient à la messe tous les dimanches, vous pouviez acheter des revues de bandes dessinées. C'était un peu la récompense des gamins catholiques qui fréquentaient l'église. On était dans cette espèce de profusion de bandes dessinées et vous aviez toujours dans votre école, dans votre collège, des copains qui étaient des grands lecteurs de bandes dessinées. Forcément, les discussions se faisaient beaucoup sur le thème de ce que vous aviez lu. Si on lisait le même journal, on en évoquait le contenu toutes les semaines : les histoires à suivre, ce qu'on supposait qu’il allait se passer, on commençait à s'intéresser au style des gens, etc. Moi, j'avais une mère qui n’était pas du tout opposée à ce que j'en lise, et en plus à chaque fois qu'on partait en vacances, j'avais le droit d'acheter des Lucky Luke dans la collection souple de chez Dupuis. Il y avait évidemment tous les Astérix et tous les Tintin à la maison, et elle m'avait abonné au Journal de Tintin. Donc j'étais un énorme lecteur de bande dessinée ; je m'achetais en plus avec mon argent de poche d'autres revues. C’était presque la totalité de mon temps libre, à part aller au cinéma, me balader. Je n'étais pas du genre sportif, je n'avais pas beaucoup de copains, à la place, je bouquinais, et je lisais aussi beaucoup de vrais livres. Dans les années 1960, au niveau de l'éducation nationale, il y a des inquiétudes très fortes sur ce déferlement de bandes dessinées dans les kiosques, qui risquent d'amener les jeunes à arrêter de lire des vrais livres, pour ne lire que de la bande dessinée. Evidemment, vingt ans plus tard, les études qui ont été faites ont montré que c'était parfaitement faux. Parce qu'en fait les lecteurs de bandes dessinées enfants et adolescents sont par ailleurs des gros lecteurs de livres.
JZ : Oui c'est vrai.
PM : C’est cette espèce d’univers que vous n’imaginez pas, parce qu’aujourd’hui dans les kiosques, s’il y a trois revues de bandes dessinées… Aujourd'hui les bandes dessinées sont dans les librairies spécialisées, mais à l'époque elles étaient partout, parce que des kiosques il y en avait dans la rue, il y en avait dans les magasins, il y en avait partout. Pour ceux qui avaient des parents qui lisaient France soir, le journal avait tous les jours une page de bande dessinée, et on était dans un grand quotidien. Il y avait aussi beaucoup de bandes dessinées dans la presse quotidienne régionale et nationale. Moi, du fait que j'habite à Paris, je commence à m'y intéresser parce que je trouve dans une librairie la revue Phénix, qui était la première revue sur la bande dessinée (note : Giff-Wiff est en réalité lancé quatre ans auparavant, en 1962), et dont vous avez peut-être entendu parler. Et dans Phénix, il y a une publicité pour la convention de la bande dessinée qui avait lieu tous les ans, au mois d'octobre, à la Mutualité à Paris, dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement. J’ai tanné ma mère pour qu'elle m'y emmène et j'y suis allé à partir de 1972. Aujourd'hui, on est en 2023, et mon premier festival BD c’était en octobre 1972 : ça fait 51 ans que je vais dans des festivals de bande dessinée à travers le monde. Je dis souvent que l'un des intérêts pour la bédéphilie vient aussi de sa facilité d'accès. Quand je vais dans cette convention, à 12-13 ans, je vois des dessinateurs, je vois des gens, des messieurs – la plupart c'était des messieurs, il y avait très peu de femmes – derrière des tables, et ils font des dessins sur des feuilles. Comme il n’y a pas encore beaucoup d'albums, les dessinateurs acceptent de vous faire des dessins gratuitement, des dédicaces mais assez poussées parce qu'il n’y avait pas beaucoup de monde. Donc, le jeu, c'est que j’achète un carnet de feuilles de dessin de Canson format A4 ou un peu plus grand et je fais la queue pour me faire faire des dessins. J'apprends forcément qui sont les dessinateurs – en plus, il y avait souvent des posters qui indiquaient de qui il s'agissait et quel héros il dessinait – et très vite je ne m'intéresse pas à trop au héros proprement dit mais à la personne derrière le héros, c’est-à-dire au dessinateur, au créateur. Après, comme ma mère en a marre d'y aller, j’y vais avec des copains de mon collège. On y va à trois et le but du jeu les premières années, de 1972 à 1975, c'est de réunir le plus de dédicaces dans ces conventions de bande dessinée. Il y avait un festival à Clichy, qui était très important à l'époque. Clichy c'est en banlieue nord de Paris et c'était très facile d'y aller en métro, donc là aussi on peut se balader pour aller voir des dessinateurs de BD et puis évidemment on discute avec eux, et un dessinateur nous demande d'où on vient. J'habitais en banlieue parisienne aussi, mais à l'opposé de Clichy, à Montrouge, côté Porte d'Orléans sur la ligne 4. J'explique que j'habite là, et le dessinateur de La Jungle en folie dans Pif Gadget, Mic Delinx, me qu’il habite aussi à Montrouge. Évidemment, on lui demande si on peut venir le voir. On se demandait quand même comment tous ces gens travaillaient, s'ils avaient un bureau avec des secrétaires et le dessinateur qui avait un énorme bureau et tout ça. Il nous dit oui, pas de problème, et on prend rendez-vous. Quand on avait identifié des dessinateurs de BD, le jeu c'était de trouver des bottins téléphoniques de Paris ou des communes de banlieue et de chercher leur nom. À l'époque, aucun dessinateur n'était sur liste rouge parce que personne ne s'intéressait à eux, c'étaient des gens qui n'étaient pas médiatisés, qui étaient dans un anonymat complet. On a eu la chance de rencontrer ces dessinateurs qui étaient absolument épatés de mettre des visages sur leurs lecteurs, parce qu'ils ne les avaient jamais rencontrés. Les tirages de cette presse de bande dessinée feraient pâlir n'importe quel éditeur aujourd'hui : Pif Gadget, c'est 500 000 exemplaires imprimés et quasiment vendus toutes les semaines ; Tintin c'est 200 000 exemplaires ; Spirou c'est 200 000 exemplaires ; Le Journal de Mickey c'est au moins 450 000 exemplaires. Quand vous prenez une génération de jeunes Français, sur une année donnée, fatalement ce sont des lecteurs de bande dessinée. Les dessinateurs savaient qu'ils avaient beaucoup de lecteurs parce qu'ils voyaient bien que leur journal marchait, que leur série dans les référendums était appréciée, mais ils ne mettaient pas de tête dessus. Quand ils mettent la tête sur un petit ado qui vient les voir, ils sont ravis.
Donc on rencontre ce dessinateur, on va chez lui et c'est sa femme qui nous ouvre. Et puis on s’aperçoit que c'est un appartement, que le gars y dessine, que ça n’est souvent pas très grand, et on comprend que tout ce monde qui nous a fait rêver en bande dessinée est produit sur une petite table avec une chaise et un monsieur qui dessine dessus, dix heures par jour, pour être publié dans le journal. On voit le côté artisanal, le côté bricolage, le côté complètement sans prétention. Ça, c'est très important parce que les dessinateurs ne pouvaient pas avoir de prétention d'être des artistes. C'était des artisans, qui se débrouillaient pour vivre de la bande dessinée parce qu'ils aimaient dessiner.
Je vois tout ça dans les conventions, et je m'abonne à des fanzines. Je rencontre José-Louis Bocquet qui était un peu plus jeune que moi mais qui avait déjà publié des fanzines. José-Louis Bocquet, c'est un scénariste qui a été longtemps directeur de collection chez Dupuis, c'est quelqu'un d'important aujourd'hui sur la scène de la BD. À l'époque c'est un ado qui est plus jeune que moi mais plus impliqué, parce qu'il a déjà fait un fanzine qui s'appelle Bizu et je m'abonne à ce journal. Je me dis évidemment qu’avec mes copains on va faire pareil. Ça a l'air d'être complètement con de faire un fanzine, il suffit de trouver un moyen d'impression et puis vous racontez vos envies. Je dessinais, aussi, j'avais la prétention de faire de la bande dessinée dans mon coin.
La bédéphilie apparaît un peu comme ça, très naturellement, pour les gens de ma génération. Je publie mon premier fanzine au collège quand j'ai 15 ans : un fanzine que je distribue, que je n'imprime pas, parce que je n'ai pas encore compris comment on peut imprimer. Ce sont les originaux que je fais circuler dans le collège et les gens lisent et nous les rendent après… dans quel état, je ne vous raconte pas le résultat. Mais on diffuse à notre façon, localement, notre premier fanzine. C'était inspiré du logo de Pilote qui était très pompé à l'époque. On copie parce qu'on a des modèles, et puis pour apprendre. C'est bien le principe de l'artisanat par rapport à l'art : la grande différence c'est que l'artisanat est un métier de copiste. Dans le bâtiment, les tailleurs de pierre apprennent à tailler les pierres en regardant les tailleurs de pierre, pas en regardant des livres ou en inventant des motifs.
Tout ça fait que les années 1970 s'écoulent très vite. Quand je suis en première, je fais mon premier fanzine imprimé en ronéo, tiré à 200 exemplaires. Le fanzine s'appelle Phylactère, je fais ça en parallèle de mes études. Le deal avec les parents, c'est que ça n'ait pas d'incidence sur mes études et bon, j'arrive à passer le bac tout en faisant ce fanzine qui marche bien aussi. Deux-cents exemplaires pour un fanzine totalement inconnu, dont le contenu est pathétique. À l'époque, il n’y a tellement rien que... ça marche, quoi. Et une fois passé le bac je dis à mes parents que j'ai envie de faire une école de dessin, pour être dessinateur de BD. Pour eux, il n’est pas question de faire ça, ce n’est même pas une option. Les gens ne savent pas que c'est un métier, et puis c'est pas sérieux. Je vais donc faire un compromis pour des études d'architecture, et je deviens architecte de métier, mais le deal, c'est que je continue à vivre ma passion, la bande dessinée. Je vais au Salon d'Angoulême la première fois en 1978, donc la cinquième éditon. C'est un tout jeune festival et à l'époque pour aller en Charente depuis Paris, vous preniez le train à Austerlitz, mais il met quatre heures pour y aller. Angoulême, c'est loin et il n’y a pas de TGV. En plus, arrivé à la gare, on nous annonce que les festivités n'ont pas lieu en centre-ville, des bus nous emmènent dans la banlieue d'Angoulême aux Logis de Lunesse. Il y a donc le festival, avec les exposants,- une quinzaine - réunis dans une salle un peu sinistre, des tables-rondes dans une autre salle, mais on se dit que l'année suivante on sera là. C'est genre le pari qu'on se fait avec deux copains et c'est comme ça que je crée le fanzine PLGPPUR (Plein la gueule pour pas un rond) en avril 1978, trois mois après être allé à Angoulême. Je prends mon premier stand Fanzine (une planche de bois brut sur deux tréteaux bancals) donc, pour vendre le numéro 2 spécial Bilal en janvier 1979 à la sixième édition, et en janvier 2023 cela faisait quarante-cinq années d'affilée (sauf l'année du Coivd) que je tiens un stand PLG à Angoulême, derrière mon stand à promouvoir une sorte de bédéphilie
Cette bédéphilie se fait aussi dans la lecture des premiers livres sur la bande dessinée. Il y en a très, très peu à l'époque, le catalogue de l'exposition du musée des Arts décoratifs de 1967 [Bande dessinée et figuration narrative] étant le plus beau livre édité sur le sujet, avec des très belles reproductions en noir et blanc. Et vous aviez quelques livres de Francis Lacassin, de Jacques Sadoul et les premiers livres de Numa Sadoul parce que Glénat fait les Cahiers de la bande dessinée, qui sont sans doute le premier fanzine sérieux sur la bande dessinée après Phénix et qui publie régulièrement des interviews d'auteurs, ce qui nous permet de nous familiariser avec les dessinateurs. Grâce aux photos on identifie aussi les gens quand on les croise à Angoulême.
Après, il y a la chance, le fait d'habiter en banlieue, le fait qu’à l'époque, tous les dessinateurs de BD vivent à Paris ou en banlieue, parce que Paris n'était pas une ville aussi chère qu'elle est aujourd'hui. Les dessinateurs de BD devaient être près de leur éditeur, comme il n'y avait pas Internet et que la Poste ne fonctionnait pas de façon fiable. Et donc les éditeurs à l'époque sont en Belgique ou en France. Quand les éditeurs sont en Belgique, les dessinateurs prennent le train à la gare du Nord pour aller livrer leurs planches à Bruxelles, puis au bout d'un moment beaucoup de dessinateurs préfèrent travailler pour des éditeurs français. En plus il y a des éditeurs qui commencent à avoir des bureaux à Paris pour éviter les frais de transports, et le plus emblématique ce sont les éditions Dargaud, l'éditeur de Pilote, la revue de René Goscinny. C'est l'hebdomadaire qui marche le mieux, qui est la référence. Quand vous êtes auteur dans Pilote, vous êtes dans le meilleur magazine de BD des années 1970 jusqu’au début des années 1980. Jusqu'à l'arrivée de Fluide glacial et de Métal Hurlant, Pilote et sans doute le meilleur magazine. Et à l'époque, ils sont à Neuilly-sur-Seine.
Toujours les rencontres et les hasards : un jour je me promène dans Montrouge et je vois un jeune homme qui descend sa poubelle en bas de chez lui. Je me dis que je le connais, et c'était Bilal, le jeune Bilal qui a 26 ans, que j'ai lu dans Pilote et qu'on avait aperçu à la convention. Il est barbu à l'époque et je l'approche. J'ose l'aborder, parce que c'était vachement impressionnant, et Bilal était mon voisin. Il habitait à cent mètres de chez moi, à Montrouge. Il accepte qu'on vienne l'interviewer et c'est comme ça que Bilal est l'invité du deuxième numéro de mon fanzine. Mais il y avait déjà des stars, en fait. Giraud est déjà considéré comme un génie de la bande dessinée, et les gens restaient des heures à le regarder faire des dédicaces parce que, Giraud, c'est impressionnant ! Il ne faisait jamais le même dessin, donc en dédicace c'était exceptionnel. Quand vous faisiez la queue, vous ne vous ennuyiez pas parce que tous les gens qui étaient devant vous avaient un dessin, jamais deux fois le même. Alors qu'il y avait des dessinateurs... Je me souviens de Jacques Martin pour Alix, c'était un peu pathétique parce qu'il faisait toujours le même profil de Alix. Il ne s'emmerdait pas, on sentait que c'était plus un raconteur d'histoire qu'un dessinateur.
Dans la bédéphilie, il n’y a pas seulement le fait d'être lecteur et de commenter ses lectures, il y a aussi l’idée de vous intéresser au domaine. Je ne sais pas si le terme fandom vous évoque quelque chose.
JZ : Oui, oui, bien sûr.
PM : Ce sont les Américains ont créé ce terme. « Fan » peut être pris péjorativement mais je pense que dans ce cas c'est aussi parce que, les fans, ce sont les jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui aiment la bande dessinée et qui s'intéressent à tout ce qui tourne autour de la bande dessinée. D'où le terme « fanzine », magazine de fanatiques, qui est approprié pour toutes ces revues tirées à peu d'exemplaires et vendues par des fans, qui vont évoquer leur passion par des articles, par des interviews, par des publications de jeunes dessinateurs amateurs, etc. Ce mélange très foutraque de contenus, où se côtoient le pire et le meilleur, est l'intérêt quand vous lisez des fanzines. Même à l'époque, vous devez comprendre au bout d'un moment que tout n'est pas forcément de la même qualité et ça, ça participe aussi à votre regard critique. Voilà un peu les débuts de cette bédéphilie.
On a donc eu la chance de faire ce fanzine PLGPPUR qui a progressé et se vendait à 3 000 exemplaires en librairie à un moment donné, à son apogée dans les années 1990. Aujourd'hui vous savez qu'un livre, même d'un éditeur important, vendu à 3 000 exemplaires est considéré comme un best-seller. À l’époque, il y a tellement peu de bandes dessinées et d'albums de bande dessinée que n'importe quoi se vend très bien. Ce que me racontait encore un dessinateur de BD, c'est que quand il a fait son premier album, Glénat, son éditeur, lui a dit : « Houlala vous êtes un débutant on va d'abord le tirer à 15 000 exemplaires votre livre parce que ça ne va probablement pas se vendre. »
Il y a un aspect qui va vous intéresser, c'est que, dans mon fanzine, je fais une rubrique fanzine. C'est le grand truc du petit monde du fandom, de parler des fanzines des autres, des copains qui font leur propre fanzine, que vous croisez à Angoulême, à la Mutualité ou à Clichy. On s'échangeait nos fanzines, et c'est comme ça que je constitue une collection. Actuellement j'ai plus de 5 000 fanzines de bandes dessinées depuis les années 1970, français et étranger. Donc, je me mets à parler des fanzines des autres quand je vois des dessinateurs prometteurs, à parler des entretiens, à citer les choses, etc. Cette rubrique fanzine sur tous les numéros de PLG constitue une espèce de panorama unique de la scène du fanzine en France et à l'étranger, parce que je commence aussi à envoyer des fanzines en Belgique. Et puis en 1980, le Centre national des lettres, qui devient Centre national du livre, nous autorise à prendre des abonnements dans des bibliothèques du monde entier par un partenariat de l'époque. Je choisis d'envoyer mon fanzine à New York, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, et tout ça va me permettre d'être repéré par des bédéphiles de ces pays-là et je reçois des fanzines de là-bas. La Poste fonctionne remarquablement bien, on ne téléphone pas parce que le téléphone est hors de prix, même en province, de Paris à Marseille. Vous avez peut-être entendu ça, les gens comptaient les minutes et vos parents vous engueulaient parce que la facture allait être très cher. La France était un pays arriéré en télécommunication et le téléphone avait des tarifs prohibitifs avant que France Télécom ne se développe et que ça devienne ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, on s'adapte en fait. Il n’y a pas les moyens techniques, mais la bédéphilie est sans doute extrêmement développée, en tout cas en France, en Belgique. On fait l'admiration des autres pays. Je me souviens de bédéphiles anglais qui étaient venus me voir au début des années 1980, et qui étaient catastrophés du niveau de la bédéphilie en Grande-Bretagne. Ils venaient parce qu'on avait en plus les meilleurs dessinateurs du monde ; Métal Hurlant était s'en doute la revue qui se vendait le mieux à l'étranger. Très vite, Dionnet fait une version américaine qui s'appelle Heavy Metal et qui publie les mêmes dessinateurs. C'est comme ça que Moebius va devenir le dessinateur français le plus célèbre de la planète. Et ces Anglais étaient fous qu'on ait des dessinateurs de ce niveau-là. Pour que les Anglais reconnaissent qu'on est meilleurs qu'eux, c'est que vraiment la bande dessinée française était bien meilleure que la bande dessinée britannique.
JZ : Tout à l'heure vous parliez des groupes de fans, est-ce que vous vous considéreriez comme appartenant à un groupe particulier de bédéphiles ?
PM : Oui, il y avait évidemment des groupes en fonction de nos affinités de style. Les fanzines étaient pas mal liés aussi aux courants musicaux. Vers la fin des années 1970, il y a tout un courant dans le fanzine de BD français qui s'apparente aussi au mouvement punk anglais. La musique punk était aussi dans la revendication. J'étais plutôt « bon chic bon genre », disons, comparé aux punks. Je n’avais pas d'épingle à nourrice dans les oreilles et je n’avais pas un t-shirt déchiré pour revendiquer une espèce de révolution. Mais vous aviez des fanzines de BD qui étaient intéressants, parce qu'ils entretenaient une culture liée à un graphisme qui était mal fait, à une maquette volontairement pas très lisible et un dessin très provocateur. C'était de la transgression.
Pour autant, les groupes n’étaient pas très étanche, ils se croisaient, on se connaissait tous. Il n’y avait pas les chapelles du premier courant de la bédéphilie, des fameux clubs des années 1960, ceux des nostalgiques de ce qu'on appelait l’« âge d'or » d'avant-guerre. Les premiers clubs se créent en France, parce que ce sont des gens qui ont rêvé sur les bandes dessinées de grands formats d'avant-guerre et qui une fois adulte se sont demandé pourquoi on n’en parlait plus et pourquoi ils ne pouvaient plus lire Flash Gordon. Nous, on était assez ouverts, même si j'ai appris qu'après, on me reprochait d'interviewer surtout des auteurs français et surtout des auteurs français issus de Métal Hurlant ou de Pilote. J'étais plutôt sur la bande dessinée francophone contemporaine, mais on a quand même interviewé Hermann qui était belge, on a interviewé des Espagnols, on a interviewé des étrangers.
Il y avait des cercles de bédéphiles en fonction de leurs centres d'intérêts, oui, mais c'était informel. On n'avait pas de club. J'avais évidemment une association à but non lucratif qui m'autorisait à publier.
C'est un aspect qu'il faut peut-être évoquer. La majorité était à 21 ans, jusqu'en 1974 et ça veut dire que pour les fanzines, avant cette année-là, il fallait forcément un représentant légal. Le représentant légal, c'est souvent le père ou la mère du gars qui monte son fanzine, parce qu'il n'a pas l'âge légal pour être éditeur. Il ne peut pas être éditeur, même d'un petit fanzine tiré à 200 exemplaires. À l'époque, il fallait aussi envoyer votre fanzine au ministère de l'Intérieur, il y avait une sorte de censure. On est dans les années après 1968 donc les fanzines sont souvent politiquement à gauche. Il y a eu tout ce mouvement politique et nous, bizarrement, on est apolitique. C'est pas du tout l'idée, on n'est pas du tout Charlie Hebdo, on n'est pas du tout Hara Kiri. Tout ça, nous, ça nous intéresse mais sans plus. Nous on veut parler de bandes dessinées. Je sais que ça étonnait un peu les parents ou les amis des parents, qui pensaient qu'on faisait un fanzine pour parler de politique, parce que la génération un peu avant la nôtre était encore très politisée. Nous, ce n’est que la bande dessinée. Il se trouve qu'on aimait plutôt une bande dessinée qui était très créative, qui était très innovante, qui était très d'avant-garde et qui a été beaucoup moins réactionnaire que les bandes dessinées des années 1960, ça c'est sûr. On n’était pas très fan de Michel Vaillant. Il nous paraissait même d'une espèce de conformisme total sur les schémas narratifs et sur la qualité graphique intrinsèque.
JZ : Vous avez déjà parlé de plusieurs de vos activités, notamment PLGPPUR, est-ce que vous pourriez me parler d'autres activités relatives à la bande dessinée. Est-ce qu'il y en a une qui vous importe davantage ?
PM : Je commence à écrire partout. Je deviens le correspondant de plusieurs fanzines étrangers, notamment une revue espagnole et un fanzine britannique de Paul Gravett,Escape, où on me demande de raconter le monde de la bande dessinée en France. Je fais des rubriques, des recensions de fanzine pour le un livre annuel sous la direction de Jacques Goimard qui s'appelait L'Année de la science-fiction, dès le début des années 1980, pareil pour L’Année de la bande dessinée. À un moment donné, j'ai vraiment été la personnification des fanzines, c'est-à-dire que j’expliquais le monde des fanzines, comment il se comporte, parce que je recensais tout, j'avais tout, je recevais tout ou j'achetais tout. Donc j'avais la possibilité de raconter l'évolution du monde des fanzines de bande dessinée, et je parle aussi de science-fiction parce qu’il y a des liens très, très proches. En France, le fandom de science-fiction a été extrêmement proche du fandom de bandes dessinées. Métal Hurlant était une revue de bande dessinée plutôt axée sur la science-fiction et tous ses auteurs de BD comme Mézières, Giraud, Druillet et Bilal étaient des grands lecteurs de romans science-fiction. La science-fiction explose dans les années 1970. Elle explose à cause du courant américain traduit, et que la nouvelle science-fiction française commence à se développer, donc il y a des liens très étroits.
JZ : Vous parliez de vos parents qui ne vous ont pas forcément encouragé dans la bande dessinée mais en tout cas vous soutenaient. Comment est-ce que votre entourage percevait tout ça ? Est-ce que c'était un peu mal vu quand même ?
PM : C'est mal vu si ça perdure. J'ai senti au début le regard amusé de ma famille ou des amis de mes parents. J'étais dans un milieu intellectuel et assez universitaire mais, après le bac, quand je continue à faire mon petit fanzine de BD, je vois quand même une grande inquiétude et même un désarroi. Je me souviens d'amis de mes parents qui était presque consternés quand ma mère leur disait que je continuais à publier mon fanzine, qui s'appelait en plus Plein la gueule pour pas un rond.
Mais c'est surtout dans le milieu scolaire et universitaire qu’il y avait de l’inquiétude. Quand je faisais mon fanzine au lycée, on vendait le fanzine sous le manteau pendant l'heure de la cantine et sans aucun accord du proviseur ou même des profs, et on ne le montrait surtout pas aux profs sinon on était grillés. En 1974-1975, si vous montrez de façon trop ostentatoire votre passion de la bande dessinée, c'est clair que ça va vous nuire sur plein de choses. J'avais des copains d'ailleurs, même en architecture, à qui je ne disais jamais que j'aimais la bande dessinée parce qu’ils allaient me regarder bizarrement. On était considéré comme des gens un peu attardés parce que si à 22 ans, en étude d'archi, tu ne t’intéresses pas aux filles ou à l'architecture, c'est que tu es vraiment un peu hors sol.
JZ : Vous avez assez peu interviewé des auteurs américains, est-ce que c'était une volonté ou plutôt par facilité ou proximité ?
PM : Je n'étais absolument pas lecteur de traductions de bandes dessinées américaines. Ça me passionnait pas beaucoup parce que je n’étais pas sensible aux histoires de super-héros. Ça me semble être toujours pas très crédible, je ne suis jamais rentré là-dedans. De même, je n'étais pas fou des petits formats qu'on trouvait dans les kiosques, et des traductions de bandes dessinées faites au kilomètres par des studios italiens ou espagnols ou anglais. Il est sûr que, sans m'en rendre compte, le cercle de bédéphiles que je fréquentais étaient plutôt des bédéphiles de la BD franco-belge en gros. Ça ne m'empêchait pas de croiser des gens qui étaient fans de comics mais j'étais toujours absolument étonné qu'on soit en extase devant une planche des X-Men ou des Quatre Fantastiques. Pour moi, Jack Kirby est sans doute un très, très grand dessinateur de BD, mais ça ne m’a jamais autant ému qu'une planche de Giraud. Et on a eu la chance qu'à l'époque, la bande dessinée franco-belge, et surtout française, à partir de 1974-1975, soit la meilleure du monde. Sans aller très loin, nous avions autour de nous les meilleurs dessinateurs de BD. Très vite, les grands auteurs américains vont faire le déplacement au festival d’Angoulême parce qu'ils veulent rencontrer des dessinateurs français. Ils ont tous entendu parler évidemment du succès d'Astérix. Je me souviens, j'avais été aux États-Unis en 1975, et en 1980 et je m'achetais Heavy Metal dans les kiosques américains. J'étais quand même parfaitement épaté de retrouver au fin fond du Midwest, dans l'Indiana, des traductions de Bilal chez un marchand de journaux américains. Ça me paraissait quand même extraordinaire alors que la culture américaine nous avait envahi toutes ces années-là.
Pour aller plus loin
Entretiens bédéphiles