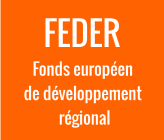Maël Rannou - Entretien bédéphile
Retranscription de l’entretien avec Thomas Dassance, mené par Anouk Thomas, étudiante en master 2 « Bande Dessinée : Édition, Théorie et Critique » de l’université Bordeaux Montaigne, le 22 octobre 2022.
Introduction
Anouk Thomas : Vous ne correspondez pas exactement au profil des gens qu’on va interroger. J’ai enlevé les questions sur ce que vous faisiez dans les années 1970, parce que bon… (rires)
Maël Rannou : (Rires) De fait, je ne faisais pas grand-chose.
Thème : Parcours de bédéphile
AT : Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la bande dessinée ?
MR : Je suis né en 1989, donc en effet, loin des années 1970, et dans un territoire rural, en Mayenne. Je suis de la campagne mais j’ai fait mes études à Laval et j’y ai travaillé. Mes deux parents étaient profs et aimaient beaucoup la bande dessinée, donc il y avait toujours des magazines de bande dessinée à la maison. Il y avait Spirou, il y avait les Pif de mon père – j’ai d’ailleurs travaillé sur Pif après. Il y avait des Fluide Glacial… On avait des abonnements à des magazines donc il n’y avait pas de problème pour l’accès à la bande dessinée, ils en achetaient volontiers. En revanche, pas du tout d’environnement social : on n’avait pas d’amis du monde de la bande dessinée, ni des fans de bande dessinée, ni des bédéphiles… Peu de festivals de BD. Il y en a un à Laval mais on ne connaissait pas tant que ça. Il n’y avait pas un contexte favorable à la création bande dessinée. Par exemple, mon père ne dessinait pas de revue de bande dessinée, ou pour un fanzine de bande dessinée. Il n’y a pas eu un transfert de ce type-là, bien qu’il y ait quand même un rapport à l’écriture parce que mon père écrivait, mais c’était plutôt des romans. Et on lisait beaucoup avec mon frère. On courait dans les champs, on jouait, et puis on dessinait énormément ensemble. C’est mon grand frère mais on est très proches, on a deux ans d’écart, on a vraiment grandi ensemble et on faisait des BD ensemble. On a retrouvé des trucs où on agrafait nos BD, quand j’avais 5 ou 7 ans à peu près… On agrafait les originaux en un exemplaire et on mettait « numéro 1 », « numéro 2 »… On lisait beaucoup Spirou et toutes les piles de magazines de mon père, donc il y avait cette envie de faire un magazine. Enfin, un fanzine, une revue… On n’avait pas les mots à l’époque. Bon, il ne s’agissait pas du tout d’écrire sur la bande dessinée à l’époque, mais de créer de la bande dessinée. Un jour, on est au collège et on appelle ces magazines-là « L’Égouttoir », on ne sait pas vraiment la raison. Et quelques années plus tard, quand moi je suis en seconde et mon frère en terminale, on crée un fanzine avec ce même nom. Un fanzine de création, à l’époque. Moi, je voulais être dessinateur de BD et je ne comprenais pas : j’envoyais des pages à Spirou mais ils ne les prenaient pas. Forcément ! J’avais 14 ans, elles n’étaient pas brillantes… Et donc il n’y avait pas de réflexion sur le fanzinat, c’était surtout : « on fait un fanzine parce que de toute façon personne ne me publie, je vais leur montrer comment je suis génial ». Avec mon frère on avait pas mal de BD qu’on avait faites avant donc on a commencé à prendre le contenu qu’on avait déjà depuis 5-6 ans, on l’a mis dans le fanzine et ça a fait un numéro. Le premier, on a réussi à le vendre à peu près aux connaissances, puis pour le deuxième, trois mois après on s’est dit : « bon… ça suffit ». En plus on avait de moins en moins de contenu parce que le premier faisait 40 pages quand même. Pour le deuxième numéro, ça faisait beaucoup à remplir… Mais ça m’avait vachement plu de faire ça, moi. Pas tellement de les vendre, mais l’idée de faire un magazine. C’était début 2004 je crois, on avait fait 2 numéros, et après il y eut les vacances scolaires d’été. Le numéro 3 n’arrivait pas, quoi, parce que… La flemme. Et donc je fais, en octobre 2004, le fanzine Gorgonzola.
Il faut resituer un peu tout un contexte, encore : j’habite à la campagne, il n’y a pas grand-chose à faire, parce qu’il n’y avait pas Internet à l’époque non plus. Internet arrive chez nous quand j’étais au collège à peu près, et puis quand je suis au lycée, on a la révolution de l’Internet illimité. Et c’est la période des « blogs BD ». Tout le monde en fait un : Laurel, Boulet, Bagieu, que moi je n’aimais pas du tout à l’époque évidemment… Parce que bon, voilà, c’était pour les filles (rires). Mais il y avait comme ça des auteurs de BD comme ça qui font des blogs. Il y a aussi un forum et un site « BDAmateur » où les gens peuvent poster leurs BD. Il y a une très chouette communauté qui se crée comme ça. Moi j’ai évidemment un blog aussi, et j’ai Gorgonzola. L’Égouttoir, c’était mon frère et moi et deux copains, c’était très « local ». Pour Gorgonzola, j’ai envie de faire un nouveau fanzine, il sera encore moins cher, ce ne sera pas 3€ mais 1€, ce sera 20 pages. C’était un peu pour forcer mon frère à refaire des fanzines. J’ai sorti le premier numéro pour son anniversaire en lui disant : « Eh ho, regarde, j’ai fait un nouveau fanzine, on continue ? Allez hop, on fait une nouvelle édition. » Super cadeau (rires) : « Tu mets la moitié de l’argent ? » Vraiment, quelle drôle d’idée (rires). Et dedans, les auteurs étaient des auteurs que j’avais trouvés sur Internet, avec leur autorisation bien sûr, venus de blogs de BD divers.
AT : D’accord.
MR : Rok, c’était une Suisse, il y avait un Québécois qui était sur BDAmateur, il y avait Michaël Roux qui était un mec assez connu des blogs BD à l’époque, qui a aujourd’hui une carrière d’auteur de BD assez installée, sans être quelqu’un de connu du grand public… Et donc je fais ce numéro de Gorgonzola, et l’idée c’était d’avoir un numéro vraiment régulièrement, tous les trois mois environ, de 20 pages photocopiées. Il n’était pas encore question d’écrire sur la bande dessinée. Je me voyais comme un punk, c’était un fanzine punk... « Gorgonzola », c’est parce que je confondais avec « eczéma », je pensais que c’était une maladie, donc vraiment, rien ne va… (rires)
AT : (Rires) Ok.
MR : C’est un malentendu qui dure, parce que le nom s’est installé et en plus c’est un bon nom, ça sonne bien. Mais voilà, je ne savais pas que c’était un fromage… Le côté punk est parti très vite, parce que dès le numéro 2, il y a une BD qui se moque des ados qui se prennent pour des punks par un copain... Bref. Et, c’est vrai que je n’ai pas encore une énorme culture du fanzine à ce moment-là. Je devais avoir vu des magazines ou des fanzines comme PLG, des choses comme ça des années 1980, dans lesquels il y avait toujours l’interview d’un auteur et puis de la création autour, donc ça me semblait être le modèle logique pour un fanzine. Mon frère avait découvert l’Association, et on avait donc acheté les fanzines de Menu, où il y avait des interviews, des machins. On était quand même des ados très fans de BD : on allait à Quai des Bulles[1], on allait à des festivals comme ça, on achetait des choses. Et le premier auteur que j’ai interviewé, dans le numéro 2, c’était Mattt Konture, auteur très underground. Dans le numéro 3, c’est Julie Doucet. Une interview qui n’avait aucun intérêt, mais elle avait répondu par mail, très gentiment. Et au numéro 4, Mandryka. Donc voilà, il y avait des interviews, quoi. Et après il n’y a plus eu d’interviews. C’est ça qui est marrant. Je dis souvent que j’ai commencé à faire des Gorgonzola sur la bande dessinée après mon lycée, mais en fait quand je regarde, les numéros 2, 3 et 4, il y a déjà des interviews d’auteurs de BD. Et pas n’importe lesquels, parce que Mandryka, c’était par rapport à l’Écho des Savanes, qu’il avait créé avec Gotlib et Bretécher, pour parler de la maison d’édition qu’il avait créée. Il y avait cet intérêt, inconscient à l’époque, pour ces gens qui conçoivent des choses en tant qu’auteur.
Donc ce fanzine existe, il fait ses petits numéros tous les 2-3 mois, jusque… 2007, l’année où j’ai eu mon Bac. Jusqu’au numéro 12, c’est vraiment de la création avant tout. Ça s’est internationalisé, car à partir de 2006, je suis allé à Angoulême. J’ai rencontré notamment l’éditeur de PLG [note : Philippe Morin] – PLG qui est aussi l’éditeur de mon dernier livre, et de mon premier livre d’ailleurs, c’est marrant – qui m’avait invité à venir, parce qu’il se reconnaissait sans doute un peu dans l’adolescent que j’étais et qui faisait des fanzines. Il m’a hébergé la première année où j’y suis allé et m’a vraiment fait découvrir des trucs… Et le festival d’Angoulême est évidemment devenu un rendez-vous. J’achetais du fanzine et je voyais quand même qu’il y en avait beaucoup moins avec des interviews ou des articles, un format que j’appellerai dans mon mémoire de Master des « fanzines mixtes » – qui mélangent la couverture entre un auteur un peu connu, qui est un produit d’appel, une interview, peut-être un second dossier sur un truc moins connu, et des créations, par rapport aux fanzines des premiers bédéphiles qui n’étaient que de l’information sur la BD ou les actuels qui ne sont que de la création depuis le milieu des années 1990. Nous on n’a jamais fait la couverture avec un auteur, on ne veut pas mettre l’auteur interviewé en couverture, parce qu’on est contre la commercialisation. Et puis en plus nos auteurs ne sont pas forcément très connus (rires).
En 2007 j’ai mon bac, donc je vais en hypokhâgne et je n’ai plus du tout le temps de faire un numéro tous les trois mois. Et puis ce n’est pas un milieu très favorable à la bande dessinée… Donc je fais un seul numéro en un an, un numéro de 40 pages photocopiées – on était passé de 20 à 40 pages en cours de route. Avant, j’en faisais un tous les trois mois, alors un seul en un an ça ne me paraissait pas un très bon rythme, c’était un peu frustrant. Donc à partir de l’année suivante, on fait un numéro de 120 pages, dos carré-collé. C’est la deuxième formule, et ce n’est toujours que des récits complets, on y tient toujours… C’est aussi une deuxième formule en termes de format : on passe à un gros truc qui sort une fois par an, on va vers un annuel dos carré-collé. Mais, dans le contenu, la nouvelle formule se dessine seulement qu’à partir du numéro 16 [en 2011]. Pour la première fois, on va faire un dossier sur un sujet d’histoire de la BD, en l’occurrence la BD argentine contemporaine. C’est principalement de la publication d’auteurs argentins, mais il y a quand même Claire Latxague, qui est une docteure en espagnol qui faisait sa thèse sur Quino. On avait un auteur argentin depuis longtemps, donc je savais qu’il y avait de la bande dessinée argentine, je trouvais ça intéressant de la valoriser. J’avais lancé un appel via Jeneverito aux auteurs argentins et Claire, qui a vécu en Argentine et qui est très proche de beaucoup d’auteurs argentins, et a depuis lancé une maison d’édition où elle publie des auteurs argentins, m’avait contacté en me disant « moi j’ai un gros réseau ». Elle avait déjà traduit et lettré des pages, pour pouvoir présenter aux éditeurs français. Chez nous on ne paye rien, on est un petit fanzine, mais ça l’a intéressée quand même et elle a écrit un texte sur la bande dessinée argentine qui était en introduction de ce dossier. C’est vraiment le premier moment où il y a un dossier sur quelque chose. Ce n’était pas fait pour s’instituer à ce moment-là, parce que le numéro 17 n’avait pas de dossier. Mais à partir du numéro 18, il va y en avoir un à chaque fois. C’est la formule qu’on va retrouver tout le temps : plus de deux tiers de création et un dossier qui va faire le troisième tiers de la revue, avec des articles, un entretien si la personne est vivante, et des hommages en bande dessinée par d’autres gens.
Et en fait Gorgonzola s’est avéré être le seul fanzine un peu comme ça, mixte, qui existait. Il y a eu DMPP Comics aussi à un moment, qui n’était pas vraiment un fanzine, mais qui était dans la même idée de revue avec un contenu « dossier historique » et une partie création. Il y a très peu de revues, enfin de fanzines, qui font de la création. Juste un dessin hommage par-ci par-là, tandis que nous, l’idée, c’est un panel de la diversité de la bande dessinée contemporaine. À la base, c’était pour montrer à mes copains de lycée ce que j’aimais, et de manière très différente parce qu’il y avait de la BD underground, de la BD onirique, de la BD humoristique absurde…
La BNF a fait une expo, ils ont mis un Gorgonzola, j’étais tout content. Mais ils disent que c’est « un fanzine sur le fanzine » alors qu’on a juste consacré un numéro à des auteurs de fanzine. C’est un fanzine sur des auteurs contemporains et souvent des auteurs un peu marginaux qui peuvent avoir publié dans des fanzines ou des maisons d’édition alternatives. C’est du patrimoine contemporain de choses sur lesquelles on n’écrit pas. Donc voilà pour Gorgonzola, il y a eu d’autres dossiers, il y a eu un autre dossier sur un pays, sur la BD croate qui était vraiment sur la BD contemporaine du coup, mais sinon ça a été des éditeurs, comme Artefact, comme Viper. On n’a pas une ligne qui interdirait d’écrire sur un sujet particulier, c’est juste que ça s’est dessiné comme ça et ça a donné un peu une cohérence à ce truc où il y a plein d’auteurs qui n’ont aucun rapport les uns avec les autres si ce n’est qu’ils nous plaisent bien. Ça a donné une identité à Gorgonzola qu’il n’avait pas avant, parce que ce n’est pas un fanzine d’école, ni un fanzine de copains. On est avec mon frère, certes, mais mon frère n’écrit pas dans le fanzine. J’écumais Internet, j’écumais des fanzines pour trouver des auteurs que je piochais ici ou là dans d’autres fanzines, donc ça peut donner l’impression d’un manque de cohérence, mais les dossiers ont permis d’en donner une à l’ensemble. Le prochain numéro qui va sortir, c’est pour le Festival d’Angoulême [2023], ce sera sur une autrice québécoise : Obom. L’idée c’est qu’on peut valoriser ça en parallèle de l’expo Julie Doucet. Ça a du sens de le sortir cette année parce que c’est une autrice de bande dessinée/fanzine dans les années 1980, qui est très importante aussi.
Je rajoute à cette grosse présentation que l’Égouttoir publie aussi quelques petits albums photocopiés ou en librairie des fois, des petits tirages... En fonction du bénéfice qu’on fait, on peut publier ici où là des albums au format fanzine A5 photocopié qu’on aime bien ou alors des albums parfois différents, à chaque projet c’est un peu modifié mais voilà, on en fait pas mal. Et c’est vrai qu’il y a plus de 200 auteurs qui sont passés dans la revue, certains juste une fois comme ça, mais on a quand même des pools d’auteurs qui ont un rapport avec Gorgonzola qui se sont créés au fur et à mesure.
Bon voilà, c’est beaucoup mais c’était quand même la grosse question du départ.
Thème : Pratiques et activités bédéphiles
AT : C’est très bien, ça nous a permis de rentrer dans vos activités liées à la BD. Parce qu’il y a le fanzinat, il y a un peu d’édition, mais vous faites aussi de la recherche, un peu d’écriture, de la critique… Vous êtes également directeur des bibliothèques de la Cité internationale de la bande dessinée [jusqu’en 2023]. Et dans toutes ces activités, est-ce que vous diriez qu’il y en a une qui prédomine ?
MR : Je dirais plutôt qu’elles se nourrissent les unes des autres. Au début, quand je faisais du fanzinat, je ne savais pas forcément pourquoi je le faisais. Mais à mon premier festival d’Angoulême, je découvre que des auteurs professionnels en font alors qu’ils sont déjà installés. Ce n’est pas seulement : « on fait un fanzine pour publier des trucs, parce qu’on est refusés ». Je me mets à adorer ça et je me rends compte que beaucoup de gens font des fanzines juste pour montrer leur travail et ne s’intéressent pas spécialement au fanzinat, donc ça me surprend.
Quand j’étais en première, j’avais écrit un texte et, très égocentriquement, je l’ai envoyé à la revue Comics Club. Je connaissais un peu l’éditrice, qui faisait un blog BD. C’était un texte qui s’appelait « Fanzinat de mon cœur », sur pourquoi j’aime le fanzine et l’idée d’en faire. Ensuite j’ai publié quelques autres textes dans cette même revue et ça a été le début... Mon frère publiait aussi dans Comics Club à vrai dire, c’est comme ça que j’ai eu les contacts, les sujets des dossiers, les choses comme ça. Mon frère a complètement arrêté d’écrire sur la bande dessinée depuis.
J’ai beaucoup écrit ensuite. Sur le site des fans de Pif, aussi, beaucoup, et j’ai écrit dans Comics Club mon premier article sur la BD Québécoise, quand j’étais en Hypokhâgne. Donc ça se recroise, parce que mes sujets de recherche principaux, c’est le fanzine, la BD québécoise et Pif Gadget. Ensuite j’ai fait un BTS en fabrication-édition, puis une licence pro de bibliothécaire pour laquelle j’ai fait mon mémoire de stage sur la bande dessinée en bibliothèque. Et une fois arrivé là, j’ai commencé à travailler. Comme j’écrivais déjà dans Comics Club, que Gorgonzola finissait par être connu, et que c’est un petit milieu, les gens se repèrent. Donc j‘ai aussi commencé à écrire dans Du9, dans Bodoï, etc. J’ai été appelé pour les Cahiers de la BD, plus tard. En 2014, deux ans après ma licence, j’ai commencé à faire un mémoire pour mon Master sur Pif et le communisme. Puis pour mon Master 2, trois ans après, en 2017, mon mémoire était sur le fanzinat de bande dessinée et sa naissance en France. Sur les bédéphiles en fait.
À chaque fois, j’ai ce truc où j’essaye de faire valider par l’université mes acquis de fan… J’amène dans l’université des sujets que je travaille déjà. C’est une autre méthodologie, je ne suis pas un « faux chercheur » mais je viens d’abord du fanzinat, et la recherche est venu derrière. Aujourd’hui je fais ma thèse sur la bande dessinée québécoise… Mais je vois aussi que j’écris beaucoup plus d’articles scientifiques que ce que font les doctorants. C’est aussi parce que j’ai 33 ans, pas un doctorant de 25 ans, et que j’ai accumulé de la matière. Quand j’ai commencé mon doctorat, j’avais déjà réfléchi depuis dix ans sur le sujet, donc forcément ça aide un peu à avoir des relations.
Comme je suis bibliothécaire je m’intéresse beaucoup aux questions de médiation de la bande dessinée : quand j’étais bibliothécaire à Laval, je ne m’occupais pas du fonds BD mais je faisais des rencontres et je travaillais sur la BD avec ma collègue, qui était dans le même bureau que moi. J’ai donc écrit ce livre sur la bande dessinée en bibliothèque en 2018. C’était le premier livre sur le sujet, on s’est un peu posés comme les spécialistes de la question. On faisait des formations sur le sujet.
Et à un moment un poste s’est libéré [à la Cité de la BD d’Angoulême]. J’ai été contacté parce que c’est un poste qui correspond beaucoup, sur la partie bibliothèque du moins, à mon profil. Mais je m’occupe aussi de la partie médiation du grand public, ça c’est un peu moins mon domaine de base.
En fait, tout ce qui est venu après Gorgonzola paraît un peu comme une sorte de validation des acquis d’expérience, sauf que je passe vraiment des diplômes. Tout ça se nourrit. En fait, ma recherche nourrit aujourd’hui le prochain numéro de Gorgonzola sur les autrices de BD québécoises, que j’ai interviewées lors d’un séjour de recherche, financé par la fac… Tout se nourrit de manière un peu complexe, c’est dur de détricoter qui dépend de quoi. Là, pour 9e Art, la revue de la Cité, je dirige un numéro sur Julie Doucet, parce qu’elle est Grand Prix. Mais c’est aussi une autrice centrale de mon travail d’étude, et c’est par ailleurs l’autrice que j’avais interviewée quand j’avais 14 ans pour mon fanzine, parce que c’était mon idole (rires). C’est intéressant parce que même les premiers bédéphiles, des gens comme Couperie, étaient des universitaires, mais il y avait aussi des praticiens. Donc moi j’ai fait un peu tout en même temps. Une sorte de fusion. Comme il y avait de moins en moins de fanzines, j’ai essayé de prendre toutes les fonctions.
AT : Est-ce que vous diriez que ces démarches s’inscrivent aussi dans une volonté de visibiliser la bande dessinée, de manière générale ?
MR : Ça dépend lesquelles. Je crois malheureusement que le fanzinat ne servira pas à ça, parce que c’est tiré à 200 exemplaires. C’est une niche, mais ça donne une base de recherche qu’on peut retrouver à d’autres endroits, comme des articles sur Du9. Deux ou trois ans après la publication, on les met en ligne, quand les numéros sont encore disponibles, pour que ce soit lu. Mais mon travail de formation, d’écriture d’ouvrages, de conférence, ou à la Cité, c’est pour visibiliser la bande dessinée. Ma recherche aussi, mais au niveau du monde de la recherche. Ce n’est pas n’importe quelle personne lambda qui va aller lire mes articles ultra pointus sur la BD québécoise... Par exemple, La Brèche, dont je suis membre fondateur aussi (rires), et dont j’étais membre du CA jusqu’à il y a 2 semaines, sert à ça. À montrer au monde de la recherche que la bande dessinée existe. Donc voilà, il y a différentes strates, différents publics, et on ne visibilise pas les mêmes choses de la même manière selon les publics, évidemment.
AT : Oui, bien sûr.
MR : Mais encore une fois, tout se nourrit. J’ai par exemple beaucoup parlé de Julie Doucet dans mon fanzine, dans ma recherche, dans mon boulot, et l’an dernier j’étais intervenu dans des médias plus grand public pour en parler, comme le Journal de Montréal qui est un grand journal quotidien de Montréal ou ActuaLitté où j’avais fait une tribune sur elle. ActuaLitté c’est le site du monde du livre, c’est quand même beaucoup plus vaste que le monde de la BD. Ce que je veux dire, c’est qu’on n’écrit pas la même chose quand on veut s’adresser au public de la culture, à celui des fanzines, ou au grand public de Montréal. Mais tout se nourrit au même endroit.
Et je suis un peu obsessionnel, je déteste l’idée de faire un travail qui n’est publié nulle part… C’est un peu égocentrique, un peu égotiste. Alors des fois c’est sur mon blog. J’ai un avis : je le dis, je l’écris. Personne n’est obligé de le lire, mais ça existe quelque part. Alors je sais que ça peut être un peu dense, quand on arrive et qu’on voit cette production (rires).
AT : Oui (rires). Globalement, vous pratiquez vos activités plutôt au sein de collectifs ou de manière indépendante ? Est-ce que vous avez une préférence pour l’une ou l’autre de ces formes de pratique ?
MR : Je suis plutôt indépendant. Gorgonzola je l’ai créé avec mon frère, mais c’est moi gère le contenu. Par rapport à d’autres fanzines qui sont des collectifs, des trucs d’associations… Nous on est une association, mais il y a deux membres. Et les statuts interdisent qu’il y ait d’autres membres, sauf s’il y en a un qui meurt et dans ce cas l’autre peut nommer un autre membre (rires). C’est une gestion très « dictatoriale », c’est pas un collectif d’auteurs ou de copains. Mais c’est pourtant connu comme tel. Enfin, « connu »… La bande dessinée c’est un petit monde. Les gens connaissent Gorgonzola et m’y associent. Des fois ils ne savent même pas qu’il y a mon frère, mais c’est parce que je suis le visage, je suis celui qui écrit dedans et qui en parle. Après, je peux participer à des projets collectifs, bien sûr, comme La Brèche, pour la recherche, ou le Syndicat des Éditeurs Alternatifs, dont L’Égouttoir avait été l’un des membres fondateurs. On devait être la plus petite structure d’ailleurs, mais on était là au premier rendez-vous et on a vraiment fait partie des premiers fondateurs. Donc voilà, j’aime beaucoup le collectif, l’idée du collectif… Gorgonzola de toute façon c’est un collectif aussi, et au fil du temps il y a des gens qui sont devenus des habitués, des copains, des gens qu’on voit en festival… Voilà, j’ai créé des sociabilités avec Gorgonzola, parmi mes meilleurs amis il y en a qui viennent de Gorgonzola. Mais ce n’est pas un collectif dans sa gestion.
AT : Oui (rires). Globalement, vous pratiquez vos activités plutôt au sein de collectifs ou de manière indépendante ? Est-ce que vous avez une préférence pour l’une ou l’autre de ces formes de pratique ?
MR : Je suis plutôt indépendant. Gorgonzola je l’ai créé avec mon frère, mais c’est moi gère le contenu. Par rapport à d’autres fanzines qui sont des collectifs, des trucs d’associations… Nous on est une association, mais il y a deux membres. Et les statuts interdisent qu’il y ait d’autres membres, sauf s’il y en a un qui meurt et dans ce cas l’autre peut nommer un autre membre (rires). C’est une gestion très « dictatoriale », c’est pas un collectif d’auteurs ou de copains. Mais c’est pourtant connu comme tel. Enfin, « connu »… La bande dessinée c’est un petit monde. Les gens connaissent Gorgonzola et m’y associent. Des fois ils ne savent même pas qu’il y a mon frère, mais c’est parce que je suis le visage, je suis celui qui écrit dedans et qui en parle. Après, je peux participer à des projets collectifs, bien sûr, comme La Brèche, pour la recherche, ou le Syndicat des Éditeurs Alternatifs, dont L’Égouttoir avait été l’un des membres fondateurs. On devait être la plus petite structure d’ailleurs, mais on était là au premier rendez-vous et on a vraiment fait partie des premiers fondateurs. Donc voilà, j’aime beaucoup le collectif, l’idée du collectif… Gorgonzola de toute façon c’est un collectif aussi, et au fil du temps il y a des gens qui sont devenus des habitués, des copains, des gens qu’on voit en festival… Voilà, j’ai créé des sociabilités avec Gorgonzola, parmi mes meilleurs amis il y en a qui viennent de Gorgonzola. Mais ce n’est pas un collectif dans sa gestion.
AT : Comment est-ce que votre entourage et vos proches perçoivent vos pratiques liées à la bande dessinée ?
MR : Ils sont contents, généralement. Évidemment ça a évolué au fil des années, mais j’ai quand même toujours été vu comme le mec qui s’y connaissait en BD et aimait vraiment beaucoup ça, même par les copains. Maintenant je suis devenu une référence… Ma mère et ma grand-mère voient les livres sortir, et forcément elles sont contentes. La thèse, tout ça, ce n’était pas du tout gagné quand j’étais au lycée. Ça paraissait complètement improbable. Mais c’est chouette, voilà. Tout le monde est plutôt content, les gens sont fiers. Même si je sais qu’il y en a qui trouvent qu’on me voit un peu trop partout (rires). Mais pas dans mes proches, c’est plutôt un truc que j’ai pu lire. C’est marrant parce que dans mes potes de lycée, beaucoup lisent de la bande dessinée mais sans plus. Ils ne suivent pas de la même manière ce que je vais faire sur la bande dessinée, ce qui est normal. Mais ça reste positif, et je ne leur demande pas de lire tous mes articles (rires).
Thème : perception(s) de pratiques et du milieu bédéphile
AT : Est-ce que vous participez à des festivals ou à des jurys ?
MR : Surtout des festivals. J’ai l’impression d’avoir déjà fait des jurys mais non, ça ne me dit rien. J’ai un vague souvenir mais ça a vraiment dû être très anecdotique. Avec la Cité, ça peut arriver de participer à des jurys, mais c’est vraiment en tant que « Cité ». Mais des festivals, oui. On fait Angoulême tous les ans et on faisait Quai des Bulles assez souvent à une époque, vu qu’on était dans l’Ouest, mais c’est moins le cas maintenant. Après ça dépend, on a fait Lausanne, on a fait Bruxelles parce qu’en même temps on en profitait pour passer des vacances… Nous, nos conditions c’est de réussir à être hébergés. On paye le trajet de notre poche généralement. L’avantage de Bruxelles ou de Lausanne, c’est qu’on en profite pour faire du tourisme. Ce qui peut encore être le cas aujourd’hui : l’autre jour, je suis allé à Toulouse pour un festival et je suis resté chez un copain. Le festival n’était pas incroyable mais ça valait le coup de découvrir Toulouse.
On a donc fait des festivals tout petits, des festivals tout grands, des micro-festivals aussi… Il y en a un deuxième à Saint-Malo, mais tout petit, de fanzines… On en fait quand même pas mal, on a une économie de festival, mais pas autant que certains éditeurs qui vont faire des festivals toutes les trois semaines parce que c’est vraiment leur modèle économique. Nous, c’est notre modèle économique aussi mais on n’a tellement pas d’économie que… C’est un modèle économique mais pas un modèle riche. On tire nos bouquins, nos fanzines pour Angoulême, on vide la caisse, et après le festival on la remplit avec de quoi payer le numéro d’après. Et tous les festivals qu’on va faire entre les deux, c’est un peu des ventes bonus. Mais c’est aussi pour ça qu’on n’a fait aucun Gorgonzola entre 2020 et 2022 : en janvier 2020, pour Angoulême on ne l’a pas sorti parce qu’on était en retard, et après il y a eu le confinement, donc boum, le numéro est sorti en 2022, et il y a eu 3 ans d’écart entre les deux. Il est sorti en mars pour Angoulême[2], et j’en ressortirai un en janvier donc là l’écart va être extrêmement court. Mais on a quand même récupéré assez d’argent pour payer un prochain numéro. Il y a aussi le SoBD. On l’a fait l’année dernière et on va le faire cette année. C’est le salon des ouvrages de bande dessinée, alors il y a un lien avec notre production, qui est quand même atypique à ce niveau-là… Et puis mon frère habite Paris, donc c’est simple. Il y a vraiment ce souci d’être hébergé. En Suisse on avait été hébergés, à Bruxelles aussi, mais c’est la condition.
AT : Et alors, qu’est-ce que vous pensez des prix existants, en bande dessinée ?
MR : Je n’ai pas un grand avis sur les prix. Je me suis beaucoup mobilisé pour que Julie Doucet ait le grand prix d’Angoulême, parce que je trouvais ça symboliquement important. La plupart des autres prix, on ne sait pas qu’ils existent. Ce qui n’est pas grave, on est content de les recevoir je pense. Dans le monde du fanzine, il y a le prix d’Angoulême, qu’on espère avoir depuis des années. Chaque année on nous dit : « ah, vous êtes dans les finalistes ». Mais au bout de 10-12 ans, on n’ose plus trop y croire… Il y d’autres prix qui existent ailleurs, on a eu un prix à Lyon une année, c’était rigolo. Un prix un peu obscur, mais je l’ai toujours. Sinon, j’ai publié un article sur les prix de la BD québécoise, comment ils valorisent la BD québécoise, notamment pour ce qui est de la réception. Bon, les prix disent des choses : à quel type de livres on décide de remettre des prix, quels sont les éditeurs qui reçoivent des prix… C’est des choses qui ne sont pas inintéressantes à analyser. Les prix sont des choix, et les choix sont toujours contestables, mais en même temps les gens qui les ont faits les assument. Ce que j’aime bien avec le grand prix du festival d’Angoulême, c’est que pour moi, il n’y a que deux solutions : soit on fait voter tout le monde, tous les auteurs, ce qui est le cas aujourd’hui, soit le festival décide arbitrairement de donner des prix à quelqu’un et c’est une ligne éditoriale. Ça s’explique aussi. Ils ont préféré faire le choix le moins risqué politiquement mais ils pouvaient aussi décider que ce serait eux qui décideraient chaque année. Donc j’aime bien le grand prix du festival d’Angoulême, pour cela. Et je suis très pressé d’être à la présidence de Julie Doucet.
AT : Est-ce que depuis que vous avez intégré le monde de la bande dessinée vous avez perçu des évolutions, positives ou négatives, dans…
MR : Ça fait bien 15 ans que je grenouille, mine de rien, mais dire qu’on a perçu des évolutions, c’est compliqué. La surproduction continue, mais dans le monde du fanzinat, la surproduction ce n’est pas vraiment une question. Il y a beaucoup de production mais pas vraiment de concurrence. On n’a pas les mêmes menaces. Il y a quand même eu des questions de coûts. Le papier dernièrement a quand même coûté cher à pas mal de fanzines. J’ai vu des évolutions esthétiques aussi : fin des années 1990, début 2000 – je n’avais pas encore commencé mais j’achetais beaucoup de fanzines à cette époque-là – tout le monde essayait de faire comme le Dernier Cri, des trucs sérigraphiés avec beaucoup de couleurs vives, un peu trash… Dans les années 2010, c’était plus les Arts-Déco de Strasbourg, donc c’était très esthétisant, très joli, ça a donné des trucs comme les Éditions 2024 par exemple, très design, très beau. Parfois un peu creux, ce n’est pas le cas de 2024, mais il y avait beaucoup de fanzines qui copiaient un peu cet esthétisme, on était passé sur des beaux objets… C’est les trucs du web aussi. Le web, ça a un peu tué le fanzine photocopié, forcément. Parce que les gens ont voulu faire des objets. Et maintenant, c’est la risographie. Tout le monde fait de la risographie. Je ne sais pas qui a influencé ça. Des fois de manière intéressante, des fois de manière absolument pas intéressante. En tout cas, c’est des livres chers. De là à dire qu’il y a un embourgeoisement… Quand j’ai fait mon étude sur les fanzines pour mon Master, je voyais que dans les années 1970 il y avait déjà un article sur la crise du fanzinat : « tout devient creux », « ça augmente », etc. On voit que chaque génération de fanzineux se notabilise. Guy Delcourt faisait des fanzines, Glénat avait bien sûr un fanzine… Certains arrêtent, et d’autres deviennent des professionnels, et considèrent que c’était mieux avant. Moi j’ai l’impression que je ne suis pas devenu un professionnel au sens de l’édition, mais je suis devenu un professionnel de la BD quand même. Et j’ai la même impression. Je me dis : « c’est un peu en crise par rapport à avant ». Mais en fait non, c’est des conneries. En tout cas, tous les 10 ans, quelqu’un dit que c’est la crise du fanzine et que ça va disparaître, mais je vois énormément de dynamisme intéressant quand même. Et j’apprécie de voir des étudiants en écoles d’art, de pouvoir discuter avec des jeunes, parce que je vois des fanzines très chouettes. La vraie évolution, je dirais, c’est qu’il y a de moins en moins de périodiques dans le fanzinat, ce qui avait déjà commencé dans les années 2000. On va vers le fanzine d’auteur, qui fait un album mais en fanzine. C’est pas grave, mais on n’est plus sur la périodicité, ce qui était un truc un peu marquant du fanzinat. Y compris quand c’était un seul auteur qui faisait lui-même son fanzine… Moi-même j’ai un fanzine personnel, un « egozine ». C’est que moi dedans, mais il y a « numéro 1 », « numéro 2 », ça a un nom de série… Porcellino faisait ça avec King-Cat. C’est très classique, beaucoup de comics faisaient ça… Aujourd’hui, on fait la même chose, mais sans mettre de titre de série. Chaque nouveau fanzine est un nouveau fanzine de l’auteur. L’auteur ou l’autrice s’affirme. C’est la grosse évolution que j’ai remarquée. Ce n’est ni positif ni négatif, c’est juste… C’est juste comme ça.
Thème : Influence de la bédéphilie sur la vie personnelle
AT : Est-ce que la fréquentation des milieux bédéphile a orienté des choix de vie ou d’engagement ?
MR : Dans mon cas, oui, radicalement. Elle m’a amené vers l’édition, déjà. À la base, c’est parce que je faisais des fanzines que j’ai décidé de faire un BTS édition après mon échec en prépa. Et en édition, j’ai découvert que la fabrication, le côté technique, ne m’intéressait pas tant que ça. Alors je suis arrivé en bibliothèque, et ça a été une révélation. Ce n’était pas une bibliothèque de bande dessinée, il y avait un petit sas de respiration. J’étais à la fois dans le milieu du livre, sans être complètement dans la bande dessinée tous les jours. Aujourd’hui c’est un peu plus compliqué, justement. Je me retrouve à faire de la bande dessinée à toutes les sauces. À une époque, j’ai vécu uniquement de la bande dessinée. Pendant un an, j’écrivais pour Les Cahiers de la BD et d’autres choses du genre, ou je donnais des cours sur la bande dessinée. Et je n’ai pas aimé, j’ai préféré retourner en bibliothèque parce que j’en avais marre. J’aime bien qu’il y ait des frontières entre mes passions et mon travail. En venant travailler à la Cité de la BD, je savais que c’était un peu le risque. Mais c’est aussi un peu le truc qui est difficile à vivre : c'est-à-dire que je rentre le soir, je me mets à mes projets personnels de bande dessinée et j’ai l’impression que je n’arrête jamais. Mais bon, je l’avais vu venir. En tout cas, sur la question des choix de vie, oui, c’est net. Parce que je ne serais jamais venu vivre à Angoulême, sinon… Et puis, toutes les sociabilités qui se sont faites, ces groupes de gens qu’on connaît… Même dans le monde de la bibliothèque, je travaillais sur la bande dessinée. Ma thèse, si je deviens chercheur – je suis déjà chercheur, mais si je dirige un jour un poste en fac – ce sera sur la bande dessinée.
AT : Et des choix éventuellement d’engagement ?
MR : Pour le coup je suis engagé politiquement chez les Verts. Mais pas spécialement en lien avec la bande dessinée, même s’il y a eu le prix Tournesol qui est remis par les Verts. Les Verts ont toujours été historiquement un soutien des activités du monde de la bande dessinée, mais je ne fais pas ce lien… J’ai fait un fanzine autobio sur mon engagement chez les Verts, mais c’est très très marginal. Pourtant je m’engage, j’aime bien les questions de démocratisation de culture, et le fanzinat et les bibliothèques me paraissent très liées à ça… Il y a tout type d’engagement, mais pour le coup, la bande dessinée, j’ai gardé ça un peu loin… On me dit : « Non, mais tu pourrais faire des dessins ». Et je dis : « Non, déjà moi je ne dessine pas trop, j’écris sur la BD ». Les gens sont perdus. Ou alors on me dit : « Ah, mais tu pourrais demander à quelqu’un que tu connais ! » Et je réponds : « Non, mais ça se paye, un dessin » (rires). Mais bon, il y a des engagements : le Syndicat des Éditeurs Alternatifs, etc. Enfin voilà, tout est engagement, encore une fois.
Conclusion
AT : Pour finir, est-ce qu’il y a d’autres sujets relatifs à votre parcours que vous voudriez souligner ?
MR : Je l’ai dit un peu en intro, mais aujourd’hui, j’ai conscience d’être un peu un des derniers fanzinistes. Je concluais lors d’une conférence à la BNF sur les fanzines, la semaine dernière, que c’est un peu obsolète. Évidemment c’est parce que je me raccroche à un modèle. Je garde le format A5 parce que c’était le format des photocopiés. Et ce côté fanzine mixte, je l’aime beaucoup, je trouve qu’il apporte beaucoup de richesse au contenu, et puis ça correspond à ce que j’aime aussi. C’est un fanzine d’abord et avant tout. Mais c’est vrai que je m’inscris dans cet héritage-là, et je crois qu’il y a un gros travail à faire sur cette mémoire. J’aimerais qu’elle soit mieux connue. Forcément, c’est un peu dérisoire puisque c’est des trucs tirés à très peu d’exemplaires, y compris Gorgonzola. Mais Gorgonzola est déposé à la BNF et à la Cité de la BD. Il y a une démarche proactive. Quand je parle avec des auteurs ou à des étudiants j’aime bien valoriser cette question-là, cette histoire du fanzinat, parce qu’on l’oublie vite. Mais c’est à peu près tout ce que j’ai à dire de plus. Sinon, lisez mon site, lisez mes articles (rires), venez à la Cité, voilà !
[1] Quai des bulles est le festival de bandes dessinées de Saint-Malo, et est le second plus grand festival français après celui d’Angoulême.
[2] Le festival d’Angoulême a habituellement lieu le dernier week-end de janvier, mais les confinements en 2021 ont empêché le festival d’avoir lieu, le repoussant exceptionnellement à mars 2022.
Pour aller plus loin
Entretiens bédéphiles