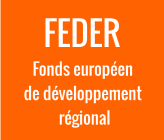Jean-Paul Jennequin – Entretien bédéphile
Retranscription de l’entretien avec Jean-Paul Jennequin, mené par Otxoa Fernandino, étudiant en master 2 « Bande Dessinée : Édition, Théorie et Critique » de l’université Bordeaux Montaigne, durant l'année scolaire 2022-2023.
Otxoa Fernandino : Comment êtes-vous venu à vous intéresser à la BD ?
Jean-Paul Jennequin : En fait, je dirais que c’est la bande dessinée qui est venue à moi. Je suis né en 1960. À cette période-là, la bande dessinée était partout pour les enfants. Quand j’ai eu trois ans, mon père, sachant que j’allais rentrer à l’école maternelle à la rentrée de septembre, pensait que j'étais en âge d’avoir toutes les semaines Le Journal de Mickey. Il a donc commencé à me l’acheter. Je ne savais bien sûr pas lire, donc c’était ma maman qui le lisait. Je n’ai pratiquement aucun souvenir de cette période où je ne savais pas lire et que je lisais des bandes dessinées.
Je commence vraiment à avoir des souvenirs de lecture de bandes dessinées à partir du moment où je vais en lire par moi-même, à l’âge de six ans. À ce moment-là, il y a eu le grand plaisir de savoir que je pouvais lire. C’était formidable. En plus, très vite, il m’en a fallu beaucoup, bien davantage qu’un simple Journal de Mickey toutes les semaines. Mon premier souvenir d’une demande de bande dessinée, c’était quand a été annoncée, en 1966, la parution de Mickey Parade et que j’ai demandé à mon père de me l’acheter. Ça été un premier choc, parce que c’était une bande dessinée et ça ressemblait à un livre. C’était au format d’un livre de poche. À cette époque-là, le dimanche, tous les marchands de journaux étaient fermés. Mais j’habitais à Montparnasse, au carrefour entre le boulevard Raspail et le boulevard Montparnasse , et au coin de la rue, il y avait des gens qui vendaient l’Humanité, L’Humanité Dimanche et Vaillant, le journal de Pif. Celui-ci n’était pas encore Pif Gadget, on était en 1966 et le magazine ne prend le nom de Pif Gadget qu’en 1969. Donc, mon père a commencé à m’acheter Pif, le dimanche. Puis, ma mère faisait des ménages et rapportait des journaux que les enfants de ses employeurs avaient lus et ne gardaient pas. Donc, c’est comme ça que j’ai commencé à avoir des exemplaires de Tintin et de Pilote entre les mains.
Là, on est fin 1966, et il y a une autre chose qui se passe à cette époque-là : je suis rentré à l’école primaire et on a des classements. Et chaque fois que j’ai un bon bulletin, c’est-à-dire exactement chaque mois parce que j’étais toujours un très bon élève, ma mère m'achetait un album. Et c’est comme ça que probablement en octobre 1966, j’ai eu mon premier album d’Astérix, La Serpe d’Or, acheté à la Librairie Tschann, qui à l’époque se trouvait Boulevard de Montparnasse, tout près de mon école primaire. C’était prédestiné parce que c’était une ancienne école polonaise qui a été ensuite récupérée par la mairie de Paris pour en faire une école de garçon. Mais depuis l’effectif a baissé, la Ville de Paris l’a récupéré pour en faire une école de dessin.
Tout ça fait qu’à ce moment-là, j’ai commencé à lire et à voir beaucoup de BD et à m’intéresser à la manière dont c’était fait. Par exemple, je me demandais comment c’était possible d’avoir les BD imprimées sur les deux côtés de la feuille, parce que j’avais commencé à dessiner moi-même des BD et je me disais : « Est-ce qu’on dessine d’un côté, puis l’autre côté sur une autre feuille et on les colle ensemble ? Comment est-ce qu’on fait ? »
Je m’intéressais aussi aux noms des auteurs. Par exemple, un truc qui m’a tout de suite fasciné, c’est que Greg était dans Pif (avec la série Les As), dans Tintin (avec diverses séries dont il était dessinateur, et je ne savais pas encore qu’il scénarisait d’autres séries sous le nom de Louis Albert) et dans Pilote (avec Achille Talon). Je me disais que c’était incroyable parce qu’il était dans trois magazines et on reconnaissait bien son style. Puis, j’ai eu mes séries préférées. Par exemple, Le Concombre Masqué de Kalkus, avant d’être crédité sous le nom de Mandryka, vers 1968-1969. Il utilisait déjà le pseudonyme Mandryka dans Pilote, mais il l’a changé en cours de publication du Concombre Masqué dans Vaillant.
Donc, je m’intéressais à qui faisait de la BD. Et au bout d’un moment, j’ai commencé à pouvoir sortir tout seul dans mon quartier, et j’allais à la librairie ou au marchand de journaux, enfin les trois qui étaient tout près. Parce qu’à cette époque, il y avait des kiosques, des libraires et des marchands de journaux partout. Et j’ai commencé à m’acheter moi-même des albums avec l’argent qu’on me donnait pour les anniversaires, les bonnes notes de fin d’année ou les bons bulletins, etc. Pas de problème, de ce côté-là, j’ai toujours été un excellent élève, donc je justifiais mon « salaire » sans discussion.
Puis, quand j’ai eu neuf ans, on a commencé à me donner de l’argent de poche. À partir de ce moment-là, j’achetais moi-même mes journaux, en plus des albums.
Et à dix ans, j’ai découvert la BD américaine dans le mensuel Strange. Immédiatement, j’ai commencé à acheter Strange et Marvel. Mais j’étais aussi dans une grosse période où Tintin était excellent comme hebdomadaire. En fait, j’avais tâté de tous les hebdos disponibles parce que mon père avait décrété qu’à huit ans, j’étais trop grand pour Le Journal de Mickey. Je n'y ai pas vu de problème : on va prendre Spirou à la place.
À neuf ans, on m'achetait donc Spirou et Tintin toutes les semaines. Un peu plus tard, j’ai eu Pilote. Et très vite, je voyais comment certaines évolutions de ces journaux pouvaient me plaire ou non.
Par exemple, en 1971, j’ai arrêté de moi-même d’acheter Spirou, parce que je trouvais que ça n’avait plus trop d’intérêt. J’avais vraiment adoré le magazine à une époque, en particulier une rubrique, quand Thierry Martens avait repris la rédaction de Spirou. Ils mettaient des suppléments, et il y en avait qui étaient encartés dans le journal. Par exemple, il y en avait eu sur la carrière de Jidéhem où on voyait ses premières planches quand il avait seize ans et des séries avant qu’il travaille à Spirou.
Dans Tintin, un été, il y a eu trois ou quatre rubriques sur l’histoire de la BD américaine. J’ai dévoré ça, c’était extraordinaire ! Là, je commençais vraiment à m’intéresser à la bande dessinée, à son histoire.
En 1971, j’avais onze ans, j’ai commencé à fréquenter la librairie Dupuis, qui était Boulevard St Germain, qui était la seule librairie de bandes dessinées de France où j’y ai trouvé des choses extraordinaires. J’allais y acheter les numéros de Phénix, une revue d’études critiques sur la bande dessinée. Le premier numéro que j’ai acheté avait en couverture Blueberry, parce qu’il y avait une étude sur Blueberry. Mais ce qui m’intéressait dedans, c’était un article sur Neal Adams, qui était un dessinateur de comics dont j’avais découvert le boulot à travers un article paru dans une revue qui s’appelait Horizon du Fantastique.
Dans cette librairie Dupuis, j’y ai trouvé toutes sortes de choses. J’ai trouvé certains des premiers fanzines, comme The Spider où il était question de BD américaines, et qui n’a eu qu’un seul numéro pour autant que je sache. J’y achetais donc les numéros de Phénix, et il y en avait un qui reproduisait toute une histoire de Edgar P. Jacobs, Le Rayon U, qui était parue avant Blake et Mortimer. J’avais lu ça, j’étais fasciné. J'étais déjà fan de Jacobs et de Blake et Mortimer, mais alors lire cette histoire très ancienne où il y avait déjà en germe toutes sortes de choses qu’on retrouve ensuite dans l'œuvre de Jacobs, comme L’Énigme de l’Atlantide…
Mais dans cette librairie, on ne trouvait pas que des bandes dessinées franco-belges, il y avait aussi de l’importation. J’ai acheté par exemple au moins un album de BD en italien, qui s’appelle Zio Boris (l’Oncle Boris), qui était un strip italien. L'oncle Boris était une sorte de savant fou qui hébergeait chez lui toutes sortes de monstres. Je ne lisais pas italien, mais j’avais déjà acheté au kiosque près de chez moi des numéros du Corriere dei Piccoli et même un numéro de Topolino (Mickey en italien), parce que c’était des BD étrangères et que ça m’intéressait. Mon père travaillait dans une librairie d’occasion, donc il m’avait rapporté un recueil de Peanuts en anglais, un recueil des premières histoires de Mad de l’époque où c'était encore un comic book. Je commençais à apprendre l’anglais alors j'essayais de déchiffrer ça et Mad, ce n’est pas évident du tout.
En revanche, fin 1971, j’ai banqué pour deux énormes bouquins que j’ai encore, sur Batman et Superman, qui étaient des recueils d’histoires des années 1930 aux années 1970. Ça valait un prix immonde à cette époque-là, parce que ça coûtait 80 francs et que mon argent de poche était fixé à 10 francs par semaine. Donc, j’ai dû économiser pas mal. Et heureusement qu’il y a eu la fin de l’année où j’ai eu une prime, parce que comme ça j’ai pu avoir Superman pas longtemps après le Batman.
En 1972, ça été l’année où je me suis abonné à la revue Phénix. J'étais déjà abonné à Tintin, mais là c’était une revue sur la bande dessinée. Dans le premier numéro que je reçois, on donne l’adresse de la librairie Brentano’s. C’était la librairie américaine de Paris. Il y avait des comic books américains en import. J’ai raconté ça dans une BD, dans un numéro d’Egoscopic, où j’ai dit qu’une apparition de la Sainte Vierge m’aurait fait moins d’effet que ce que m’a fait l’effet de ce présentoir rempli de comics américain en VO lorsque j’avais douze ans.
Mon intérêt pour la bande dessinée est venu quasiment de manière organique. C'est-à-dire qu’il y a ces revues, il y a tel auteur… Je regardais le nom de l’auteur quand j’avais six-sept ans. J’apprenais à reconnaître les styles. Lorsque j’ai lu pour la première fois les éditions suédoises de comics américains que m’avait filées un copain, dont la grand-mère habitait en Suède, j’arrivais à reconnaître le style des auteurs. Et il y avait une bande dessinée, on aurait dit du Neal Adams, mais en même temps, c’était pas tout à fait ça. En fait, c’est du Jim Aparo à ses débuts.
Bref, je commençais à identifier les styles. Je reconnaissais le style Greg, le style Gotlib. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à la BD réaliste, sauf à des dessinateurs comme Jacobs ou comme les dessinateurs de comics. Strange, Marvel et tout ça étaient une très bonne école parce qu’il y avait plein de dessinateurs différents qui allaient des fois se retrouver sur la même série. Et on était amené à se poser la question : « Pourquoi j’aime mieux tel dessinateur sur telle série, plutôt que tel autre ? Qu’est-ce qui fait que c’est mieux quand c’est dessiné par machin ? » Et il n’y avait pas que le dessinateur qui changeait, mais aussi le scénariste. « Tiens, mais purée ! Pourquoi est-ce que c’est mieux ou que c’est moins bien quand c’est machin qui reprend le scénario de telle série ? » Finalement, je me suis aperçu que c’étaient des questions que je me posais, et qu’il n’y avait pas beaucoup de monde qui se les posaient (rires).
Bizarrement, dans mon collège, j’avais deux copains qui étaient très intéressés par la BD : l’un qui s’appelait Hervé Graizon, qui a, par la suite, travaillé comme maquettiste, d’abord pour le fanzine Scarce, auquel j’ai collaboré, puis pour les éditions Semic. Puis un autre dont vous avez peut-être déjà entendu le nom : Dominique Poncet. Lui a participé au fanzine PLG, et donne des cours d’histoire de la BD à la même école de BD que moi.
OF : Est-ce qu’il y a une bande dessinée qui vous a particulièrement marqué, avant d’entamer votre parcours professionnel dans la BD ?
JPJ : Pas une bande dessinée, mais plutôt un genre de bande dessinée. Enfin même, une nationalité de bande dessinée. Quand j’ai commencé à bien connaître la bande dessinée, je me suis rendu compte d’une chose : c’est qu’en France, on avait beaucoup écrit, même à partir des années 1960, sur la bande dessinée franco-belge et sur la bande dessinée américaine paraissant dans les comic strips. Mais, hormis des gens comme Jean-Pierre Dionnet (rédacteur en chef de Métal Hurlant) et Marc Duveau (Comics USA, l’histoire d’une culture populaire) par exemple, il n’y avait pas grand monde qui avait écrit des choses sur les comic books . Je peux vous dire que quand Comics USA est sorti en 1975, mon copain Dominique Poncet et moi, on s’est jeté sur ce livre dès sa parution. On l’a lu, relu, dévoré.
On était avides d’informations sur la BD, mais surtout sur les comic books parce qu’on était à fond dessus. Et surtout, j’avais l’impression qu’il se passait beaucoup plus de choses dans la BD américaine que dans la BD franco-belge. Ce qui était peut-être une fausse impression dans les années 1970, mais dans les années 1980, c’était tellement clair. Et il n'y avait pas grand monde qui en parlait. La BD américaine dans les années 1960-1970 était souvent mentionnée par des gens qui se concentraient sur le comic strip et qui n'avaient rien à faire du comic book. Et c’est pour ça qu’avec des copains, dont Dominique Poncet, on a créé un fanzine qui s’appelait Scarce, qui existe toujours aujourd’hui, pour parler de la bande dessinée américaine et en particulier celle paraissant dans les comic books. De super-héros, mais pas que (rires). Moi, j’ai toujours été une personne qui se dit : « Pourquoi personne ne fait ça ? » Quand je vois vraiment que personne ne le fait, je le fais moi-même. Il s’est passé la même chose pour la BD LGBT. Au début des années 1980, aux USA, est paru le premier numéro de Gay Comix, qui était un comic book underground, publié par les éditions Kitchen Sink Press, et qui donnait la parole à des auteurs et des autrices LGBT, même si à l’époque on ne disait pas LGBT. Et, au fil des années 1980, je me suis de plus en plus dit : « Pourquoi personne ne fait la même chose, en France ? » Comme personne le faisait, j’ai lancé mon fanzine Bulles Gay, tout comme j’avais participé au lancement du fanzine Scarce et au lancement du fanzine Mangazone, qui était le premier fanzine à parler de mangas.
À chaque fois, ce n’était pas la découverte d’une BD seulement, mais plutôt d’un domaine, ou d’une potentialité de domaine. C’est à dire soit le comic book américain, soit le manga dans les années 1980, soit la potentialité d’une BD LGBT, qui en France, à l’époque, n’existait pas vraiment.
OF : Et Mangazone, c’était quelle période, à peu près ?
JPJ : Fin des années 1980. Patrick Marcel, un Bordelais, a fait le premier numéro en solo en 1988 ou 1989. C’était dans un format A5, photocopié, superbement fait parce que Patrick a beaucoup de goût et fait les choses toujours très bien. Comme il participait au fanzine Scarce en tant que participant régulier, on lui a dit que s’il voulait faire de Mangazone un fanzine au même format que Scarce, en A4, il n’y avait pas de soucis. Il y a donc eu un nouveau numéro 1 de Mangazone paru entre 1989 et 1990. Le truc qui a été très vexant pour nous, c'est qu’on avait lancé Scarce en 1983 avec un tirage à 500 exemplaires, parce que c’était le tirage minimal pour avoir de l’offset, et on avait mis beaucoup de temps à épuiser les exemplaires et à passer à des tirages plus conséquents. Le n° 1 de Mangazone nouvelle version sort et en trois mois déjà, il est épuisé. Les 500 ex avaient été vendus. On avait mis Dragon Ball de Toriyama en couverture, on avait fait très fort (rires). Et il a donc fallu faire un second tirage du n° 1. On s’en est pris plein la gueule. Là, ça rend humble. C’était le début du phénomène manga et comme il n’y a jamais eu de phénomène comics en France…
OF : Vous avez beaucoup parlé de personnes de votre entourage qui vous ont amené vers ce goût pour la BD. Est-ce qu’il y en a eu d’autres ?
JPJ : En fait, je suis quelqu’un qui avance beaucoup plus par des lectures que par des rencontres de personnes. Par exemple Jean-Pierre Dionnet, j’ai fini par le rencontrer en vrai. Mais, pendant longtemps, c’est juste quelqu’un que je lisais dans Phénix, Métal Hurlant, etc. Et c’est à lui que je dois d’avoir trouvé un endroit où trouver des comics en VO, depuis deux ans que je lisais des comics et que je voulais en lire en VO. C’est lui qui m’a donné la clé, qui m’a donné l’adresse. Mais il me l’a donné dans une revue. De même que quand j’ai eu envie de commencer ma vie de jeune gay, le premier endroit où je suis allé, ça a été une revue gay nommée Gai Pied Hebdo – enfin à l’époque c’était juste Gai Pied – où il y avait des adresses, des petites annonces, des articles, toute sorte de choses.
Il y a quand même eu des rencontres qui ont été décisives. L’une d’elle a été avec Yvan Marie, qui participait à un fanzine sur les comics américains qui s’appelait Galador, qui a eu 8 numéros. Comme c’est un petit milieu, on a fini par se rencontrer. On a bien sympathisé et à un moment donné, avec lui et Frédéric Blayo, participant du fanzine PLG, on est allés en Angleterre pour acheter des comics, parce que c’était beaucoup moins cher qu’en France. À l’époque, voyager était beaucoup plus long et de ce fait, on avait le temps de parler. On s’est alors dit, lors d’un de ces voyages, qu’il fallait faire un fanzine sur les comics. Frédéric Blayo en avait très envie. Et si Scarce a perduré, c’est à cause de Yvan, parce qu’un moment donné, Frédéric, qui était la cheville ouvrière des premiers numéros, a commencé à s’intéresser à d’autres choses. On a donc continué Scarce, avec Yvan, moi et d’autres personnes qui étaient venus se joindre au projet. Il faut savoir qu’Yvan était comptable de profession, quelqu’un de très carré et qui a très bien géré l’association qui éditait Scarce. C’est pour ça que l’association a pu éditer Mangazone et plein de choses. Ça a vraiment été une rencontre importante, parce que le jour où quelqu’un m’a proposé d’aller à Circus pour écrire sur la BD, je ne suis pas arrivé les mains vides. J’avais des articles et des interviews que j’avais faites pour Scarce et j’avais donc la preuve que j’étais capable de faire ce travail-là. Ce que j’ai fait.
Il y a une autre rencontre qui a été assez décisive. Enfin, deux rencontres. C’est, d’abord, quelqu’un que je connaissais sans le connaître depuis que j’étais ado : Stan Barets. Stan avait créé la librairie Temps Futurs, dont j’étais devenu l’un des clients réguliers à partir du moment où il s’est mis à importer des comics en VO. Puis Stan a commencé à travailler pour les éditions Glénat. Un jour, il m’a appelé au secours, parce qu’il s’était embarqué dans la traduction d’un énorme livre sur l’histoire de l’art européen et qu’il était hyper à la bourre. Il m’a demandé si je pouvais m’occuper des deux derniers chapitres, que j’ai donc traduits. Et là, je me suis dit que, finalement, je peux faire de la traduction. C’était un moment où toutes les revues du style Circus et autres s’arrêtaient les unes après les autres. J’avais donc de moins en mois de travaux d’écriture sur la BD, de chroniques de BD. Et à ce moment-là, ça a fait tilt en me disant que je pouvais faire de la traduction. Ce qui était bizarre, parce que j’avais fait des études d’anglais, donc on pourrait se dire qu’on peut naturellement penser à la traduction. Mais l’un de mes camarades avait commis l’erreur de demander à un de nos profs si on pouvait faire de la traduction. Le prof en question nous a répondu qu’il y avait peu de traducteurs littéraires, que les seuls qui gagnent leurs vies sont les traducteurs techniques, spécialisés dans un domaine. Je ne me rendais pas compte que ma spécialité, c’était la BD. Et quand je m’en suis rendu compte, j’ai commencé à en faire. Au début, j’ai cru que je pourrais faire de la traduction de livres. J’ai traduit deux ou trois bouquins. Mais ça m’a un peu embêté de rester tout le temps, pendant des mois, sur le même texte.
J’ai donc commencé à traduire quelques romans, et également des livres pour enfants parce que j’étais allé au Salon du livre jeunesse avec des CV et qu’un éditeur anglais, Usborne , était OK pour qu’on travaille ensemble.
Je suis aussi allé deux fois de suite à la rédaction de Disney Hachette Presse, pour des articles que j’écrivais. La première fois, j’ai rencontré Jean-Luc Cochet. On a très vite sympathisé, d’autant que lui comme moi étions plutôt des amateurs de souris (Mickey) que de canards (Donald). Dans les amateurs de Disney, il y a deux sortes de gens : ceux qui préfèrent les souris et ceux qui préfèrent les canards .
La deuxième fois où je suis allé le voir, j’avais commencé à faire des traductions et je lui ai dit que je pouvais en faire pour eux. Il m’a répondu qu’ils avaient pas mal de traducteurs et je lui ai dit que je pouvais traduire de l’anglais, de l’italien et du néerlandais. Et là, ça a marché, parce qu’il avait besoin de ce genre de profil. Parce qu’il y a trois sources principales de BD Disney. D’abord, la Scandinavie. À l’époque, il y avait un éditeur nommé Egmont qui produisait des BD Disney pour tout le nord de l’Europe, et la langue commune était l’anglais. Donc, les BD qui arrivaient au Journal de Mickey étaient en anglais. Évidemment, il y avait aussi les Italiens, avec le magazine Topolino. Il se trouve que, même si j’avais été en fac d’anglais, j’avais fait un peu d’italien pour justement lire des BD. Et puis, j’avais aussi un peu de néerlandais parce que j’avais été super frustré par le fait qu’en prenant allemand LV2, on n’avait quasiment rien à lire en BD allemande originale. Par contre, lorsqu’on faisait du néerlandais, qui était plus facile si on avait des bases d’allemand, il y avait infiniment plus de choses à lire en BD.
C’est comme ça que j’ai commencé à traduire de la BD pour Disney. Parce qu’au Pays-Bas, ils produisaient et produisent encore pas mal de BD originales avec les personnages Disney. Et encore aujourd’hui, je suis le gars à qui on va demander systématiquement quand on va utiliser une BD Disney avec le sigle H au début, H pour Hollande. Et aujourd’hui, c’est ma principale source de revenus.
OF : Il me semble que vous avez été directeur de collection de Bethy, non ?
JPJ : Oui. Les éditions Bethy étaient une structure d’édition qui a existé deux, trois ans à tout casser, créée par Didier Pasamonik. Je l'avais d’abord rencontré dans une BD : lui et son frère Daniel étaient, dès l’adolescence, des grands fans et certains dessinateurs de bandes dessinées les avaient représentés dans leurs œuvres. J’ai donc rencontré Didier dans un album de Bob de Moor, Les Aventures de Barelli, où à un moment donné il y a une famille nombreuse très sympathique, avec deux jumeaux. Et l’un d’eux était Didier. Par la suite, j’ai lu des livres qu’il avait publiés , en particulier Le Testament de Godefroid de Bouillon, d’Yves Chaland, qu’il avait édité chez Magic Strip. Et à la fin des années 1990, il voulait créer une structure d’édition consacrée à la BD américaine, avec dans l’idée de faire de la BD américaine issus des comic books, en associant à chaque fois des personnages connus avec des grands auteurs. L’idée, ce n’était pas de publier l’intégrale de Spider-Man, mais de publier des albums avec des périodes bien précises, comme « Spider-Man par tel grand auteur ». À cette époque-là, les éditions Semic publiaient en presse les comics Marvel et Image, et Fershid Bharucha, avec son label USA, chez Glénat, avait repris en album pour les librairies des séries comme WildC.A.T.S. qui étaient déjà parus en presse et qui marchaient très bien en librairie. Didier Pasamonik s’est dit qu’on pouvait faire la même chose pour d’autres séries. Il avait dans le collimateur Spawn de Todd McFarlane. Et comme il me connaissait un petit peu et qu’il savait que j’avais bossé à Scarce, que je traduisais, que j’avais écrit sur la BD américaine et que, de son côté, il la connaissait assez peu , il m’a demandé d’être directeur de collection. Ce que j’ai fait pendant deux ans, à peu près. Ça a été une expérience très intéressante, comme toutes les expériences qu’on peut avoir dans le domaine de la BD.
OF : Avez-vous eu d’autres activités plus méconnues ?
JPJ : Il y a quelque chose que peu de gens ne savent, c’est que j’étais responsable de la structure éditoriale qui a introduit en France la BD des Simpson, parce que les éditions Dino, un éditeur allemand, m'avaient contacté pour me proposer de faire ça. Mais, je ne me suis vraiment occupé que des numéro 0, 1 et aussi du lancement d’une série Digimon en même temps que l’adaptation BD des Simpson. Tout ce que j’ai fait là-dedans, ça a été de participer au lancement, parce que je me suis très vite rendu compte que ce qui m'aurait intéressé dans cette affaire, ç’aurait été de faire participer des auteurs franco-belges, parce que Les Simpson étaient très populaires. On aurait pu leur demander de faire des illustrations pleine page, voire pourquoi pas des BD originales avec les Simpson, etc. On n’a pas pu le faire. Ce n’était pas la faute de Dino mais du fait du contrat qui existait entre Matt Groening et sa maison d’éditions Bongo Comics et d’autre part la société de production Fox : il n’y avait personne d’autre que Bongo qui pouvait produire des bandes dessinées. À partir de là, ça m’a beaucoup moins intéressé de m’occuper du projet et j’ai donc laissé tomber très vite. Mais si les Simpson sont arrivés en France en BD, c’est un petit peu grâce à moi.
Un autre truc rigolo : Il y a eu une première vague de manga qui a commencé à arriver en France, à partir de 1993, avec les lancements quasi-simultanés de Dragon Ball et Ranma ½ par Glénat et de celui de Vidéo Girl Ai par Tonkam. Ça a tout de suite soulevé l’enthousiasme des foules, ce qui fait que beaucoup d’éditeurs ont soit créé soit lancé des collections manga. Ce qui fait qu’assez tôt, dès 1995, il y avait déjà des gens qui avaient l’impression d’arriver après la bataille. Yves Schlirf, qui est un éditeur belge avec qui j’avais travaillé aux Cahiers de la BD, se retrouve alors à s’occuper d’une collection de manga au sein des éditions Dargaud, c’est-à-dire Kana. Et un jour, on discute et il me demande ce qu’il pourrait publier qui soit populaire. Il se disait que toutes les séries populaires étaient déjà parues ou en passe d’être publiées. Et je lui dis que les Français sont une peuplade très particulière et qu’il y a une série qu’ils affectionnent particulièrement, beaucoup plus que tous les autres, plus que dans beaucoup d’autres pays : Saint Seiya, Les Chevaliers du Zodiaque en VF. Et personne n’a publié la série. Il me dit que c’est un peu vieux et qu’au niveau du graphisme, c’est pas ouf. Je lui réponds qu’il n’en a rien à faire de ça, qu’en ce moment, des fabricants de jouets comme Bandai publient des Chevaliers du Zodiaque et qu’en France, ces jouets partent comme des petits pains. Même au milieu des années 1990, les gens étaient encore hyper fans. La relation que les Français ont avec cette série est équivalente à celle qu’ils ont avec Goldorak, ou celle que les Italiens ont avec Mazinger. Je lui ai donc dit de foncer et il a publié les Chevaliers du Zodiaque. Ça a marché du tonnerre de Dieu.
OF : Est-ce qu’il y a, dans toutes ces activités que l'on a décrites, une qui vous importe davantage que les autres ?
JPJ : Financièrement parlant, c’est la traduction, sans aucun doute. Encore aujourd’hui, si je touche deux fois par an des droits d'auteurs, c’est surtout grâce à la popularité de From Hell d’Alan Moore et d’Eddie Campbell que j’ai traduit il y a plus de vingt ans, qui se vend toujours et me rapporte encore des pépettes.
Maintenant, si je pouvais arrêter de traduire demain, financièrement parlant j’arrêterais. Parce que je n’ai pas besoin de traduire, en ce sens que les bandes dessinées que j’ai envie de lire, je peux les lire moi-même. Et il faut dire que chez Disney, qui constitue l’essentiel de ce que je traduis, il y a de très bonnes BD, super drôles, etc. Et, il y en a qui sont moins bien, il faut être honnête.
Sinon, les activités les plus importantes… Ce que j’ai pu constater, c’est que des gens viennent encore aujourd’hui me dire à quel point ce que j’ai pu écrire sur la BD, en particulier dans Scarce ou dans Mangazone a été important pour eux, leur a ouvert des horizons. Ça fait plaisir. Surtout que quelque part, ça a été une manière de rendre ce qui m’avait été donné par des gens comme Jean-Pierre Dionnet ou Marc Duveau, ceux-là qui m’avaient donné les clefs de certains domaines de la BD.
Maintenant, il y a aussi d’autres activités que j’aime beaucoup et qui sont très importantes. C’est aussi d’ouvrir de nouveaux domaines de possibilité. Et là, je parle surtout de la BD LGBT.
J’ai lancé mon premier fanzine de BD LGBT en 1989. Et aujourd’hui, je suis encore en train de créer mes propres bandes dessinées ou de publier des BD LGBT, dans le cadre de la revue LGBT BD, dont je m’occupe. Et c’est hyper important. Quelque part, il y a beaucoup d’auteurs qui vont vous dire qu’un jour ils ont lu telle BD et il se sont rendu compte qu’on pouvait le faire. Moi, lorsque j’ai lu Gay Comics, ce n’est pas tant « on peut faire ça », mais plutôt « on peut dire ça ». Parce qu’à l’époque, on ne disait rien. La BD ne parlait que de certaines choses. Si toutes les revues homosexuelles avant Gai Pied ont subi des interdictions de la part du gouvernement, c’est parce qu’il y avait une chape de plomb. Il ne fallait surtout pas en parler. Et quelque part, ce à quoi on assiste aujourd’hui encore, c’est que des gens en ont marre de se taire et qu’ils veulent prendre la parole pour eux-mêmes et ça dérange toujours autant. Il n’y a qu’à voir le backlash qu’il y a avec la prise de parole trans depuis quelques années. Tous ces gens qui viennent nous dire comment les enfants ne peuvent pas décider pour eux, qu’ils sont trop jeunes. Mais ces gens ne se privent pas de décider pour les enfants.
OF : Quels étaient vos projets pour faire exister la bande dessinée ? Quels sont les groupes de bédéphile auxquels vous appartenez ? Comment fonctionnent ces groupes ?
JPJ : Je suis arrivée à un moment où la bédéphile était dans un creux, lors des années 1970. Je pouvais lire dans d’anciennes revues comme Phénix qu’il y avait eu des rencontres de clubs de BD. Sauf que ces clubs avaient tous disparu. Tout ce qui restait des activités des clubs de BD des années 1960, c’était la Convention de la bande dessinée qui se tenait à l’époque à la Maison de la Mutualité . Dès que j’ai su que ça existait, j’y ai foncé immédiatement. J'étais très content d’y retrouver certaines BD et certains comics que je cherchais. Cependant, une chose que je n’ai pas trouvé du tout fut des rencontres, des discussions, des conférences, des choses sur la BD. Il y avait que dalle.
Le premier groupe de bédéphiles auquel j’ai appartenu, c’est celui que j’avais créé avec mes copains Dominique Poncet et Hervé Graizon. Par la suite, quand on a créé Scarce, le groupe qui participait était celui auquel j’appartenais.
Il y a une activité que je n’ai pas mentionnée. Dans les années 1990, j’ai fait de la radio. Principalement avec un gars qui s’appelle Jean-François Hudo qui animait l’émission BD Bulle sur Aligre FM, ex-Radio Aligre. Avant que toutes les librairies aient le mot « bulle », c’étaient les émissions de bandes dessinées. Pendant une dizaine d’années, j’ai fait de la radio dans cette émission, mais aussi en participant à des émissions sur la BD qu’il y avait sur Radio Libertaire, animées d’abord par Guy Lehideux, puis par Christian Marmonnier. Guy est maintenant surtout actif en tant que scénariste, mais c’est quelqu’un qui a fait des choses extraordinaires. Il a travaillé au studio d’animation de Jean Image, il a créé le personnage de Kiri le Clown. À mon avis, ce n’est pas une de ses meilleures idées, parce que même à l'âge de sept ans, je trouvais ça nul. Il a beaucoup travaillé dans la BD, il a dessiné des choses comme Pifou. Bref, il s’occupait donc de cette émission sur Radio Libertaire, ce qui est amusant, parce que Guy est plutôt à droite (rires). Et quand il en a eu marre, il l’a laissée à Christian Marmonnier qui l’a animée pendant pas mal d’années.
OF : Vu que c’était sur Radio Libertaire, il y avait des thèmes en particulier ou c’était assez généraliste ?
JPJ : Ce qu’il s’est passé, c’est qu’on s’est dit : « Tiens, à France Inter, il y a Le Masque et la Plume, on pourrait faire Le Masque et la Bulle. » Et tous les mois, on se réunissait entre critiques de différentes radios – Jean-François Hudo, moi-même, Guy Lehideux, peut-être quelqu’un venant de Radio Aligre – et on essayait d’avoir quatre-cinq bouquins qu’on avait tous lus, pour comparer les avis sur les bouquins en question. C’était rigolo.
Je suis intervenu de temps en temps comme invité sur Bulles Noires, à Radio Libertaire toujours, une émission de Christian Marmonnier.
OF : Vous sentiez-vous rattacher à des collectifs ou vous étiez plutôt indépendant ?
JPJ : Oui et non. J’avais Scarce, Mangazone et dans les années 1990, j’ai participé au fanzine Le Goinfre, avec des BD de jeunes auteurs et une partie rédactionnelle. Philippe Marcel, qui s’occupe désormais des éditions La Cafetière, et moi, les « vieux cons », on était là parce que Le Goinfre voulait étoffer sa partie rédactionnelle. Comme tous les membres étaient sur Paris à cette époque, voire dans le même quartier, on s’est retrouvé à écrire un supplément appelé Le Gourmet, où on retrouvait des infos sur la BD, des critiques, des choses comme ça. Dans Le Goinfre, il y a des gens qui ont démarré, comme Éric Liberge ou Denis Bajram, même si ça lui a servi plutôt de tremplin dans son cas, qu'on connaissait à cause de Scarce.
Dans les années 2000, il y a eu Comix Club auquel j'ai participé. Au bout d’un moment, Big Ben, le rédacteur en chef, était un peu fatigué et il voulait que ça s’arrête. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé rédac’chef, comme d’habitude dans ces cas-là.
Et encore maintenant, je participe à Egoscopic, une revue de dessinateurs qui se dessinent. Mais la sensation de faire partie d’un groupe n’est pas tant présente parce que passé une certaine période, les gens sont un peu répartis partout en France, voire plus loin. Et dans les années 1980-1990, pré-internet, il y avait des gens avec qui on participait et avec qui on correspondait mais qu’on ne voyait jamais ou tous les 36 du mois.
Maintenant qu’il y a internet, effectivement, je fais partie du groupe « J’ai » qui a été créé par Hugo Benavente qui est un groupe où l’on se montre nos BD. Et si quelqu’un l’a, il dit « J’ai » et celui qui a montré la BD a un gage, du genre de payer un coup ou d’envoyer un fanzine. Il y a des défis, c’est très ludique.
Mais en même temps, j’ai toujours un sentiment de ne pas faire vraiment partie d’un groupe. Tout d’abord, pour des raisons personnelles : je suis fils unique, je n’ai pas grandi dans des groupes. Et quand j’ai commencé à aller dans les festivals BD à la fin des années 1980, j’étais avec les gens qui s'intéressaient à la BD américaine, aux comic books, qui étaient perçus comme les bizarros, qui au lieu d’admirer Enki Bilal ou Moebius vont faire suer le monde avec Alan Moore ou Bill Sienkiewicz.
De plus, je suis gay dans un milieu majoritairement hétéro qui n’hésite pas à le montrer. Le nombre de fois où dans des albums, il y a des représentations de femmes peu habillées pour aucune raison particulière, à part que ça plaît à l’auteur, à l’éditeur et que ça risque de plaire aux lecteurs. OK les mecs ! On a compris que vous aimez les nanas avec des seins. Et dans le même temps, il n’y avait pas de représentation LGBT dans la BD franco-belge, ou très peu. Inversement, dans le milieu gay, il y avait très peu d’intérêt pour la BD. C’est en train de changer avec les nouvelles générations. Mais dans le milieu gay traditionnel dans lequel je suis arrivé dans les années 1980, on s’intéressait à la littérature, à l’art, à l’opéra, éventuellement à Dalida ou aux comédies musicales. Mais la BD… La seule BD gay qui était connu, c’était Tom of Finland. Vingt ans après, c’est Ralf König, qui n’a pas été reconnu en France à sa juste valeur.
Pour résumer, je n’ai pas vraiment l’impression de faire partie d’un groupe, même quand c’est moi qui crée le groupe.
OF : Concernant votre bédéphile, comment votre entourage la percevait-il ?
JPJ : J’ai commencé par beaucoup embêter mes parents, parce que j’accumulais les albums dans un même pas 30 m² (rires). Il y avait donc très vite des piles de BD un peu partout. Mais ils n’étaient pas hostiles de quelque manière que ce soit. Ça ne les intéressait pas particulièrement. Mon père, quand j'étais gamin, parlait de mes « petites conneries » pour parler des BD. Le jour où j’ai ramené le premier numéro de Circus avec mon premier article publié, ils n’ont pas percuté. Il se sont dit : « oui, un article publié dans une revue ».
Puis, mon compagnon, avec qui j’ai vécu des années 1980 jusqu’à son décès en 2012, était plutôt encourageant. Après mon service national en tant que coopérant en Australie, pour enseigner le français langue étrangère, je voulais continuer à enseigner le FLE, mais ça ne marchait pas extraordinairement bien. Alors il m’a fait remarquer que toutes mes activités tournaient autour de la BD, qu’il fallait que je me dirige par là. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à prospecter pour écrire sur la BD. J’allais avec lui à des festivals de la bande dessinée, comme celui de Saint-Malo.
Mon mari actuel, alors la BD, il a beau essayé… Il en lisait quand il était gosse. Il lit beaucoup de romans, il s'intéresse à la littérature. C’est bête, parce que ça lui permettrait aussi d’apprendre le français.
Je fais partie de ces gens dont l’entourage a été sympathique, mais pas plus que ça.
OF : Rétrospectivement, quels obstacles avez-vous rencontré ?
JPJ : Ils sont multiples. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris et en plus j'habitais dans le 6e et j’avais école dans le 5e. J’étais dans une position hyper privilégiée par rapport à l’accès à tout ce qui se faisait en termes de BD. Mais dans le même temps, il ne m’est jamais venu à l’idée d’aller voir un auteur de BD. Et pourtant dans notre collège lycée, il y avait Olivier Christin, fils de Pierre Christin. Alors, tous les copains, à un moment ou un autre, étaient allés voir Jean-Claude Mézières, pour lui montrer leur BD. Mais moi, ça ne m’est jamais venu à l’esprit.
Quand je suis allé aux festivals BD, c'était essentiellement la convention de Paris. Et le milieu BD, j’y suis rentré par plus petit que la petite porte, parce que j’y suis rentré via un fanzine sur la BD américaine. J’ai vraiment commencé à rencontrer des professionnels qui travaillaient pour la BD française lorsque j’ai commencé à travailler pour Circus, en 1987. Je travaillais pour Circus et Les Cahiers de la BD. À cette époque, on avait dans le quartier un auteur, Christian Goux, qui organisait tous les mois un déjeuner, qui est devenu un dîner, destiné aux auteurs et amateurs de BD qui avaient envie de se rassembler autour d’une table : le « Saucisson Club », nommé d’après le personnage de Saucisson Smith, créé par Goux. J’avais rencontré Christian lors d’une soirée organisée par les éditions du Lombard.
C’est ainsi que je fréquentais des auteurs et des pro de la BD dans un cadre hors festival. Et j'ai travaillé dans Les Cahiers de la BD, version Thierry Groensteen, qui avait la réputation d’être de sales intellos qui ne comprenaient rien. Et moi qui travaillait dans le journal, j’avais l’étiquette représentative de tous les gens du journal, indépendamment de ce que moi je pouvais écrire. Cela dit, ce n’était pas bien méchant, mais quelque part, je commençais à me rendre compte qu’il y avait d’un côté une profession qui avait hyper besoin qu’on parle d’elle de manière intelligente et en bien, et d’un autre côté les gens qui essayaient de faire ça et qui n’étaient pas du tout compris.
Un autre truc qui a été un coup de pouce en même temps qu’un obstacle : j’ai été très vite catalogué comme spécialiste du comic book. On est venu me dire que j’étais trop limité parce que je ne m’intéressais qu’à la BD américaine. Sauf, que la BD franco-belge, je la connaissais aussi. Je l’avais lu et la connaissais, des fois mieux qu’eux.
Une anecdote. Pendant un mois, j’assistais Thierry Groensteen au CNBDI, au moment où il était en train de finir d’écrire L’univers des Mangas et en même temps de préparer l’ouverture du musée. Il avait un budget pour avoir un assistant. Et l’assistant, c'était moi. Il me fait visiter les archives, et à un moment donné, on regarde des originaux et je vois une planche originale qui était attribuée à je sais plus quel dessinateur. Et je lui ai dit : « Mais non ! Ça, c’est du Tibet. Ça vient de la série Patrick & Mastic. » Et Thierry était scié ! Parce que pour lui, j’étais le mec qui ne regardait que du Jack Kirby, du Jim Steranko ou du Neal Adams. Sauf que Tibet, j’en ai lu et relu. Je connaissais quasiment par cœur Les Cahiers de la BD sur Tibet. J’aime énormément Tibet et donc je l’avais immédiatement reconnu. En fait, quand les gens sont eux-mêmes limités, ils croient que tout le monde est limité. Or, je m’intéresse à toutes les BD. Alors, ce qu’il y a de drôle, c’est qu’au début, les gens croyaient que je n'étais spécialiste que de BD américaines. Et puis le livre L’univers des mangas paraît avec deux textes à la fin, dont un de moi sur les publications en français et en anglais de BD japonaise. Du jour au lendemain, je suis catapulté spécialiste du manga (rires). Ce qui ne manquait pas d’ironie, parce que bon, je ne parlais pas japonais. J’avais lu le bouquin de Frederik L. Schodt, Manga ! Manga ! The World of Japanese Comics. Je lisais ce que je pouvais : des BD japonaises publiées en anglais à l’époque, des BD japonaises en japonais, etc. Bon, j’en connaissais certainement beaucoup plus que la plupart des gens dans le milieu BD à l’époque sur le manga. Mais enfin, de là à être catapulté spécialiste du manga (rires). Et cette étiquette m’est restée collée mais pendant… une dizaine d’années pile poil, puisque en 2002 est sorti mon Histoire du comic book tome 1 : Des origines à 1954, et là, enfin, j’ai de nouveau eu droit à l’autre étiquette de spécialiste du comic book.
Alors, c’est vrai qu’on ne peut pas être spécialiste de tout. Il y a des domaines où je connais très peu de choses, mais en même temps, il y a quand même assez peu de domaines de la BD où je ne connais vraiment rien. Disons que j’ai un ami qui s’intéresse beaucoup à la BD philippine et j’espère qu’il va enfin réussir à sortir son bouquin sur le sujet car le jour où ça sortira, je serai le premier à l’acheter parce que j’aimerais bien savoir de quoi il retourne. Il y a aussi quelqu’un qui vient de sortir un livre sur la BD en Thaïlande qui a l’air absolument passionnant.
C’est ce à quoi je pense en premier en termes d’obstacle : le fait d’avoir été catalogué dans divers domaines.
OF : Est-ce que vous avez été confronté à la censure ?
JPJ : Je n’ai jamais été censuré. Je me rappelle quand Henri Filippini avait sorti son premier Dictionnaire de la Bande Dessinée. Très honnêtement, il y avait tout un tas de passages qui n'étaient ni faits, ni à faire. En particulier la BD américaine, c’était un tissu de n’importe quoi. J’en avais parlé dans Scarce en citant des exemples. Et par la suite, Stan Barets, qui me faisait écrire dans Vécu, m’avait dit que « Tonton Henri » avait très mal pris mon article, alors que tout le monde avait encensé son livre, évidemment. Personne n’avait dit ou remarqué que son bouquin était truffé d’erreurs. Apparemment, il lui aurait dit que si ça ne tenait qu’à lui, je n’aurais plus bossé pour Vécu. Mais ça n’était pas véritablement une censure.
Je ne me rappelle pas qu’on m’ait dit un jour demander de changer quelque chose que j’avais écrit. Ah, si ! Très récemment, il y a eu un truc rigolo. J’ai écrit sur Batman pour Les Cahiers de la BD, ou un numéro spécial des Cahiers de la BD. Un article sur : « est-ce que Batman et Robin sont ensemble ? » J’avais envisagé un premier titre et Vincent Bernière, le rédacteur en chef, avait opté pour un autre titre. Et les gens de DC lui ont dit : « Non ! Non ! Non ! Ce titre-là, ça ne va pas du tout ! » Et donc, il est revenu à quelque chose qui était plus proche de ce que j’avais en tête au départ (rires). Donc, là, pour le coup, la censure, c’est pas vraiment une censure, quoi. Ça a plutôt été dans mon sens.
OF : Quel était l’objectif de donner à lire et à visibiliser des BD états-uniennes en France ?
JPJ : Le premier objectif, c’était d’abord de faire en sorte que ces BD puissent être lues par des Français. Quand on aime quelque chose, on a envie que ça soit partagé avec le plus grand nombre. Par exemple, j’ai travaillé avec Serge Ewenczyk. Quand on s’est rencontrés, il venait de lancer les éditions Çà et Là peu de temps auparavant. J’avais participé à une conférence, je crois que c’était à la Bibliothèque nationale, et il vient me voir et me dit : « J’aimerais bien qu’on se voit. J’aimerais bien travailler avec toi. » Et puis, quand on a discuté, il s'est avéré que Serge pensait à me faire traduire quelque chose dont je me disais qu’il faudrait que ce soit traduit en français. C’était la série Alec d’Eddie Campbell.
Par la suite, j’ai aussi traduit American Splendor de Harvey Pekar. Quelque part, mon objectif, c’était de mettre aux auteurs de BD franco-belge, le nez dans leur caca, en leur disant : « Écoutez les mecs ! Dans les années 1990, vous êtes partis en flamme en disant que c’est vous qui aviez inventé la BD autobiographique, alors que Harvey Pekar la pratiquait depuis les années 1970, et Eddie Campbell dans les années 1980, à une époque où vous étiez encore en train de lire vos Spirou ! » Ils revendiquaient les quelques bribes de BD autobiographiques de Gotlib ou Moebius et de Crumb, mais à côté de ça, ils ne lisaient pas l’anglais. Le mouvement de bandes dessinées autobiographiques a commencé aux États-Unis dans la deuxième moitié des années 1980 et c’est vraiment devenu un mouvement, donc largement avant la France. Et tout ce que ces Français qui n’étaient pas foutus de lire trois mots d’anglais étaient capable de lire, c'était Julie Doucet, parce qu’elle avait écrit en français.
C’est un peu comme quand le premier album de Nicolas de Crécy est sorti, Foligatto. Enfin, en France, tout le monde s'extasie. Au Saucisson Club, justement, à cette époque-là, tous les auteurs professionnels que je voyais étaient en train de s’exclamer : » Ah ! Ah ! Nicolas de Crécy ! Foligatto, etc. » alors que, désolé, dans le premier bouquin de Nicolas de Crécy, y avait rien que l’on n’ait déjà trouvé graphiquement depuis pas mal d’années chez des Américains comme Bill Sienkiewicz.
Mon objectif est aussi de faire sortir un peu le milieu de la BD franco-belge et ses lecteurs de leur provincialisme. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'aujourd’hui, on est le pays du monde le plus ouvert à la BD étrangère. Je vois les gamins de l’académie de bande dessinée où j’enseigne, ils ont été biberonnés à tous les types de bandes dessinées : comics, franco-belge, manga, etc. Et en même temps, dès qu’il se passe quelque chose d’un peu nouveau, la France prend inévitablement deux ou trois métros de retard, quand ce n'est pas carrément la ligne entière. Le dernier cas, c’est la BD sur internet. Déjà dans les années 2000, on a réduit la BD en ligne à ce qu’on a appelé en France « les blogs BD », comme si le seul moyen de faire de la BD en ligne, c’était de faire de la BD autobiographique ou semi-autobiographique. Simplement, les autres manières, personne n’y a pensé et comme encore une fois, les Français ne regardaient pas ce qui se faisait ailleurs que chez eux, ils ne l’ont pas vu. Alors, maintenant, le grand mot, c’est « webtoons », comme s’il n’y avait plus que cette manière-là de faire de la BD en ligne par le scrolling. Et d’ailleurs, ce que j’aimerais actuellement, c'est que les auteurs regardent beaucoup plus du côté de l’autoédition et du financement participatif. Parce que c’est bien beau de pleurer parce que les éditeurs ne vous rémunèrent pas assez, ce qui est vrai, mais d’un autre côté, la personne qui s’intéresse le plus à votre carrière, ça ne sera jamais votre éditeur, ça sera toujours vous-même. Je vois des auteurs qui ont vraiment des gens qui les suivent, qui les apprécient, et ils ne sont même pas foutus de faire un artbook ou un sketchbook qu’ils pourraient imprimer à 500 exemplaires. En les amenant sur toutes leurs séances de dédicaces et en les vendant eux-mêmes, ils se feraient un peu plus de pépettes que simplement sur les albums sur lesquels ils récupèrent 8 à 10 % du prix de vente six mois après, quoi.
OF : Vous pensez à Exemplaire, par exemple ?
JPJ : Pour moi, c’est complètement « exemplaire » de la manière dont les Français sont infoutus de se prendre en main eux-mêmes. Il faut qu’il y ait quelqu’un – dans le cas présent Lisa Mandel, bravo pour elle ! – qui dise : » On va créer une structure pour les gens qui veulent s’autoéditer. » Très bonne initiative. Mais quelque part, je me dis que les gens sont infoutus de faire les choses eux-mêmes. Alors qu’il y a des gens qui y arrivent. J’ai un ami, Xavier Lancel, qui a créé à Lille une librairie qui s’appelle CroâFunding. Et il n’a aucun mal à trouver des auteurs qui s'autoéditent, dont des gens d’Exemplaire. Ce que je me dis quand même, c’est que se prendre en main un minimum, c’est pas du luxe. Moi, je suis toujours désolé quand j’entends un auteur ou une autrice qui me dit : » Oh là là ! J’ai sorti mon bouquin. Ça m'a pris un an ou deux ans de boulot et au bout de trois mois, on le voit déjà plus en librairie. » C’est vrai, mais c’est le système qui est comme ça. Alors qu’est-ce qu’on peut faire concrètement pour faire autre chose ? Tu ne vas pas changer le système, mais qu’est-ce que tu peux faire, toi, pour t’en tirer mieux à ton niveau. Par exemple, combien d’auteurs franco-belges ont un Patreon ? Ou un Teepee ? Je serai bien curieux de le savoir.
OF : De quelle manière avez-vous participé à des festivals ? Est-ce que cela a de l’importance pour vous ?
JPJ : C’est très vaste. J’allais d’abord à la convention de la BD en tant que simple visiteur. À partir du moment où j’ai participé à Scarce, là, j’y suis allée en tant qu’exposant. À partir des années 1990 et surtout des années 2000, j’ai aussi participé à l’organisation.
J’ai aussi participé au SOBD et au FIBD. J’ai animé des rencontres, fait des interviews en public ou servi d’interprète, deux fois. Pour Will Eisner et Don Rosa. J’ai horreur de ça parce que c’est un boulot, interprète, et ce n'est pas le mien. Moi, je suis traducteur. Je suis absolument incapable d’écouter et de prendre des notes en même temps. J’ai déjà du mal à comprendre ce que disent les gens quand ils parlent. Alors, à chaque fois que j’ai dû faire ça, j’ai dit aux gens : « Écoutez ! Vous prononcez une phrase et ensuite, je traduis. » Les auteurs le comprenaient très bien. Will Eisner, par exemple : pas de soucis. Par contre, les journalistes, y en a un qui se lançait dans une question : » Gnagnagna. Patati patata. — Hé, ho ! Coco ! Tututututut. Maintenant, je traduis. » Parce que ce n’est pas mon boulot. Je déteste ça.
En revanche, j’ai animé des rencontres avec des auteurs. Alors, évidemment, j’avais l’expérience de la radio pour interviewer des gens. La plus récente chose dont je me souvienne, c’est il y a quelques années, quand Alison Bechdel est venue à Angoulême et que je l’avais interviewée. Je marchais un peu sur des œufs, parce qu’on devait parler de son livre C’est toi, ma maman et sa mère venait de mourir peu de temps avant. J’étais vraiment un peu nerveux par rapport à ça mais bon, je n’ai pas fait de gaffes. J’étais absolument fasciné par ses mains, parce qu’elle se représente avec des longs doigts effilés et effectivement, elles sont comme ça.
Sinon, j’ai organisé un festival de BD. En fait, j’ai repris l’organisation d’un festival qui avait été créé par une association d’étudiants. Au départ, ça s’appelait BD, Illustration, LGBT, enfin, une couillonnade. Mais c’était leur titre, après tout. Et j’ai immédiatement changé ça en BD & Images LGBT Paris, pour qu’il y ait « Paris » dans le nom. J’en ai fait, en tant qu’organisateur, trois éditions. Et puis, il y a eu le COVID, donc pour le moment, c’est en standby. Je ne sais pas quand ça reprendra. J’aime bien être au cœur de l’événement. Je n’aime pas tant que ça être visiteur. La BD, c’est mon milieu, c’est celui que je connais. Donc quand je suis dans un festival de BD, je ne suis pas le péquin lambda. Je suis soit quelqu’un qui a un stand, soit quelqu’un qui anime une rencontre, soit quelqu’un qui organise un truc… Et c’est plus drôle, c’est plus amusant. J’aime mieux ça.
Mais c’est aussi savoir beaucoup travailler pour les autres, même si on est payé.
OF : D’après vous, la BD est-elle un miroir des changements sociaux des années 1970-1980 ?
JPJ : Oui. Mais pas de tous les changements sociaux. Il y a certains aspects de la société qui passent complètement inaperçus dans la bande dessinée. Je pense bien évidemment à la libération gay. Franchement, si on ne faisait que lire la production et l’édition de BD franco-belge, on aurait à peine l’idée qu’il y a eu une libération gay dans les années 1970 et le début des années 1980. Il y a aussi d’autres aspects comme quand, dans les années 1980, j’ai découvert le travail de Farid Boudjellal. Un album en particulier, absolument extraordinaire, qui s’appelle Ramadan. Qui parlait de la vie des Français d’origine algérienne, tunisienne, marocaine, à cette époque-là ? Quasiment, personne ! Dans la BD, ils n’étaient pas là. Ou très peu. Donc, c’est un miroir, mais c’est un miroir déformant.
Par exemple, dans les années 1970, des revues comme Tintin et Spirou donnaient plus de places à des personnages féminins. C’est le moment où Natacha apparaît dans Spirou en 1969. Je crois que Yoko Tsuno, ça doit être la même année. Il y a d’autres personnages moins connus qui apparaissent à cette époque. Alors, ça reflète effectivement un changement, mais quel changement ?
Parce que la plupart de ces bandes dessinées sont faites par des hommes. Ce sont rarement des femmes qui parlent d’elles-mêmes. Et dans le même temps, la bande dessinée pour petites filles et fillettes, qui existait depuis le début du siècle, disparaît complètement à cette époque-là. Les journaux du style Lisette, Bernadette, Âmes vaillantes, tous ces trucs-là, Fillette et compagnie, Mireille et tout ça, disparaissent. Le public féminin est complètement abandonné par les éditeurs. Et après, on va bâtir ce mythe comme quoi les femmes ne lisent pas de BD, et comme quoi, dans les années 1960, il n’y avait qu’une seule femme qui faisait de la BD : c’était Claire Bretécher. Alors que Marie-Mad, Marie-Madeleine Bourdin de son vrai nom, qui était la dessinatrice de Titounet & Titounette, vient de fêter ses 102 ans récemment. Il y a cette espèce de réécriture permanente de l’histoire de la BD qui, d’une part, ne tient compte que de la BD franco-belge et non pas des bandes dessinées qui était lues par les Français à cette époque-là, et qui d’autre part, gomme complètement ce que les gens qui écrivent cette histoire ne lisaient pas lorsqu’ils étaient gamins. Il a fallu du temps pour qu’on intègre Pif Gadget et Vaillant à l’histoire de la bande dessinée, mais d’un autre côté, toutes les publications des éditeurs catholiques sont encore très peu étudiées. Très peu s’y intéressent, à part les éditions du Triomphe qui est quand même un éditeur d’extrême-droite. Donc en fait, oui, c’était un miroir déformant. Ça représentait les changements de la société, mais en même temps, pas tous les changements. Les changements qui étaient acceptables pour le lectorat. Et il faut voir aussi que, dans les années 1970, les très grosses ventes de bandes dessinées n’étaient pas les hebdos ou mensuels de BD, mais les petits formats qui étaient essentiellement des trucs d’importation. C’étaient des choses comme les Pocket Elvifrance ou les comics américains publiés par Lug ou par Arédit. C’est ça qui se lisait en bandes dessinées.
OF : La fréquentation du milieu bédéphile a-t-elle orienté vos choix de vie ou d’engagement ?
JPJ : Il y a assez longtemps, un ami auteur de BD commençait vivre de la bande dessinée. Ses premiers albums s’étaient bien vendus. Il me connaissait quand même bien depuis un certain temps et il disait : « Toi, je ne sais pas si tu es prêt à faire les compromis nécessaires pour vraiment réussir dans la BD. » Et je pense que c’est vrai. Peut-être pas autant que Bernard Joubert, un très bon ami qui a délibérément fait le choix de ne travailler que pour des gens qui lui laisseraient son entière liberté d’écrire ce qu’il voulait. C’est pour ça qu’il a pendant longtemps travailler pour des éditeurs comme les éditions Capes, plus tard IPM, qui publiaient des revues comme BD Adulte ou BDX, mais où Bernard pouvait s’exprimer sans avoir à prendre de gants et pouvait vraiment dire ce qu’il voulait. Il n'avait pas un rédacteur en chef qui allait lui dire : « Non ! Tu ne peux pas dire ça ! Tu ne peux pas dire que telle BD… » Liberté totale ! Et d’ailleurs, Bernard s’est occupé d’un numéro spécial d’Art Press qui était intitulé Bandes d’auteurs. Et pour lui, la définition d’un auteur, c’est quelqu’un qui s’exprime en toute liberté. Je ne suis pas d’accord avec cette définition, enfin bon, c’était la sienne. C’était celle sur laquelle il était partie pour définir de quoi il allait parler dans son numéro d’Art Press.
Bon, je ne peux pas dire que j’ai eu beaucoup de folles opportunités de devenir riche et célèbre dans le milieu de la BD, mais d’un autre côté, je n’ai jamais eu envie de faire ou d’encourager certains types de bandes dessinées. Dans les livres que j’ai sur la BD, il y en a beaucoup que je lis et relis. Il y en a un que j’aime beaucoup, c’est la biographie d’Arleston, un auteur que je ne connaissais pas du tout parce que je n’ai jamais lu Lanfeust et compagnie. Et j’ai trouvé un personnage vraiment sympathique à travers ce livre, vraiment passionné. Et ce qui est drôle, c’est que dans la deuxième moitié des années 1980, on n’était pas tout à fait dans la même situation, mais pas loin. Il essayait de placer des projets dont il avait écrit le scénario auprès d’éditeurs. Et je me rappelle qu’il avait écrit des histoires courtes qui étaient parues dans Circus, à un moment où Circus, dans sa dernière formule, était très ouverte aux jeunes auteurs et ils pouvaient y faire leur bande d’essai. Et quand j’ai lu cette longue interview, je me suis dit que ce qu’a fait Arleston, je ne pouvais pas le faire parce que cette BD que lui voulait vraiment faire, c’était une BD franco-belge classique d’aventure, peut-être humoristique. Et moi, ça ne m'intéressait pas. J’ai travaillé un petit peu dans l’écriture, professionnellement. Par exemple, j’ai écrit le scénario d’une BD dans Le Journal de Mickey qui s’appelle Donald speaks English, qui était en anglais pour que les jeunes lecteurs pratiquent un peu la langue. En dessous, il y avait les textes en français, pour les flemmards . Et, là pour le coup, je me sentais tout à fait à ma place parce que je baignais dans l’univers Disney depuis l’enfance. J’étais tout à fait capable d’écrire une série à gags comme ça. J’ai pu faire ça pendant cinq ans, sans le moindre souci, sans la moindre censure non plus d’ailleurs. Et ça a été une très bonne expérience. Mais il y a des choses que je ne me sens pas, que je ne me sentais pas et que je ne me sentirai toujours pas capable de faire. J’ai plusieurs fois écrit des scénarios pour des auteurs. Par exemple, une fois dans Le Goinfre, Denis Bajram avait créé un personnage de prêtre-exorciste et je lui ai fait un scénario pour une petite histoire qu’il a illustré. Et ça a été une de mes meilleures expériences de scénaristes, parce que je n’ai pas toujours été satisfait de la manière dont les gens illustraient les quelques scénarios que j’ai pu écrire. Alors, clairement, techniquement, ils dessinaient toujours mille fois mieux que moi, mais ce n’était jamais exactement ce que je voulais. Et il y a toutes ces bandes dessinées que moi seul pourrait dessiner, soit parce que c’est des BD autobiographiques, soit parce que c’est des sujets qui me tiennent tellement à cœur qu’il faut que ça soit moi qui le dessine. D’ailleurs, je n’écris pas un scénario, je le dessine. C’est-à-dire que je le mets déjà en scène au fur et à mesure que je le découpe, avec les dialogues et tout ça. Je ne peux pas écrire simplement un texte…
OF : Vous voulez dire que vous faisiez un storyboard ?
JPJ : Dans ce cas précis, oui, on peut appeler ça un storyboard. Plutôt que de prendre une feuille, où je vais écrire : « Page 1, Case 1, nananan. Le personnage fait ci et ça, et il dit “Gnagnagna.” », je vais faire un croquis très rapide où je montre le personnage en train de faire ci et ça, et de dire « Gnagnagna ». C’était la façon dont je procédais avec Philippe Barbier, qui dessinait Donald Speaks English. Comme j’étais toujours à la bourre, en plus, je dessinais mon rough de scénario et je lui envoyais comme ça directement par fax. C’était l’époque des fax. Et il n'avait pas besoin de lire un descriptif.
Pour en revenir à la question, concernant l’engagement : non. Quand j’ai fait du volontariat, ça a été dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec la bande dessinée.
Pour les choix de vie… Mes choix de vie, ils se sont faits. Ce ne sont pas des choix. Je suis Parisien. Je suis né à Paris. J’ai grandi à Paris. J’ai toujours voulu rester à Paris, donc, j’allais pas partir à Pétaouchnok, vivre au milieu des chèvres et des moutons. Mon ami Bernard Joubert, dont je vous parlais, lui, est parti vivre à la campagne. Ça lui permettait de vivre avec beaucoup moins d’argent, tout en continuant son métier de journaliste et d’écrivain sur la bande dessinée, en ayant des revenus faibles. Mais moi, le problème ne s’est pas posé. Et de toute façon, je ne quitte pas Paris. Attention ! (Rires)
OF : Que pensez-vous des prix existants sur la bande dessinée ?
JPJ : Il n’y a pas très longtemps, j’écoutais un podcast américain et j’ai entendu une chose que je trouvais très juste, c’est que les prix servent à assurer la promotion d’un secteur de l’édition, dans ce cas précis celui de la bande dessinée, à un moment précis de son existence. Donc, finalement, on parlait de « bande dessinée : miroir de son époque », et les prix reflètent aussi l’état de la bande dessinée. Là aussi, c’est un miroir, mais un miroir de l'état du marché de la bande dessinée, de ce que les éditeurs proposent et de ce que les professionnels veulent mettre en avant. Dans l'ensemble, ce dont j’entends parler, je trouve plutôt bien. On a souvent reproché au prix d’Angoulême de changer tout le temps. C’est normal qu’il change tout le temps. D’ailleurs, à une époque, il ne changeait pas et là, j’aurais beaucoup de reproches à faire.
OF : Vous parlez de prix de festivals. Je pensais aussi au prix de la bande dessinée en euros, en dollars… monétaire…
JPJ : Ah, les « price », pas les « awards »… Il aurait fallu me poser la question en anglais (rires). Les éditeurs s’accrochent désespérément à cette idée que la BD est quelque chose de populaire et d’accessible à tout le monde. Ça peut l’être, mais ça ne l’est pas forcément. Quand on voit l’éventail de prix qu’il y a entre le manga lambda, qui doit coûter aujourd’hui 6 ou 7 euros, et à côté certains romans graphiques qui sortent à pas loin de 30 euros, c’est vrai que la gamme est assez étendue et ne correspond pas du tout au même produit, au même lectorat, etc.
Il me semble que dans l’ensemble, c’est quand même bien adapté. Parce que la question, c’est que le prix soit adapté au public susceptible d’acheter le livre. Et ce n’est pas gênant qu’un roman graphique soit à 30 euros si le public susceptible de l’acheter a les moyens de l’acheter.
Depuis deux ou trois ans, certains romans graphiques ressortent au format de poche. Encore très récemment, pour les livres d’Alison Bechdel, Fun Home et C’est toi, ma maman, et surtout pour Hicksville de Dylan Horrocks que j’avais traduit et qui a été une grosse déception. Il s’était très bien vendu quand L’Association l’avait sorti, puis ressortie, mais la version Casterman, qui était un peu plus luxueuse, n’a pas beaucoup marché. Je pense qu’il y a pas mal de romans graphiques depuis les années 2000 qui mériteraient la seconde chance de passer en poche. Et, coup de bol, les livres de gens comme Alison Bechdel ou Dylan Horrocks passent très bien dans un format plus réduit. Je viens de voir qu’on vient de sortir dans un format réduit pas mal de comics classiques comme Watchmen, ou The Killing Joke, des choses comme ça. Là encore, c’est quelque chose que je trouve très positif, parce qu’une œuvre a beau être ambitieuse quand elle sort, ça ne garantit pas nécessairement de trouver un public sur le long terme. Et encore faut-il qu’elle reste disponible. Ce format de poche, plus réduit, c’est une des choses qui permet à une œuvre de rester disponible plus longtemps sur le marché. J’en suis très content. J’espère que Sam Zabel and the Magic Pen, qui était le livre suivant de Dylan Horrocks, aura cette chance aussi parce que c’est vraiment des livres qui le méritent. Il y a une multitude de romans graphiques qui sont sortis chez plein d’éditeurs qui mériteraient de ressortir en poche pour trouver un nouveau public. Mettre 30 euros dans un bouquin, quelque part, il faut être sûr que ça va les valoir. Et il faut dire que parfois, les éditeurs n’en font parfois pas beaucoup ! Quand je vois un album ou un roman graphique qui coûte 15, 20, 25 euros et qu’il n’y a même pas de résumé de l’histoire en 4e de couverture, je me dis : « On joue à quoi, là ? À la roulette russe avec cinq balles dans le barillet ? » On ne peut pas toujours compter sur la presse pour faire le boulot, surtout quand il y a des dizaines de bouquins qui sortent tout le temps.
OF : Quelles sont les évolutions positives et négatives que vous percevez depuis que vous avez intégré le milieu bédéphile ?
JPJ : Dans les évolutions positives, il y a plus de femmes, à tous les niveaux. Il y en avait déjà beaucoup, mais à des niveaux où on ne les voyait pas. Il y a beaucoup d’autrices évidemment, mais aussi au niveau éditorial, comme les coloristes qu’on met plus en avant par exemple. Il y a aussi plus de lectrices. Quand j’ai intégré le monde de la BD au niveau éditorial, les lectrices n’avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent parce que toute la BD de la presse féminine avait disparu. Et pourtant, les jeunes lectrices étaient extrêmement demandeuses. Dans les années 1990, Disney a lancé une revue Minnie Mag, avec donc Minnie comme personnage principal. Très honnêtement, ça cassait pas trois pattes à un canard, c’était du Disney de seconde zone. Et puis, ils ont publié la série italienne W.I.T.C.H. et très rapidement, Minnie a changé de titre et est devenu W.I.T.C.H. mag, et ça a décollé du tonnerre de Dieu. Parce que W.I.T.C.H. était une excellente BD, très bien foutue, lisible, attachante, intéressante, etc. Ça pouvait motiver n’importe quelle lectrice entre 8 et 14 ans autrement plus que Minnie Mag, quoi. Et on a fini par se rendre compte que dans la presse, que les lecteurs, c’est aussi les lectrices (rires). Ça, c’est un des points positifs.
D’autres points positifs : il y a davantage de représentation. Des LGBT, puisque c’est ça qui m’intéresse le plus. Peut-être aussi des gens qui ne sont pas des blancs, de mon teint, quoi. Mais ça, j’en suis quand même moins sûr.
Une autre évolution très positive, c’est qu’on a des jeunes auteurs qui ont grandi en se nourrissant à tous les types de bandes dessinées. On voit des tas de jeunes auteurs qui ont clairement intégré les influences japonaises, américaines, etc. et qui produisent des choses vraiment bien. Et qui plus est, les éditeurs sont au rendez-vous pour publier ces choses-là.
Cela dit, du côté du négatif, les auteurs sont toujours dans cette espèce d’infantilisme qui consiste à penser qu’ils sont entièrement dépendants de papa-éditeur. Et que si papa-éditeur ne veut pas publier leur BD, forcément, papa-éditeur a raison. Ça ne leur viendrait pas à l’esprit de se créer un site internet et de publier leur BD directement en ligne. On va me dire que c’est pas comme ça qu’on va en vivre. Oui, si on ne fait que ça, mais il y a des tas de gens qui vivent en dessinant en ligne et en se faisant par exemple payer pour dessiner dans leur style un personnage. Il existe sur internet toute une économie de l’image, dont la BD et les éditeurs français n’ont pas l’air de vraiment concevoir ce que c’est. Et ceux qui en ont conscience ont plutôt tendance à s’en méfier. Dans l’école de BD où je travaille, on sait que certains étudiants ont des comptes Instagram et qu’ils dessinent et y publient des dessins. Certains d’entre eux se font payer pour dessiner, faire des illustrations, etc. Mais, on n’a pas l’air de concevoir comment cette activité peut se concilier avec une activité de créateur de BD plus traditionnelle. Alors, qu’au contraire, c’est génial ! Voilà des gamins qui ont déjà les moyens d’avoir des revenus, de gagner de l’argent avec leur crayon. Et ça pourrait les aider à justement avoir plus de force par rapport à des éditeurs traditionnels, parce qu’ils ont déjà un réseau. Ils ont des gens qui apprécient leur style. Et on voit ça comme un désavantage, comme une facilité qui les détournerait de la vraie BD. Il faudrait être pauvre mais honnête pour être un vrai auteur de BD. Excusez-moi, mais bon, crever la dalle, c’est bien gentil pour les autres.
Je crois qu’il y a finalement un aspect négatif de la scène BD qui existe depuis que j’y suis et qui existait sans doute déjà avant que j’y sois : c’est cet aveuglement des gens qui devraient être très curieux de ce qui se passe un peu partout et qui, au contraire, se ferment et ne se demandent pas comment ça peut profiter au médium BD et aux gens qui le font. J’ai fait partie pendant trois ans de la commission bande dessinée du CNL. C’était très vraiment bien parce que les autres gens y étaient sympas. On a eu des discussions très chouettes. Et à côté de ça, je me demandais s’il y a vraiment un avenir dans le fait de donner périodiquement 15 000 balles à quelqu’un pour qu’il fasse un album ? Est-ce ce que ça va vraiment aider la profession dans son ensemble ? Je ne sais pas. C’est clairement un certain type de BD qui était aidé. J’ai fini par nommer dans ma tête la commission BD, la « commission Télérama ». Et, pourtant, je suis lecteur de Télérama. Mais, chaque fois que je voyais le type de BD qui était sélectionné, et le type de BD qui n’était même pas envisagé, voire qui avait d’indéniables qualité mais qui n’était pas aidé. On est dans un certain esprit. En plus, les bandes dessinées autoéditées ne sont pas prises en compte. Ça veut dire que vous pouvez avoir publié quatre ou cinq albums vous-même, ça ne vaudra jamais autant dans un dossier que le fait d’avoir un album publié par un éditeur. C’est une attitude qui existe au sein du CNL depuis au moins quinze ou vingt ans. Je m’en étais déjà étonné en discutant avec quelqu’un du CNL lors d’une rencontre pendant l’université d’été de la bande dessiné, il y a plus de dix ans de cela. C’est leur idée de la « Sacro-Sainte Chaîne du Livre », comme quoi un livre autoédité ne rentre pas dans la chaîne du livre parce qu’il n’est jamais déposé en librairie, en dépôt-vente ou autre par la personne qui l’a édité. C’est totalement en dehors de la chaîne du livre. C’est absurde comme raisonnement. Il est évident qu’un livre autoédité va être imprimé chez un imprimeur. Que son auteur, une fois qu’il aura imprimé 200 ou 500 exemplaires, ne va pas rester assis dessus en attendant qu’ils fondent au soleil : il va les vendre. Peut-être en ayant fait un financement participatif, donc les gens qui l’auront acheté à l’avance auront leur exemplaire. Ensuite, il va aller dans des festivals, des conventions, etc. Il ira peut-être déposer des exemplaires dans une librairie, pas loin de chez lui. Cette idée comme quoi, pour que quelque chose existe, il faut que ça passe par la fameuse chaîne du livre, c’est pour moi une idée très nocive. Ça entérine tous les défauts qu’il peut y avoir dans cette fameuse chaîne du livre, c’est-à-dire la précarisation des auteurs, leur infantilisation, leur dépendance à des éditeurs qui, dans certains cas sont certes pleins de volonté, mais soit ne peuvent pas beaucoup les payer, soit ne veulent pas les payer du tout. À mon avis, c’est plus souvent le premier cas. Quand de très gros éditeurs comme Dupuis ou Casterman font des tirages initiaux à quelques milliers d’exemplaires, c’est évident qu’ils ne peuvent pas donner une avance sur droit comme sur un bouquin qui va se vendre à 20 000 ou 30 000 exemplaires. Ils ne peuvent pas savoir si le bouquin tiré à 3000 va se vendre à plus que ça.
Un autre côté positif, c’est que les auteurs ont quand même plus collectivement conscience d’être des auteurs et d’avoir certaines conditions de travail. Le fait que la Ligue des auteurs professionnels se soit créée et qu’elle ait pas mal d’activité, c’est un signe très positif.
OF : Est-ce que vous percevez des réactions négatives autour de la diversité dans les représentations ? Est-ce que ça a évolué ?
JPJ : En France, je ne le sens pas tant que ça. Certaines attitudes existent mais elles sont peut-être moins médiatisées. Par exemple, si une bibliothèque scolaire dans le Kansas se met à interdire Maus ou Fun Home, on va en entendre parler ici. Par contre, si une bibliothèque municipale du côté de Sète voit son budget diminué par la mairie RN , voire qu’elle est menacée si elle ne prend pas certains bouquins et n’en élimine pas d’autres et se voir couper ses subventions… Là, on ne va pas en entendre parler, alors que ça existe bel et bien. Mais bon, je vois toujours les choses par l’aspect positif. Si, aujourd’hui, les mollahs ont besoin de tirer sur les femmes qui vont manifester en Iran, c’est bien parce que les femmes vont manifester pour leurs droits en Iran et qu’elles en ont marre de ces connards. Si Poutine a pris comme tête de turc les LGBT, c’est bien parce qu’il y a une véritable montée en puissance des associations LGBT et une prise de conscience de la société russe que les LGBT ne sont pas une idéologie menaçante venue de l’étranger ou une bande de pédophiles qui veulent violer vos gosses. Quand il y a une loi réactionnaire contre quelque chose, c’est parce que ce phénomène existe et acquiert de la visibilité dans la société. Et à ce moment-là, les représentants de la société patriarcale se crispent et montrent leur vrai visage. Dans le milieu même de la bande dessinée, je ne le vois pas trop, même si c’est un tout petit milieu. Donc on y trouve quand même tout ce qui existe en grand dans la société. Par exemple, Bastien Vivès fait un bouquin où il parle de la sexualité d’un enfant. Immédiatement, il y a des gens qui lui sautent dessus en disant que c’est un affreux pédophile. Ça ne m’étonne pas de ces gens-là
On parlait de censure tout à l’heure. Quand Lost Girls, d’Alan Moore & de Melinda Gebbie, a été publié par Delcourt, Delcourt avait demandé l’avis d'Emmanuel Pierrat qui est un avocat avec pignon sur rue à Paris et qui depuis des années fait carrière en censurant les bouquins. Il dit aux éditeurs : « Ce que vous allez publier là est très dangereux. Vous risquez des procès. Vous risquez des interdictions. » Mais dans le domaine de la BD, la commission de 1949 sur les publications destinées à la jeunesse n’a plus rien interdit en bande dessinée depuis 20-25 ans. Et donc : « Je vais vous relire tout ça et je vais vous retirer les passages qui pourrait vous poser des ennuis. Vous n’avez qu’à me payer tant. » Et Delcourt, qui avait quand même fait traduire et lettrer le bouquin, était à deux doigts de ne pas le publier. Heureusement, Bernard Joubert lui a écrit en le rassurant et en lui disant : « Non, non ! Tu risques rien. » Il a publié Lost Girls et c’est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Ce qui prouvait que Pierrat était un imposteur complet et que la bande dessinée est quand même moins sous le feu des projecteurs de l’actualité médiatique que d’autres domaines.
Quand on est complètement dans un milieu, on a tendance à ne pas avoir une vue extérieure. Il y a quelques années, quand on a parlé de parité par exemple, le festival de la bande dessinée d’Angoulême a été forcé d’avoir la parité au sein des jurys distribuant les prix. Et ça été fait au niveau de tous les prix, y compris au niveau de la BD alternative. Ce prix est d’ailleurs complètement négligé par la direction du festival depuis des années. Ils laissent Philippe Morin s’en occuper, tout seul dans son coin, on lui laisse zéro moyen. Aucune attention n’est portée au niveau des médias. Rien n’est fait pour aider ce prix qui est quand même important. C’est le seul prix décerné pendant le festival qui soit vraiment international. Pas mal de revues couronnées au fil des ans n’étaient pas en français. J’ai dit à Philippe Morin : « Quand le festival t’a demandé cet effort qui était quand même de trouver trois ou quatre spécialistes ayant des organes génitaux féminins pour rétablir la parité au sein de ton jury, tu aurais pu demander quelque chose en échange comme une présélection pour les prix ou que ça soit inscrit dans le livret. » Le fait qu’on lui ait demandé de le faire, de même que pour les autres prix, c’est quand même quelque chose. C’est important. C’est aussi l’idée que bon, la bande dessinée n’est pas lue que par des mecs. Cis-hétéros. Blancs (rires). Enfin, non-racisés, quoi.
Et puis de temps en temps, toujours sur Facebook, il va y avoir quelque chose, généralement un article du Figaro, qui parle d’un truc qui se passe aux États-Unis, bien déformé dans le sens du Figaro.
OF : Comme ils ont fait pour le comic book sur le coming-out du fils de Superman, par exemple ?
JPJ : Oui, des choses comme ça. Histoire de dire aux Français : « Mais, vous vous rendez compte, ces Américains, ils font n’importe quoi. Ça va trop loin ! » C’est la phrase-type que tout réac devrait avoir écrite sur son T-shirt… s’ils portaient des T-shirts : « Ça va trop loin ! »
OF : Vous avez d’autres points positifs/négatifs ?
JPJ : Un point très négatif, c’est cette impression qu’ont eu longtemps, et qu’ont sans doute encore beaucoup les professionnels de la BD franco-belge de faire la meilleure BD du monde. Non, mais les mecs ! Ça va les chevilles ? D’abord, c’est souvent des mecs. À la fin des années 1980, ça se traduisait par le fait que les seules BD étrangères qui étaient publiées en album en France, c'étaient des bandes dessinées sur le modèle franco-belge. On publiait des Argentins, des Italiens, des Espagnols, à partir du moment où ils lisaient des BD franco-belges. Voilà. En revanche, les Américains, les types qui faisaient du comic book et tout ça… Il y avait eu ce truc merveilleux dans (À Suivre), quand ils avaient décidé de faire des suppléments au format comics. Les deux premiers, c’étaient les deux épisodes du Silver Surfer dessinés par Moebius et avec un scénario de Stan Lee. C’était une grosse bouse, mais selon l’éditorialiste d’(À Suivre) à l’époque, ça « allait donner ses lettres de noblesse au comic book ». Rien que ça. Non, mais franchement ! Je vous parle d’un truc ridicule qui s’est passé il y a trente ans mais encore aujourd’hui, il y a des gens qui s’imaginent que la BD franco-belge est la meilleure du monde. Alors, ce n’est pas pour dire qu’elle n’est pas bonne ou qu’il n’y a pas de bons auteurs, mais il faut se poser la question de ce qu’est un bon auteur. Ce ne sont pas forcément les critères qui sont généralement mis en avant, genre un beau dessin. Combien de fois j’entends dire, par des Américains en particulier : « Ah, ouais ! Moebius sait vachement bien dessiner ! Dommage qu’il n’y ait pas de scénarios ! » J’ai ce problème avec certains auteurs franco-belges qui se regardent dessiner et qui vivent sur leur réputation.
Il y a des choses que la BD franco-belge fait bien, comme les albums de BD traditionnels, sauf que ça bat de l’aile au niveau des formats. Il commence donc à émerger des solutions de remplacement, des choses comme la BD documentaire, par exemple, ou l’adaptation de romans en romans graphiques. Ce sont des pistes intéressantes, parce qu’il y’a un véritable savoir-faire franco-belge dans ce domaine qui mérite d’être exploité. Mais, à côté de ça, il y a, je dirais, des pistes qui ne sont totalement pas suivies.
Pour aller plus loin
Entretiens bédéphiles