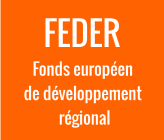« Il ne leur déplaît point d’être forcées » Sur l'imaginaire médiévaliste du viol dans la bande dessinée
[avril 2025]
La citation du titre est extraite de La Cité des dames (1405) de Christine de Pizan.
Cet article vise à élucider une imagerie marquée par l’imaginaire du viol. Ce faisant, nous n’avons pas jugé nécessaire d’en exposer les images. Les descriptions et analyses parlent d’elles-mêmes. Les images sont toutefois largement disponibles en ligne et dans les albums en question, pour celles et ceux qui souhaiteraient les consulter.
Depuis les années 1980, la mise en scène du sexe et de la violence au sein d’œuvres de fictions médiévalistes tend à s’amplifier. De fait, cette décennie voit s’affirmer une tendance entamée à partir des années 1970 : celle du réalisme historique (Corbellari, 2009, p. 85-109). La réputation sombre et inquiétante du Moyen Âge favorise alors les représentations iconographiques et littéraires de viols ou d’agressions sexuelles, perpétrés par des hommes toujours prompts à soumettre les femmes à leur désir (Alexandre-Bidon, 2016, p. 112). Pour s’en convaincre, nul besoin de se plonger dans la lecture assidue de ces bandes dessinées. Un rapide coup d’œil sur leurs couvertures suffit à s’en rendre compte. Par exemple, le premier tome des Tours de Bois-Maury d’Hermann représente une femme terrifiée, Babette, pourchassée par un homme qui s’apprête à se saisir d’elle. Les Aigles décapitées, série médiévaliste parue à partir de septembre 1986 dans le magazine Vécu et créée par Patrice Pellerin et Jean-Charles Kraehn, n’échappe pas à cette règle.
Les stéréotypes d'un Moyen Âge bestial
En matière de réception, on peut affirmer que la période médiévale est d’emblée soumise à une très forte dévaluation. De fait, la notion de « Moyen Âge », introduite par Pétrarque au XIVe siècle, vient du latin medium temps, littéralement « âge du milieu ». Cette dénomination précise se retrouve d’ailleurs dans d’autres langues comme en anglais (Middle Age) ou en espagnol (Edad Media). Ces dépréciations étymologiques volontaires sont particulièrement révélatrices : qu’il soit « moyen » ou « du milieu », ces termes indiquent que cet âge a été a priori pensé pour loger dix siècles d’histoire enserrés entre deux époques « brillantes » : l’Antiquité et la Renaissance (Eco, 2016). Période considérée comme obscure par essence, période difficilement définissable, elle peine à se départir de sa mauvaise réputation et se trouve être depuis des décennies le lieu privilégié de représentations de toutes sortes d’atrocités et de violences. Cet imaginaire s’est en parti construit sur ce que l’on sait du début et de la fin du Moyen Âge (Di Carpegna Falconieri, 2019). D’un côté de la frise chronologique, on retrouve les invasions barbares qui provoquent la chute de l’Empire romain, de l’autre, la guerre de Cent ans, le début de la chasse aux sorcières et la peste suscitent l’effroi et l’inquiétude. En outre, tout au long du Moyen Âge, bon nombre de commentateurs et de clercs instrumentalisent ce discours sur la violence. Ceux-ci s’appliquent à décrire les crimes les plus atroces dans l’intention, entre autres, de les dénoncer au nom de la « paix de Dieu » ou de faire de la peur de l’autre un élément fédérateur dans le royaume. Mais, comme le note Claude Gauvard dans Le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval : « Ce discours sur la violence est repris, sans réelle discussion jusqu’à nos jours, comme le témoignage d’une réalité sociale médiévale spécifique […] » (Gauvard, 2014, p. 1201).
Ainsi, toutes ces idées reçues fournissent un cadre idéal pour soutenir des réinterprétations et des surexploitations de motifs choisis, non pas pour s’approcher d’une quelconque réalité médiévale, mais bien pour extérioriser des tabous, des fantasmes ou des questionnements propres à chaque époque. En effet, au cours de la période médiévale, la violence n’est probablement pas plus répandue qu’à d’autres époques et n’est certainement pas perçue de la même manière qu’aujourd’hui. Le mot même n’est que très peu employé. Il est intéressant de souligner que les rares fois où il est utilisé, c’est justement pour parler du viol : « on fait ‘‘violence de pucelle’’. La violence fondatrice est là, dans cet excès condamné car il bafoue les lois fondamentales de la reproduction » (Ibid., p. 1203). L’acte sexuel forcé sur une jeune fille est violent car il se situe hors du mariage. Dans cette société, la perte de l’honneur de la victime (et de sa famille qui n’a pas su la protéger) est donc perçue comme étant infiniment plus grave et plus cruelle que l’agression en elle-même.
Il faut noter que la peinture de la sexualité médiévale dans Les Aigles décapitées se fonde essentiellement sur un présupposé ancré dans les imaginaires depuis des siècles : les pratiques sexuelles au Moyen Âge seraient débridées, pulsionnelles, presque bestiales. Cette idée se développe à partir du XVIIIe siècle. L’essor du libertinage entraine la réédition de fabliaux dont la composante est souvent érotique. Aux XIIe et XIIIe siècles, ces courts récits populaires au ton facétieux sont très appréciés. La représentation du sexe, décrit sans grande forme de pudeur, est un élément déterminant pour la mise en place de situations cocasses où une épouse, un amant ou encore un moine ripailleur se jouent d’un mari ou d’un homme facile à berner. Ce phénomène popularise l’exploitation de certains de leurs motifs dans les créations littéraires de cette époque. Toutefois, c’est principalement au XIXe siècle que ce préjugé se fixe. Dans ce siècle au cours duquel le Moyen Âge gagne en popularité, les mœurs bourgeoises du temps valorisent davantage les sentiments aux dépens des plaisirs charnels. Les désirs sensuels s’expriment alors à travers un ailleurs géographique tel l’orientalisme, ou bien temporel, avec le médiévalisme (Blanc et Ribémont, 2022, p. 402). Il convient toutefois de préciser que la reprise du Moyen Âge ne s’arrête pas à la représentation explicite d’une sexualité effrénée. Bon nombre de mythes tenaces sur la période médiévale ont vu le jour au XIXe siècle et les artistes de cette époque en proposèrent une vision fort contrastée. Le Moyen Âge peut ainsi apparaître comme un temps violent et obscur mais aussi comme un temps lumineux et pur même si l’adaptation d’un Moyen Âge ténébreux est devenue dominante. La mise en scène, en mots ou en cases de la barbarie médiévale envahit nos fictions et le viol, à la fois dérangeant, transgressif et excitant, y trouve invariablement sa place.
Dans les séries médiévalistes de bandes dessinées contemporaines, les personnages assument une fonction précise, stéréotypée et genrée. Généralement, les personnages masculins tiennent les premiers rôles. Ils peuvent être chevaliers, magiciens, guerriers, seigneurs bienveillants ou cruels. Les personnages féminins, quant à eux, se retrouvent traditionnellement au second plan, ce qui explique en partie pourquoi leurs fonctions sont limitées. Dans l’ensemble, les femmes ne peuvent prétendre qu’à deux positions, souvent opposées : celle de la jeune noble aimable, gracieuse et passive ou celle de l’antagoniste au héros, maléfique et entreprenante. Si ces archétypes récurrents rendent possible une identification rapide et efficace de la fonction narrative et symbolique de chaque personnage au sein du récit, ils privent définitivement les personnages féminins de sortir des clichés qui leur collent à la peau. Justine Breton, dans son ouvrage Moyen Âge en clair-obscur, note à juste titre que cette limitation des personnages féminins à un rôle secondaire, et bien souvent passif, tend à les réduire à des « objets nécessaires à la narration » (Breton, 2023, p. 302). De plus, ces femmes se définissent souvent par rapport à une figure centrale masculine et active, qu’elles mettent en avant ou qu’elles dévalorisent. Le corps féminin, objectifié, devient un sujet de convoitises et de fantasmes, soumis à d’innombrables violences sexuelles. Le viol, surreprésenté dans de nombreuses œuvres médiévalistes, apparaît en outre comme une pratique fort courante, presque inhérente à la période médiévale. De fait, il semble garantir la fiabilité des sources d’un·e auteurice et renforce l’idée qu’iel souhaite plonger les lecteurices dans un Moyen Âge réaliste, tout fictionnel soit-il.
Or, cette pratique brutale n’est pas intrinsèquement médiévale, elle traverse les âges. En mettant en perspective certaines problématiques liées au viol, hier et aujourd’hui, on serait surpris·e de constater qu’elles ne se sont pas spécialement renouvelées. En effet, au Moyen Âge comme à notre époque, les plaintes sont très peu nombreuses. Pourtant criminalisée (la peine au Moyen Âge pouvait aller jusqu’à la mise à mort de l’accusé), la condamnation pour viol d’un individu dépend largement d’hommes persuadés que la faute incombe, du moins en partie, à la victime. Son comportement, sa moralité, ses vêtements sont scrutés et peuvent être jugés inappropriés. Ainsi la victime, déjà noyée dans la douleur et dans la honte, se voit vite accusée d’avoir provoqué un tel acte voire de l’avoir apprécié. Cette dernière idée, encore trop répandue de nos jours, est pourtant combattue depuis longtemps, en témoigne une célèbre autrice du Moyen-Âge.
« […] je suis navrée et outrée d’entendre des hommes répéter que les femmes veulent être violées et qu’il ne leur déplait point d’être forcées, même si elles s’en défendent tout haut. Car je ne saurais croire qu’elles prennent du plaisir à une telle abomination. »
Christine de Pizan, extrait de La Cité des Dames, 1405.
Toutefois, juridiquement, le viol a bien changé de statut. Au Moyen Âge et plus généralement sous l’Ancien Régime, il est condamné en ce qu’il retire quelque chose au père, au mari ou au frère. Cela s’explique en partie du fait que la liberté sexuelle des femmes n’est pas protégée par le droit : leur corps est perçu comme la propriété d’un homme ou d’une entité supérieure (Dieu). Par conséquent, le viol touche rudement les femmes précaires, de « mauvaise vie » ou celles qui ne peuvent jouir d’une protection masculine. Les agressions sexuelles concernent donc davantage les prostituées, les domestiques (bien souvent célibataires et subalternes) ou les concubines (Bazan, 2000, p. 433-444).
Le cas des Aigles décapitées
Depuis les années 1980, le Moyen Âge sert de cadre privilégié à la mise en scène de violences à caractère sexuel. L’érotisation de la subordination et de la violence exercée sur les femmes devient de plus en plus courante et se banalise avec la publicisation des productions pornographiques et le développement du cinéma X. Dans ce contexte, le Moyen Âge s’assombrit, se sexualise, s’historise également. Les auteurs et illustrateurs de bandes dessinées médiévalistes exploitent volontiers la prétendue barbarie et sexualité débridée médiévale pour soumettre les corps féminins, parfois dès la première de couverture, au regard impudique des lecteurs. La série Les Aigles décapitées, publiée dans un premier temps dans le magazine Vécu, sort en albums à partir de 1986. Les couvertures des premières éditions parues au format album sont révélatrices du sort réservé aux personnages féminins dans le premier cycle de cette saga : sur les quinze tomes publiés entre 1986 et 2001, huit présentent un personnage féminin et, sur ces huit albums, six dépeignent des femmes enchainées, dévêtues ou en quête de protection. Les deux figures représentées, la blonde Alix et la brune Nolwenn, sont d’emblée placées dans la position de proies. Qu’elles soient recroquevillées dans un coin de la planche ou bien terrifiées par des hommes en passe de les violenter, elles ne semblent pas maitresses de leur destinée. A contrario, les protagonistes masculins apparaissent systématiquement comme les acteurs déterminants du récit. Épée à la main ou chevauchant à toute allure pour se sortir de situations dangereuses, ils sont les artisans de leur délivrance. Ils ignorent la peur et n’hésitent pas à passer à l’action.
Ce monde fictionnel leur appartient, tout comme cette série de bandes dessinées qui s’adresse en premier lieu à des lecteurs masculins. Il s’agit là d’une stratégie commerciale évidente invitant les potentiels lecteurs à s’identifier à un héros surpuissant et séducteur avant même qu’il ne se plonge dans l’œuvre. Le topos de la demoiselle en détresse, parfaitement lisible et identifiable, constitue l’une des principales fonctions narratives des personnages féminins, directement hérité du célèbre Chevalier à la Charrette de Chrétien de Troyes (Breton, p. 296). Les violences qu’elles subissent sont autant de promesses de scènes déshabillées et la récompense qu’obtiendra le courageux sauveur sera sans aucun doute à la hauteur des attentes du lecteur. Elles apportent aussi des indications sur le sort réservé à Alix et Nolwenn dans cette série : les couvertures des tomes 3 et 5 suggèrent sans ambages qu’elles seront victimes de violences sexuelles. Alix, représentée à moitié dévêtue dans une robe de bure, un poignard à la main, parait essayer d’échapper à une agression sexuelle.
De son côté Nolwenn, acculée dans le coin d’une cellule par une ombre menaçante, protège l’accès à son sexe en repliant ses bras et ses jambes contre son bassin. La main imposante de l’homme au centre de l’image semble toute prête à se saisir d’elle. Cette dernière illustration, sélectionnée et validée par la maison d’édition, a de quoi laisser perplexe. En effet, ce choix traduit une réalité particulièrement dérangeante : celle que la diffusion d’images suggérant un viol est vendeuse, même si la victime au premier plan semble terrifiée. En réalité, comme le démontre Valérie Rey-Robert dans Une Culture du viol à la française, les arts n’ont cessé d’érotiser le viol (Rey-Robert, 2019, p. 130). Dans les œuvres médiévalistes, la pratique est particulièrement répandue, même encore dans les années 2010, l’exemple le plus célèbre étant sans doute la série Game of Thrones. D’une manière générale, bon nombre de représentations visuelles se focalisent sur la chair exposée des corps féminins forcés, quand celle des hommes se dérobent à l’œil du spectateur. L’image met ainsi en forme le plaisir d’exercer un regard qui met à nu, une pulsion scopique de la nudité. L’exemple développé par Rey-Robert est significatif : dans les représentations picturales de l’épisode biblique de Suzanne, la jeune femme est toujours découverte tandis que les vieillards qui l’entourent sont couverts par des vêtements. Que ce soit chez Delacroix, Rembrandt, Rubens ou Boucher, le procédé est exactement le même. Les observateurs sont donc invités à désirer ces femmes au même titre que leurs voyeurs. La victime, alors déshumanisée, apparait comme l’incarnation d’un corps érotisé dont la fonction principale est d’assouvir les appétits charnels masculins. La réduction de sujets féminins à l’état d’objets de consommation participe à minimiser les conséquences du viol et l’acte en lui-même. Par ailleurs, à travers deux exemples tirés des tomes 3 et 10 des Aigles décapitées, on observera que ce procédé n’est pas le seul à être utilisé pour dévitaliser le viol de sa violence dévastatrice.
Le tome 3 de la saga, Les Éperons d’or, s’ouvre sur l’enlèvement d’Alix par le Bâtard, l’un de ses prétendants. Hugues de Crozenc, le héros principal, s’empresse de partir à sa rescousse et la retrouve dans la chambre d’une auberge. En passe d’être violée, la jeune femme tente vaillamment de se défendre, en vain. Son agresseur, excité par « sa fougue », l’assomme en lui assénant un violent coup à la tête. Ainsi réduite au silence, inconsciente, le Bâtard arrache sa robe et dévoile ainsi sa poitrine au regard des lecteurs. La violence de l’acte est diminuée par l’évanouissement d’Alix, qui passe d’un instant à l’autre de femme agressée à femme contemplée. Dans cette scène, le lecteur est invité à profiter de la beauté de son visage immaculé malgré le coup reçu plus tôt et de sa poitrine qui répond aux règles du canon physique occidental. Telle une Belle au Bois Dormant, elle ne peut qu’attendre l’intervention d’un homme pour la délivrer. Hughes surgit dans la pièce au moment opportun, celui qui aura laissé le temps au Bâtard de déshabiller Alix mais avant qu’il n’ait commencé à la violer. Comme l’observe Rey-Robert, ce procédé consiste à « renforcer la masculinité » des héros, ceux qui ne violent pas ou qui n’ont pas besoin de le faire (Rey-Robert, 2019, p. 109). Les femmes, qui tombent toutes sous son charme lui sont acquises. Sa virilité est réaffirmée quand il les sauve, sa bravoure et sa valeur se trouvent décuplées. Les auteurs ne manquent d’ailleurs pas de mettre en avant ce phénomène : Hughes pourrait être tenté en contemplant le corps encore dénudé des femmes qu’il vient tout juste de sauver mais il ne fera rien de plus que de lancer un regard impudique sur elles.
La minimisation du viol passe aussi par la résilience des personnages féminins. Dans le tome 9, L’Otage, Nolwenn croise la route d’un personnage abject, Torche-Cul, qui n’hésite pas à se ruer sur elle pour la forcer en la menaçant avec un couteau. L’acte est brutal, Nolwenn se débat, hurle mais ne peut s’échapper par crainte de perdre la vie. Le viol en lui-même est mis à distance. Les corps sont représentés dans la pénombre de la forêt sous forme de silhouettes encrées. Au premier plan, un arbre et un lapin suggèrent que personne ne se trouve aux alentours, que cette partie de la forêt est vide de toute présence humaine et donc que Nolwenn doit faire face seule à cette situation. La case représente à elle seule l’intégralité du viol : l’immobilité de l’illustration est compensée par les cris de la jeune femme, le « NON-ON-ON ! » saccadé suggèrent alors les mouvements brutaux de cette pénétration forcée. La case suivante, en plongée, se charge d’une visée érotique en proposant une vue sur les fesses de Nolwenn, une fois son assaillant retiré. Ce dernier semble reprendre ses esprits et Nolwenn profite de ce moment pour se remobiliser. Elle se persuade de ne pas pleurer, d’oublier la violence infligée, de reprendre ses esprits et de rester forte pour se débarrasser de Torche-Cul. Le viol subit apparaît comme une épreuve supplémentaire qui, à terme, la rendra plus forte qu’elle ne l’était auparavant et non comme un traumatisme qui la hantera toute sa vie. Dans le tome suivant, Nolwenn use d’un habile stratagème pour se débarrasser temporairement de son agresseur : elle l’amadoue puis l’endort à l’aide d’une mixture mélangée dans du vin avant de fuir. Cet usage de la ruse relève du lieu commun. Comme le signale Pierre Bourdieu, les femmes « symboliquement vouée[s] à la soumission et à la résignation » ne peuvent prétendre prendre part à l’action qu’en recourant à cette « force soumise » qui consiste à retourner contre ces hommes tout-puissants leur « propre force » (Bourdieu, 1990, p. 10). Mais cette solution provisoire ne fera que retarder l’inévitable. Torche-Cul retrouve Nolwenn et déchaine toute sa violence sur elle. Il la dénude, l’enchaine, la torture. Elle ne doit son salut qu’à l’intervention d’Hugues qui profite de cette occasion pour poser son regard indiscret sur le corps molesté de la jeune femme, enceinte de lui. Une fois la vengeance accomplie, son regard impudique suggère que le héros entre de nouveau en possession de son corps.
Les projections imaginaires du Moyen Âge des années 1980 font apparaître quelques femmes fortes, à l’image d’Alix et Nolwenn dans Les Aigles décapitées. Les décennies précédentes ont longtemps privilégié les représentations de femmes domestiques et faibles. Néanmoins, ce changement remarquable ne signifie pas pour autant qu’elles s’émancipent totalement. Invitées à prendre part à l’action, elles ont plutôt vocation à séduire les lecteurs et le héros. Dans ce contexte, les violences subies par ces héroïnes sont majoritairement de nature sexuelle : le viol, combattu par les bons, pratiqué par les méchants, est un outil efficace pour érotiser et dramatiser le récit quand le réalisme du graphisme contribue à consolider l’impression d’authenticité du récit. Pourtant, son traitement s’avère très problématique : non seulement il fixe une image du Moyen Âge erronée mais il véhicule aussi un discours sur le viol dangereux et malsain. Le regard posé sur ces viols récurrents n’apporte aucun éclairage pertinent sur sa réelle appréhension par les victimes et la société médiévales parce qu’il est davantage un reflet de notre époque. Leur traitement repose sur des codes très populaires dans les années 1980, ceux du rape and revenge où des hommes mettent en scène des personnages féminins abusés sexuellement, non pas dans le but d’appréhender leur perception et leur ressenti mais bien pour mettre en valeur le caractère chevaleresque d’un héros toujours prompt à sauver et à venger des demoiselles en détresse. Dès lors, le viol apparaît comme un prétexte pour mettre en scène des corps soumis, instrumentalisés et hypersexualisés et les femmes deviennent essentiellement des objets offerts au regard indiscret et lubrique des lecteurs.
Bibliographie
Danièle ALEXANDRE-BIDON, « Gentes dames et fortes femmes : la femme médiévale dans la bande dessinée » dans Le Moyen Âge en bande dessinée, Tristan MARTINE [dir.], Paris, Karthala, 2016, p. 101-117.
William BLANC et Bernard RIBÉMONT, « Sexualité » dans le Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire. Le médiévalisme, hier et aujourd’hui, Anne BESSON, William BLANC, Vincent FERRÉ (dirs.), Paris, Vendémiaire, 2022.
Pierre BOURDIEU, « La domination masculine » dans Actes de la Recherche en Sciences Sociales,1990, numéro 84, p. 10.
Justine BRETON, Le Moyen Âge en clair-obscur. Le médiévalisme dans les séries télévisées, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2023.
Tommaso di CARPEGNA FALCONIERI, « Chapitre premier. L’Occident néomédiéval ». Médiéval et militant, traduit par Michèle GRÉVIN, Éditions de la Sorbonne, 2015, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.26558.
Alain CORBELLARI « Du Moyen Âge au conte philosophique avec Johan et Pirlouit et les Schtroumpfs » dans Bande dessinée & histoire. Objectif bulles, Michel Porret [dir.], Éditions Georg, coll. « L’Équinoxe » p. 85-109.
Christine DE PIZAN, La Cité des dames, trad. par Thérèse MOREAU et Éric HICKS, Paris, Stock, coll. « Moyen Âge », 1992.
Umberto ECO, Écrits sur la pensée du Moyen Âge, traduit de l’italien par Myriem BOUZAHER, Maurice JAVION, François ROSSO et Hélène SAUVAGE, Paris, éditions Bernard Grasset, 2016.
Claude GAUVARD, « Violence » dans Le Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Jacques LE GOFF et Jean-Claude SCHMITT (dirs.), Paris, Fayard, coll. « Pluriel », 2014, p. 1201-1209.
Valérie REY-ROBERT, Une Culture du viol à la française. Du « troussage de domestique » à la « liberté d’importuner », Paris, Libertalia, 2019.
Pour aller plus loin
Représenter les violences sexuelles