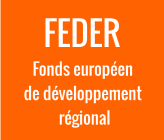Francis Groux – Entretien bédéphile
Retranscription de l’entretien avec Francis Groux, mené par Emmanuelle Ludier, étudiante en master 2 « Bande Dessinée : Édition, Théorie et Critique » de l’université Bordeaux Montaigne, le 19 novembre 2022.
Francis Groux : Voilà tous mes albums de BD, je dois en avoir 10 000 à peu près. Plus les revues sur la bande dessinée. (Il en montre une.) La revue Fiction, je l’ai reçue depuis le début. Je m’y suis intéressé et c’est là-dedans que j’ai trouvé des gars qui s’intéressaient à la bande dessinée, Lacassin et d’autres. Ça m’a donné une idée, je leur ai écrit et je suis arrivée à rencontrer Claude Moliterni qui est devenu le troisième fondateur du festival [d’Angoulême].
Emmanuelle Ludier : C’était au début des années 1960 ?
FG : On va fêter les 50 ans du festival en janvier [2022], c’était 5-6 ans avant.Je m’y intéressais à titre personnel.
EL : Comment est né le festival ?
FG : C’est ma femme qui est en partie responsable de ça, c’est elle qui m’a offert un Tintin. Et quand on aime quelque chose, on a envie de le faire découvrir aux autres… Je le dis toujours : elle est responsable alors qu’elle ne lit pas de bande dessinée.
EL : Vous vous êtes intéressé à la bande dessinée dès l’enfance, notamment par votre curé qui vous montrait la lanterne magique. Vous aviez déjà un intérêt quand vous étiez petit.
FG : À l’époque, la bande dessinée était très mal vue. Ils considéraient que ça vous empêchait de lire. J’avais un professeur qui m’avait puni pour avoir emmené une bande dessinée à l’école. Je l’ai retrouvé bien plus tard, quand j’étais administrateur, en train d’en acheter. Comme quoi les choses ont évolué… Le festival, c’était une bonne idée mais qui est aussi tombée au bon moment.
EL : Il y en avait un à Toulouse qui existait avant celui d’Angoulême.
FG : Oui. Il était petit et la ville ne les a jamais aidés. On est allé les rencontrer, bien sûr. Ils étaient plein de bonnes idées mais ils n’étaient pas du tout aidés par la municipalité donc ils n’ont pas pu continuer. Ils ont eu dès le début un stand gratuit à Angoulême, en reconnaissance du service qu’ils ont rendu. C’est quand même grâce à eux que j’ai retrouvé Marijac.
EL : Vous vous êtes donc inspirés de ce festival.
FG : Et de celui de Lucca, bien sûr. C’est Moliterni qui nous avait invités là-bas. On leur a demandé l’autorisation de les copier. Le maire était d’accord et tout le monde nous a laissés faire. Au début, l’organisation était presque la même qu’à Lucca et, petit à petit, on s’est débrouillés nous-mêmes.
EL : Est-ce que la notoriété de Lucca est aussi importante qu’Angoulême ?
FG : Oh non ! Je m’excuse, mais on n’a pas d’équivalent. Ça a l’air prétentieux mais on n’a pas d’équivalent au monde parce que même les États-Unis n’ont pas d’équivalent. J’ai beaucoup voyagé. Au début, quand je disais « je suis d’Angoulême, c’est à côté de Cognac », ça disait vaguement quelque chose. « C’est au nord de Bordeaux. - Ah d’accord. » Mais maintenant, où que j’aille, partout dans le monde, quand j’annonce Angoulême, on me répond « BD ».
Même l’Unesco s’y est mis. Ma fille [Delphine Groux, présidente de l’association du festival d’Angoulême] a beaucoup travaillé auprès d’eux de façon à ce que ce soit reconnu très officiellement.
EL : La BD est enfin reconnue comme un art.
FG : Tout à fait. Elle est enseignée à l’école et on l’y utilise. Toutes les écoles d’Angoulême, la Maison des auteurs… Tout ça, c’est une conséquence de cette toute petite manifestation qui est devenue quelque chose d’assez étonnant.
EL : Mais cela a eu aussitôt un impact fort, puisque le succès fut immédiat.
FG : Comme je vous disais, c’était la bonne idée au bon moment. Trop tôt, elle n’aurait peut-être pas eu lieu, ou ça n’aurait peut-être pas marché.
EL : Pourtant, dans les années 1960, vous aviez fait la semaine de la bande dessinée et du livres pour enfants qui marchait très bien.
FG : Quand j’ai lancé le festival, qui s’appelait alors « salon », je pensais surtout aux enfants. Et puis je me suis aperçu que les adultes aussi aimaient ça, comme moi. Ça a vraiment été une découverte et dès la première année on a eu 10 000 personnes, ce qui est quand même étonnant, avec des articles parus dans Le Monde. Le maire, Roland Chiron, n’était pas en ville à ce moment-là. Il a entendu parler d’Angoulême et il est rentré tout de suite.
On a eu Pierre Pascal qui était important. Il était de Bordeaux et un peu plus âgé que moi. Il connaissait la BD d’avant-guerre, que je n’ai connue qu’après. La première bande dessinée que j’ai connue était Tintin, avec la lanterne magique, mais c’est surtout le journal Le Téméraire,qui était un journal nazi, qui était remarquablement fait. Sinon, il a fallu attendre la Libération. C’est avec Coq Hardi, Marijac et le journal Vaillant qu’on a vraiment commencé à parler bande dessinée. Puis, il y a eu Tintin et Spirou. Spirou existait déjà en Belgique mais pas en France.
EL : Donc il y a eu des rencontres, des gens autour de vous qui ont eu un impact.
FG : J’avais fait mes études à Saint-Paul et j’avais comme prof de philo Clovis Coudreau, qu’on appelait le Pépon. Il était le supérieur de l’école. Quand on est venu me demander de faire partie du conseil municipal, ça ne me disait trop rien. Je n’étais pas du tout politique et j’en ai parlé au supérieur de Saint-Paul. Il m’a dit : » Francis, c’est des gens comme toi dont ils ont besoin ». S’il ne m’avait pas poussé, je n’y serais pas allé. Au conseil, j’ai rencontré Jean Mardikian. J’ai demandé à Moliterni de venir, parce que j’avais lu un peu ses trucs, et c’est là qu’on a fait les premières manifestations, dont la quinzaine de la lecture. Des auteurs sont venus à Angoulême et on s’est aperçus que cela marchait. Dès la première année, il y eut 10 000 personnes. Et chaque année on doublait le nombre.
Quelqu’un d’autre qui est très important, c’est Louis Gérard. Il était le directeur de Casterman. Je voulais trouver un parrain et je pensais que le plus connu des auteurs encore vivant de bandes dessinées anciennes était Alain Saint-Ogan. J’ai pris contact avec lui et j’ai demandé s’il accepterait d’être président d’honneur du festival et si on pouvait utiliser Alfred [un manchot, personnage de la série Zig et Puce créée par Saint-Ogan]. Il m’a répondu : « oui, mais j’ai vendu mes personnages à Greg ». Alors j’ai demandé à Greg, et Greg m’a répondu : « je n’aurais pas l’outrecuidance de refuser ça ». Alain Saint-Ogan n’a pas pu venir à Angoulême puisque la première année, on a dû lui couper la jambe, et la deuxième année, il était mort. Je ne savais plus comment m’en sortir et j’ai demandé de l’aide à Louis Gérard. Il m’a dit : « et pourquoi pas Hergé ? » Ah oui, ça c’est une idée ! Et Hergé a répondu qu’il était d’accord pour être président d’honneur. La quatrième année j’ai dit à Louis Gérard : « et si Hergé venait à Angoulême ? » Il m’a dit : « il n’aime pas trop ça mais on va essayer ». Louis Gérard m’avait dit que les auteurs qui étaient venus à Angoulême en gardaient un excellent souvenir. Au passage on leur faisait goûter le Pineau et le cognac, ils appréciaient. Hergé est finalement venu à Angoulême. Je n’ai pas eu de relations amicales avec lui comme avec les autres auteurs parce qu’il avait une certaine distance, mais Hergé est venu. Nous avons descendu ensemble la rue – qui est devenu la rue Hergé – et on est allés voir un film qui s’appelait Moi Tintin.Il était à côté de moi dans la salle et à ce moment-là on est venu de me chercher en me disant : » il y a un problème dans la cour de l’hôtel de ville, dans la salle des sociétés savantes ». Il y avait des gosses qui faisaient de la bande dessinée et il y a eu une alerte à la bombe. J’y suis allé bien sûr, j’ai fait évacuer la salle. Des alertes à la bombe on en a eu plusieurs. Je n’ai pas raconté à Hergé l’histoire. Cela faisait quand même partie de nos soucis. De la même façon qu’il y a eu dès la première année un procès pour pornographie à cause d’un con de médecin de Châteauneuf…
EL : Est-ce que vous pouvez me décrire un peu vos activités concrètes en lien avec le festival, à ce moment-là ? Vous en étiez le directeur ?
FG : J’ai d’abord été le président, puis après le directeur. Jusqu’à ce que l’on trouve des professionnels, parce qu’on avait tous des boulots à côté. On en a eu un premier qui s’appelait Charlot… Il a tenu un an, malheureusement il s’est tué en voiture. On en a pris un deuxième. Manque de chance, il est mort comme Goscinny, en faisant un test d’effort. C’est à ce moment-là qu’on s’est tournés vers Franck Bondoux… Et il y a toujours eu les bénévoles.
EL : Il y en a beaucoup j’imagine.
FG : Le personnel que nous avions à cette époque, c’est Bondoux qui l’a embauché. Il y en avait quatre, comme aujourd’hui encore. Quatre ou cinq qui sont permanents, dont certains qui vont prendre leur retraite, d’ailleurs. Après, c’est des gens qu’on faisait venir de Paris. Et on a eu la chance de rencontrer Dominique Hériard Dubreuil. C’est elle qui nous fournissait les hôtesses. Elle nous aidait. C’est elle qui a poussé ma fille à travailler dans la communication. Dominique a vraiment été très importante. Beaucoup des hôtesses que l’on avait ont épousé des auteurs de bande dessinée, ou étaient déjà mariées avec. Par exemple Juillard, l’actuel dessinateur de Black & Mortimer, est marié avec une fille qui était hôtesse à Angoulême.
EL : Vous avez travaillé pour permettre à tout le monde de lire de la bande dessinée. Vous l’avez amenée à la prison, vous l’avez amenée auprès de gens du voyage… C’était important pour vous.
FG : Bien sûr je considère que c’est un moyen de s’exprimer. Il y a des gens qui n’ont pas d’autres moyens de s’exprimer que le dessin. Je suis allé au Tibet, enfin le Népal. C’est pareil. J’ai fait l’ascension avec une fille que j’avais rencontrée à la boxe à Angoulême. Elle aurait pu être ma fille, bien sûr, mais je lui ai demandé si ça lui faisait quelque chose qu’on parte ensemble. Elle était d’accord. Quand on a commencé à grimper, très rapidement, on s’est retrouvés avec des gens qui ne parlaient ni français ni anglais. J’ai fait des dessins, très simplifiés. On avait un yackman, qui dirigeait les yacks pour porter les affaires, et deux porteuses. Il y en avait une qui avait 17 ans et l’autre qui devait en avoir 16. La deuxième était d’une beauté à tomber par terre et ne parlait pas un mot, à part dessiner. Il faut savoir que les Sherpas, parce que c’est une race Sherpa, elles sont très libérées. C’est-à-dire qu’elles n’hésitent pas vis-à-vis d’un mec de faire les premiers pas. Et donc elle m’a fait des dessins. La bande dessinée est un moyen de s’exprimer.
EL : Parmi les projets pour faire exister la BD, vous avez investi beaucoup de temps et d’effort dans le festival. Vous dites dans votre livre que vous n’étiez pas beaucoup à la maison, entre le travail et le festival.
FG : Oui. J’ai eu de la chance parce que le festival m’a donné une certaine notoriété qui rejaillissait sur la société pour laquelle je travaillais. J’ai ainsi toujours eu tout le soutien possible de ma direction qui me disait que s’il fallait dégager du temps, je le pouvais. Mais il y a beaucoup de choses que j’ai faites une fois que j’ai été en retraite. Tant que je travaillais ce n’était pas évident.
EL : Quels étaient les groupes de bédéphiles auxquels vous apparteniez ?
FG : Ceux d’Angoulême qui étaient autour de moi, pas très nombreux mais qui petit à petit se sont intéressés à ça. Je connaissais aussi des gens ailleurs, comme Tabary et même Jacques Lang, qui était le maire de Blois et qui est venu au festival. Et Moliterni, bien sûr. Il y avait un petit milieu.
EL : Dans le lot, il n’y avait pas de professionnels, des auteurs, des dessinateurs ?
FG : Non, le festival et les amis du musée sont des gens qui aiment la bande dessinée, qui veulent la découvrir et la faire découvrir aux autres. Ces associations ne sont pas faites d’auteurs.
EL : Vous avez arrêté de vous investir, à un moment donné.
FG : Oui. Et on est revenu me chercher. Il y avait des problèmes avec le directeur qu’on avait pris à l’époque, dont je tairai le nom. Il avait un très gros salaire et il travaillait au Havre, ça s’est terminé avec un procès. C’est à ce moment-là qu’il a fallu que je revienne pour remettre de l’ordre. J’ai toujours eu une excellente relation avec tous les maires successifs, je les ai tous tutoyés. Sauf Chavanes, l’ancien directeur de chez Leroy-Somer.Mais je me suis très bien entendu avec tous les autres maires, c’est important.
EL : Vous avez un tempérament de modérateur.
FG : Quand je suis entré à la municipalité, je n’avais pas de parti. Mais comme il y avait une majorité de droite, on m’a reproché d’être de droite. J’ai piqué une espèce de rogne. Avec Mardikian, on a toujours dit qu’il ne fallait pas que le festival appartienne à la mairie alors nous avons créé l’association du Festival international de la bande dessinée. On doit demander des subventions mais nous sommes indépendants.
Quand il y a eu des problèmes avec le maire Boucheron, on est venu me demander si je voulais transférer le festival d’Angoulême à Lille. À ce moment, Boucheron a compris qu’il faisait une connerie. Il avait un adjoint, David Caméo, qui était beaucoup plus intelligent. Il a calmé Boucheron et tout est rentré dans l’ordre. Mais c’est à partir de ce moment-là qu’on a commencé à faire payer l’entrée du festival
EL : Comment votre entourage percevait-il cet investissement ? Vos enfants ne vous voyaient pas beaucoup.
FG : Si ma fille était là, elle vous expliquerait qu’elle souffrait un petit peu de mon absence. Elle se rappelle quand je leur lisais de la bande dessinée. J’étais moins présent, alors j’essayais justement de leur en lire. On se mettait sur le fauteuil, il y avait un rideau qui était fermé et je leur lisais les bandes dessinées. C’est comme ça que mon fils a découvert Tintin.
Quand on a un emploi et qu’on veut faire quelque chose à côté, cela vous coince. Il y a toujours quelque chose qui en souffre un petit peu. Je dis toujours que j’ai eu trois enfants. Le troisième, c’est le festival.
EL : Vous avez rencontré des obstacles, comme la tempête de 1977.
FG : Oui, la 4e année. Il y a le chapiteau qui s’est envolé et on s’est transféré dans une salle de sport à Ma Campagne. J’ai pensé que le festival était foutu, juste l’année où Hergé était là ! On a organisé un système d’autobus et cela a marché. On a eu plus de monde que les autres années. Alors qu’il fallait galoper à Ma Campagne. J’ai une devise, qui n’est pas de moi mais que j’ai fait mienne : « qui ose gagne ». Si vous n’essayez pas, cela ne marchera pas, mais si vous essayez, il y a de grandes chances que cela marche.
EL : Il y a aussi eu la CGT qui voulaient bloquer le démarrage du festival parce que les places étaient chères.
FG : On ne peut pas empêcher ce genre de choses. Je suis conscient de ce problème : le festival coûte très cher. Il coûte quatre millions. On ne pourrait rien faire si on n’avait pas de subventions. Et les auteurs sont très mal payés, à moins d’avoir un bestseller comme Zep. Alors pour pouvoir s’en sortir, beaucoup font quelque chose à côté. Heureusement, Angoulême ne s’est pas limitée à la bande dessinée mais développe aussi des films d’animation, des dessins animés… Beaucoup travaillent des deux côtés grâce à ça. Par exemple, quelqu’un comme Fawzi travaille pour le tribunal, il fait des croquis d’audiences. Quand il y a des murs à peindre, il fait des propositions. Il leur faut trouver un à-côté pour pouvoir s’en sortir. D’autres sont professeurs… Mais s’ils n’avaient que ce qu’ils touchent sur leurs ventes de BD, ça n’irait pas. La production est tellement forte, il y a une concurrence. Si un bestseller sort, c’est une catastrophe pour les autres parce que les libraires ne vont présenter que la nouveauté, et les autres ne se vendront pas. C’est la couverture qui fait vendre un album, qui donne envie de lire la BD, donc je conçois que pour les auteurs, c’est dur. Alors on va commencer à les aider un petit peu de ce côté-là : il est question de rémunérer les dédicaces. Cela ne me semble pas exagéré. Sur le principe, je suis contre, parce que si vous demandez une dédicace à quelqu’un, c’est parce que vous aimez ce qu’il fait. Mais d’un autre côté, passer toute la journée à ne faire que ça… Ce n’est pas ce qui va leur permettre de déjeuner ou de dîner. Donc je comprends qui y ait un certain mécontentement, qu’on les aide de ce côté-là. Cela me paraît une chose souhaitable, mais comment cela va-t-il être pris par le public ? Je ne sais pas. Parce que l’entrée n’est déjà pas gratuite, même si ce n’est pas énorme.
EL : Mais ce n’est pas le lecteur qui achètera la dédicace, ce sont les éditeurs qui vont payer les auteurs. Je pense que le public peut comprendre.
FG : Oui, le public va suivre. J’ai beaucoup eu peur avec le Covid mais le public est là. On a eu autant de monde en janvier et là, pour les 50 ans…
EL : Est-ce que les maires ont essayé d’avoir une emprise, ou une certaine censure ?
FG : Une seule fois, et c’était Chavanes. L’affiche avait été faite par un dessinateur américain, encore vivant, qui avait fait quelque chose de plus ou moins érotique. Comment s’appelle cet homme ? (Il cherche.) Il y en avait beaucoup aussi qui ne voulaient pas que Reiser ait le prix, et Boucheron s’est battu pour. (Il cherche encore.) Ce n’est pas l’affiche de Reiser. J’ai Crumb en tête mais ce n’est pas lui. (Il rit.) Cela me met dans une colère noire quand je ne trouve pas quelque chose comme ça.[1]
EL : Vous avez participé à d’autres festivals, comme Bassillac ?
FG : Oui, Bassillac, et puis également à Fourques-sur-Garonne qui est généralement vers février-mars. C’est très sympa.
EL : Vous êtes jury là-bas ?
FG : Oui. On avait un prix au nom de ce dessinateur des Pieds Nickelés.Aujourd’hui c’est catastrophique, les noms ne me reviennent pas. Quand je suis allé là-bas, j’ai logé chez sa veuve. Elle m’a emmené dans leur ancien garage où il y avait une pièce qui était plus grande que ça (il montre sa salle-à-manger) avec une immense table et tout un tas de personnages sculptés depuis la préhistoire jusqu’à la guerre de 39-40. C’était lui qui l’avait fait, c’était magnifique. Elle était toute seule, cette dame, et elle ne pouvait pas garder ça. Ils ont d’abord essayé de voir s’ils pouvaient créer un musée, mais un musée dans un coin perdu comme Fourques, il n’y aura personne pour le voir. Finalement, on a négocié entre elle et son fils. Il a tout mis dans des boîtes, et puis je suis allé à Fourques avec Franck, le président des AMBD. Puis on est revenus et on a été voir le Musée de la bande dessinée en leur demandant s’ils étaient d’accord. Ils ont dit d’accord. Ah, Jacarbo ! Voilà, le dessinateur c’est Jacarbo et sa femme, madame Arbeau. Leur fils est en train de tout reconstituer pour venir l’installer au Musée de la bande dessinée.
EL : Que pensez-vous des prix qui existent actuellement dans la bande dessinée ? Je crois que vous n’étiez pas favorable, au début.
FG : Je suis moins sectaire que ça. Il n’y a pas loin de 250 manifestations par an de bande dessinée, il faut bien qu’ils trouvent un moyen d’attirer les gens. C’est l’idée de faire des prix et c’est une façon de le faire. Il est vrai que je limite ma participation à peu de choses : je vais à Bassillac, Martel et Fourques. Et quand il y avait Magnac, j’allais également à Magnac. Mais c’est tout
EL : Et quand vous étiez plus jeune, vous alliez en Belgique ?
FG : Je suis allé en Belgique parce que j’ai été invité. J’ai eu le prix Saint-Michel et j’y suis allé pour préparer une exposition sur Dany. Et j’y suis allé également pour rencontrer Franquin. Je connais André Franquin, madame Franquin et la fille de Franquin. Le plaisir d’aller en en Belgique, c’était plus pour rencontrer des gens et préparer une exposition que pour autre chose… J’ai quand même visité le Centre belge de la bande dessinée, c’est très beau.
EL : Les prix sont là pour le public, quelque part.
FG : Oui c’est une façon pour attirer les gens
EL : Les auteurs peuvent être déçus de n’en avoir jamais.
FG : Rien qu’Angoulême, ce fut très difficile avoir des étrangers autres que le franco-belge. Ensuite, de donner un prix à des scénaristes… Et à des femmes ! Les prix, c’est important. Cela permet de mettre un coup de projecteur sur quelqu’un et cela peut l’aider. Regardez, le prix de l’année prochaine, c’est une femme québécoise [Julie Doucet].
EL : Pensez-vous que la BD est un miroir des changements sociaux des années 1970 ?
FG : Oui, il y a beaucoup de témoignages justement. On n’est plus en train de parler du franco-belge, il y a carrément des bouquins qui parlent des événements sociaux, politiques, etc. Cela me paraît important, cette évolution qui s’est faite dans la bande dessinée. Elle peut être un moyen de mettre un projecteur sur un problème actuel. Vous avez à l’heure actuelle une multitude de bandes dessinées qui vont paraître sur la guerre d’Algérie. Il y a un festival à Alger, c’est une femme, Dalila Nadjem, qui l'a créé. Elle était venue à Angoulême et elle m’avait proposé d’y venir. J’y étais à partir de la deuxième édition. Quand je suis arrivé là-bas, à l’aéroport d’Alger, on m’attendait. Il y avait des photographes, et un tapis rouge qui sortait de l’aéroport qui allait jusqu’à la porte d’un taxi qui m’était réservé. Je pense qu’Alain Delon arrivant au festival de Cannes n’avait pas l’équivalent. Et j’ai eu un chauffeur qui est resté avec moi tout le long. La faveur que j’ai reçue, moi qui arrivais avec un complexe. On m’a présenté à la ministre de la Culture qui m’a fait la bise. J’ai été pris en charge par l’ambassade de France. Et j’ai visité le mémorial du Martyr. Mais jamais je n’ai rencontré un geste d’hostilité. Rien du tout. Au contraire, tout le monde venait. Je suis parti avec un préjugé qui était ridicule puisque j’ai été très bien reçu où que je sois allé en Algérie. C’est important, il faut y aller.
EL : Le festival d’Alger existe depuis longtemps ?
FG : Je ne sais plus. J’y suis allé plusieurs années de rang. J’y ai amené des auteurs charentais, des auteurs importants. Très peu de femmes étaient voilées à l’époque et maintenant ça y est, c’est obligatoire. Donc Dalila a laissé tomber le festival. Il y a un changement qui s’est fait, un durcissement de ce côté-là, ce qui fait qu’elle n’y est plus et que je n’irai pas non plus. C’est dommage. On avait formé des jeunes auteurs qui faisaient du très bon boulot.
EL : Quelles sont les évolutions positives et négatives que vous percevez depuis que vous avez intégré le milieu bédéphile ?
FG : C’est plutôt positif en France, il y a une ouverture. La bande dessinée est devenue un moyen d’informer sur tout ce qui peut se faire à l’heure actuelle.
Le côté négatif, mais on n’y peut rien, c’est la part importante que les mangas représentent. La preuve, c’est qu’il y a maintenant des mangas algériens et des mangas français. Alors j’essaie d’analyser pourquoi le manga marche bien. Quand ils ont créé les mangas, les Asiatiques se sont dit : « il faut qu’une bande dessinée puisse devenir un dessin animé ». Donc quand nous allons avoir deux cases, eux vont mettre six pages. Ils vont complètement découper le mouvement, ce qui fait qu’après, c’est facile à animer. C’est pour ça que les productions des mangas sont énormes. Mais ça plaît.
Les premiers mangas qui sont parus en France n’étaient pas traduits, mais les gosses se précipitaient dessus, rien que pour regarder les images… Malgré la lecture qui est dans le sens inverse. C’est comme ça. Il ne faudrait pas que l’importance que le manga a prise tue le reste. Les gens qui en achètent ne vont pas acheter autre chose et la production de manga est telle que j’ai peur que cela pose un problème…
[1] Il s'agit peut-être de l'affiche proposée par Robert Crumb en 2000 qui fut refusée par la municipalité, comportant notamment des images jugées pornographiques et un titre provocateur : "Fuck off Angoulême".
Pour aller plus loin
Entretiens bédéphiles