
Du lecteur au spectateur
Une représentation en direct permet de jouer sur l’analogie temporelle qui s’établit entre la confection d’une image, sa découverte par le spectateur et l’interprétation d’une pièce musicale. Ce constat, certes évident, engage à repenser les modes de réception des images et incidemment de création de ces images. Un nouveau champ créatif s’ouvre alors, riche en possibilités graphiques et narratives.

Du lecteur au spectateur : introduction à nos spectacles dessinés
Je réalise des concerts dessinés depuis plus de dix ans, en compagnie de Matthieu Chiara (Fauve révélation du FIBD 2024 pour son album L’Homme gêné publié aux éditions de l’Agrume). Nous nous sommes rencontrés à l’atelier d’illustration des Arts Décoratifs de Strasbourg où nous avons travaillé ensemble sur divers projets. C’est dans ce contexte que nous avons forgé et affiné notre vision du concert dessiné, ou plus exactement du type de spectacle que nous souhaitions réaliser et que nous avons développé par la suite. Je vais présenter ici notre approche du dessin sur scène et notre processus créatif.
Pour commencer, nous n’accordons pas nécessairement d’importance à la dénomination de ces spectacles : les différents espaces où nous nous sommes produits ont tour à tour annoncé une performance dessinée, un concert dessiné, un live dessiné, bref, ont utilisé un champ lexical tournant autour du spectacle invariablement suivi par l’adjectif « dessiné ». Il me semble qu’envisager simplement un « spectacle » recouvre assez bien notre pratique, et pourquoi pas un « spectacle vivant » tel que le précise Pilau Daurès[1]. Cependant, si Benoît Mouchard décrit le concert dessiné comme un « dérivé de la bande dessinée[2] », nous le considérons au contraire comme une pratique artistique à part entière qui ne partage avec la bande dessinée que ses acteurs et, pour beaucoup, ses lieux de représentations, les festivals de bande dessinée (même si une plus grande diversité de centres culturels accueille désormais ces spectacles). Avec ce texte, je souhaite exposer ce qui constitue selon nous certaines des spécificités de cette nouvelle pratique artistique, et ainsi mettre en lumière quelques stratégies que nous avons développées afin de façonner une expérience esthétique originale et singulière.
Je m’appuierai essentiellement ici sur deux spectacles que nous avons conçus et dont vous pourrez consulter les bandes-annonces avec les liens ci-dessous[3] :
- L’explorateur du Cosmos, créé en 2015
- Poison, créé en 2017
Du lecteur au spectateur
Avant d’en faire, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs spectacles qui proposaient de mettre en dialogue des dessinateurs et des musiciens. Durant ces concerts dessinés, souvent improvisés, j’étais particulièrement séduit par l’expérience vécue en direct, mais rapidement, je m’ennuyais un peu. Fasciné par la découverte du dessin en train de se faire, par la démonstration de la maîtrise graphique des dessinateur.ices, mon attention baissait inexorablement. Je dois être trop impatient. Nous en avons alors discuté avec Matthieu et, au-delà de ma concentration vacillante, s’est imposé un constat fondamental qui marque selon nous la spécificité du concert dessiné par rapport à l’image imprimée : lors d’une représentation, nous ne nous adressons plus à des lecteurs mais à des spectateurs. La notion de temps de découverte des images et, incidemment l’expérience que les spectateurs ont de l’image change ainsi radicalement. Corrélativement, les mécanismes de lecture s’en retrouvent absolument bouleversés.
Dans son article « Narratologie médiatique et médiagénie des récits[4], Philippe Marion distingue deux types de configurations médiatiques, hétérochrone et homochrone, qui me semblent particulièrement bien résumer la nuance que nous opérons entre lecteur et spectateur. Il définit les médias hétérochrones comme relevant d’un contexte au sein duquel « le temps de réception n’est pas programmé par le média, il ne fait pas partie de sa stratégie énonciative », précisant ensuite que « le temps de consommation du message n’est pas médiatiquement intégré, il ne fait pas partie du temps d’émission ». Il donne alors comme exemples « le “livre”, la presse écrite, l’affiche publicitaire, la photographie, la bande dessinée[5] ». Au contraire, « un média homochrone se caractérise par le fait qu’il incorpore le temps de la réception dans l’énonciation de ses messages. Ces derniers sont conçus pour être consommés dans une durée intrinsèquement programmée », « le temps de réception est absorbé, intégré, dirigé par l’énonciation médiatique elle-même[6] ». On pourrait prendre comme exemple le cinéma ou tout type de spectacle vivant, dont le concert dessiné évidemment. En effet, durant un spectacle, l’image apparait en suivant une durée qui détermine sa lecture. Cette variation dans la réception du dessin ouvre la possibilité à l’exploration de nouvelles stratégies énonciatives que nous souhaitions développer. Nous voulions alors imaginer de nouveaux mécanismes de lectures qui stimulent l’attention du spectateur, concevoir des systèmes graphiques et narratifs singuliers qui, tout en jouant la carte du spectaculaire, donnent à voir l’histoire que nous désirions raconter.
C’est pourquoi nous avons fait le choix de réaliser ce que Camille Cimper nomme des spectacles chorégraphiés[7] : ils sont le fruit d’une élaboration minutieuse où toutes les scènes sont préparées en amont, réservant ainsi une marge minimale à l’improvisation (sur certaines scènes, rares, je ne dessine même pas du tout). L’important pour nous ne réside plus uniquement dans l’acte de dessin mais aussi, et surtout, dans la proposition d’images ludiques aménageant des dispositifs de lectures originaux. Dès lors ne compte plus seulement l’avènement mystérieux du dessin mais également l’image comme évènement spectaculaire.

La durée de l’image
La projection de la feuille de papier, dispositif au fondement du concert dessiné, permet d’abord de découvrir le dessin en train de se faire, d’assister à cet acte magique qui voit des circonvolutions de traits dessiner des formes, paysages, objets ou personnages qui apparaissent et se précisent progressivement. Pilau Daurès décrit particulièrement bien la fascination qu’exercent ces visions fantastiques : « le regardeur assiste à cet accouchement dans un état d’expectative. Alors que l’artiste a en tête une projection mentale de son dessin fini, le regardeur ne sait pas où va le dessin. Il émet donc des hypothèses sur son déchiffrement à chaque nouveau coup de crayon[8] ». La chronologie de l’identification des différents éléments de l’image organise déjà un espace de narration à part entière. Pour le dire autrement, l’ordre à travers lequel les détails du dessin se dévoilent constitue déjà une stratégie énonciative en soi. Durant une scène peuvent par exemple se succéder des informations graphiques et musicales sur le lieu du récit, puis sur l’époque, puis sur les protagonistes et enfin sur l’action qui se joue. Il s’agit ici ni plus ni moins de créer une analogie entre le temps de la description et celui de la lecture de l’image.
Pour certaines scènes, un élément graphique peut déjà être présent dans la feuille avant que l’on ne commence à dessiner. Non identifiable de prime abord, sa présence intrigue et nous ménageons alors le suspense de son inscription dans la composition ; le mystère s’éclaircit à la fin de la séquence, comme une chute graphique anticipée et optimisée par la durée de réalisation de l’image.
À partir de ce simple mécanisme narratif, nous pouvons prévoir des effets de surprises qui bousculent la lecture initiale de l’image, celle-ci étant reconduite à la lumière des nouveaux éléments dessinés. Nous pouvons « tromper » le spectateur en dessinant par exemple un paysage qui semble de prime abord paradisiaque pour ensuite mettre en lumière tous les dangers qui se cachent dans le décor. Nous pouvons aussi gonfler un même dessin d’une double temporalité : les ajouts successifs permettent de mettre en scène une première situation, puis une seconde par accumulation d’éléments qui vont redéfinir la composition dans son ensemble. Les dessins ont une première lecture puis recouvrent une seconde signification. Il nous arrive ainsi de débuter un dessin qui esquisse une composition initiale puis, arrivés à la moitié du morceau, nous retournons la feuille pour terminer la séquence en complétant l’image inversée : celle-ci représente alors une seconde scène figurativement distincte de la première mais qui la suit narrativement. Ce faisant, nous déjouons les attentes du lecteur, ou plutôt nous jouons la surprise à travers des reconfigurations figuratives. D’anciennes lignes qui dessinaient une forme identifiable en dessinent désormais de nouvelles qui dialoguent avec les anciennes. Les transformations de l’image participent ainsi au déroulement narratif. Loin d’inventer ce principe, nous ne faisons qu’adapter les Upside-downs de Gustave Verbeck au potentiel de la durée, et donc de la recomposition figurative progressive offerte par le spectacle.
Plus simplement, nous avons réalisé un spectacle dont les péripéties graphiques se déroulent intégralement sur une seule feuille : la chronologie de l’apparition des figures, leur accumulation dans la composition et leurs transformations figuratives racontent à elles seules l’histoire que nous avons écrite.
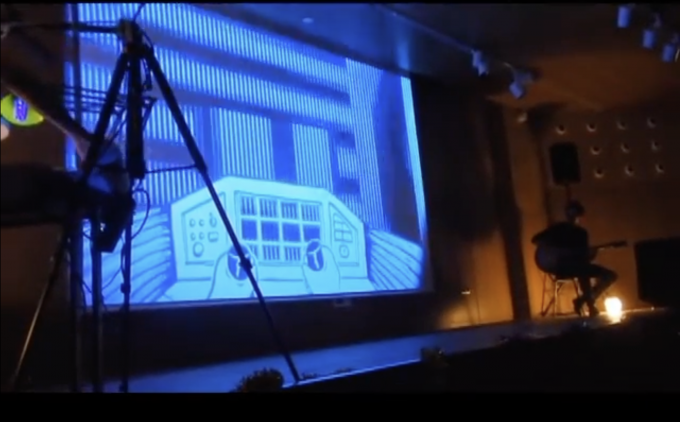
Manipulations dans et de la feuille
Ce jeu d’accumulations graphiques peut aussi être élaboré à travers des astuces qui mettent en scène l’apparition et la disparition de formes dans l’image, voire du cadre de la caméra.
De simples systèmes de caches donnent lieu à des séquences où des portions de feuille préalablement découpées découvrent et oblitèrent en même temps des parties de l’image (pas les mêmes, l’espace se remodelant ainsi). Le scénario se déploie alors par le biais de différentes actions qui surgissent dans la composition, parfois instantanément lorsqu’un dessin est déjà présent derrière le cache. Ces variations localisées n’ont plus à suivre la transmutation figurative évoquée plus haut, c’est-à-dire n’ont plus à se fondre dans les formes déjà réalisées, mais peuvent se révéler plus globales et radicales. Plusieurs caches peuvent évidemment être dissimulés dans l’image et chaque ouverture aménage alors une temporalité narrative distincte. L’artifice est parfois rendu subtilement visible afin d’amener la curiosité du spectateur : ce dernier, percevant l’ombre de la découpe ou la boursouflure du papier, s’attend à la survenue de changements sans en connaitre sa nature. Pour d’autres scènes, nous jouons au contraire sur leur invisibilisation afin d’accentuer l’effet de surprise.
En plus de ces manipulations réalisées à l’intérieur du cadre, nous mettons aussi en scène des mouvements plus larges par mobilité de la feuille entière. Si en bande dessinée le hors champs est une virtualité, avec le dispositif des concerts dessinés, le hors champs existe réellement. Au-delà du cadre de la caméra peuvent se trouver des outils de dessin, des croquis, des notes, autant de choses qu’on choisit de ne pas montrer à l’image. Mais on peut aussi décider de dissimuler sciemment certains espaces pour les révéler plus tard, lorsque nous utilisons par exemple des feuilles aux dimensions plus importantes que le standard adopté : le cadre de la caméra ne donne alors à voir qu’une partie d’un plus grand dessin (souvent en partie préalablement dessiné). L’image projetée devient une portion d’une image plus grande, ou plus encore un point de vue d’une composition plus large. Dès lors, ne reste qu’à faire glisser la feuille pour laisser apparaitre ce qui n’était pas visible. Les divers arrêts ou apparitions composent autant d’étapes qui organisent une séquence sous forme de cartographie narrative. Plus simplement, un paysage peut aussi défiler et une analogie s’établit alors entre le mouvement de la feuille et le regard qui le balayerait. Ces défilements peuvent parfois donner l’illusion d’une courte séquence d’animation, voire même en créer réellement. Le papier glisse et, grâce à des dispositifs spéciaux, l’image bouge, s’anime alors même que nous continuons à utiliser du simple papier. Au cadre fixe de la caméra (et de l’image imprimée) contrastent ainsi les mouvements de la feuille.
Durant ce genre de scènes, les spectateurs perçoivent dès son installation l’usage d’un format dépassant les précédents, la feuille pouvant être particulièrement imposante et donc encombrante. Cependant, n’ayant pas accès au contenu de l’image, et encore moins au récit que seul le mouvement engendre, il ne peut rester que dans l’expectative d’une surprise à venir. Comme pour les caches, la monstration de l’artifice participe de l’étonnement du spectateur. Ainsi, si nous souhaitons au maximum nous effacer pour laisser la place à l’image, cette visibilité rappelle l’existence matérielle et statique du dessin et renforce ainsi la magie qui s’opère à l’écran. Elle rappelle que nous restons dans une production artisanale, que tous les artifices qui s’incarnent à l’écran recouvrent une forme de dépouillement ; qu’à l’aire des effets spéciaux numériques, la magie reste à portée de main, à hauteur d’une feuille de papier.

Mise en scène de la main
Certaines manipulations évoquées à l’instant font intervenir la main dans l’image, une main qui ne dessine pas mais qui entre en action, agissant dans la feuille lorsqu’il s’agit de tourner des caches par exemple. S’est alors posée pour nous la question de l’enjeu narratif de la mise en scène de la main, de savoir si nous souhaitions l’effacer ou au contraire lui faire revêtir un véritable rôle. Durant les concerts dessinés auxquels j’ai pu assister, j’ai toujours trouvé très beaux ces moments suspendus qui donnent à voir les hésitations du crayon qui parcourt le vide au-dessus de la feuille pour en appréhender l’espace. Ces instants de fébrilité qui précèdent la décision d’inscrire la première trace à partir de laquelle va se construire le dessin à venir. Cependant, afin de gagner en efficacité narrative, parce que chaque scène est minutée et que nous souhaitons mettre l’accent sur l’image, nous avons plutôt essayé, autant que faire se peut, de gommer ces périodes d’introduction qui ne participent pas au récit et d’user de gestes mesurés. Pour autant, quelle que soit notre intension, nous ne pouvons ignorer que l’intensité des agitations du poignet portent déjà en eux une part d’expressivité qui contribue à la lecture de l’image, que le geste traçant peut dire autant voire plus que la trace qu’il laisse. Calmes ou voluptueux, saccadés ou agressifs, les mouvements de la main peuvent ainsi être chorégraphiés pour participer au récit qu’elle dessine, interpréter la scène qui prend forme ou symboliser la dramaturgie à l’œuvre dans la composition.
Lors d’une scène de L’Explorateur du Cosmos par exemple, je dessine avec la main droite le personnage principal en prise avec un danger que je trace de la main gauche : la difficulté de cette double création simultanée rend la figuration particulièrement complexe et, vers la fin de la séquence qui atteint une certaine intensité, compte moins le fait de reconnaitre le personnage que d’observer ces deux mains en lutte dont le combat s’imprime sur le papier par des lignes enchevêtrées. Les mains incarnent alors l’affrontement plus qu’elles ne le dessinent véritablement.
La mise en scène de la main peut aussi servir de glissement entre différentes séquences : aux effusions à venir ou à l’action qui vient de se jouer contraste le geste lent, apaisé, presque dansé, de la main venant faire glisser le cache de la caméra et plonger l’écran dans le noir. Ce mouvement qui obture l’image joue ainsi comme espace de transition, aussi bien physique et narratif.

Musique et dessin, une relation dialogique
Venons-en maintenant à un aspect dont nous n’avons pas encore discuté et pourtant au cœur de nos spectacles : la musique. Durant la création, avec Matthieu Chiara, nous écrivons l’histoire ensemble, nous élaborons les différentes scènes ensemble et nous les dessinons ensemble. Puis vient le moment de l’élaboration de la partition musicale qui là, revient entièrement à Matthieu dont la longue pratique de la guitare lui ouvre les voies de la composition (le jour des représentations, il interprète les morceaux tandis que je dessine les images). Une fois les harmonies conçues, arrive une nouvelle étape de travail où tout prend forme, celle de l’ajustement de la musique avec les dessins. Ce temps de mise au point est essentiel car l’apport des mélodies nous permet de perfectionner les systèmes, de renforcer leur efficacité, de repenser certaines scènes et de changer des morceaux : à ce stade, les parties graphiques et musicales sont certes définies mais encore malléables afin de trouver la synergie que nous recherchons et qui les rend indissociables. Car si Pilau Daurès notait que « tous ces spectacles installent une subordination plus ou moins affirmée du dessin à la musique, conduisant le dessin à abdiquer tout ou partie de son pouvoir narratif[9] », tandis que d’autres producteurs de concerts dessinés tendent au contraire à minimiser le rôle de la musique, nous envisageons pour notre part l’idée de dialogue et de collaboration entre les deux. La musique n’accompagne pas seulement le dessin mais devient un véritablement actant du récit, tandis que le dessin ne perd en rien son apport narratif tout en pouvant recouvrer des qualités sensibles et musicales.
Cette interaction se joue d’abord sous le mode de la synchronie : la musique et le dessin adhèrent aux mêmes rythmes et s’accordent à l’unisson aux impératifs narratifs de la scène. Lors de séquences plutôt contemplatives, la guitare installe une ambiance sonore prégnante à laquelle répondent les déliés amples du pinceau : la chorégraphie de la main et le rythme de la musique s’unissent alors dans le même dessein. Il en va de même lors de scènes plus intenses d’effusions mutuelles, où les torrents de notes et de couleurs donnent à voir et à entendre l’acmé d’un trouble sensoriel et émotionnel. Le sonore et le visuel peuvent aussi interpréter les mêmes péripéties à la manière d’un dialogue qui renforce le discours principal : un élément perturbateur se dessine dans l’image, un épanchement soudain de peinture ou la manipulation d’un cache se trouvent soulignés par des variations mélodiques. La rupture opérée dans l’organisation générale de l’image ou dans le récit initialement esquissé se perçoit autant à l’écran qu’à l’oreille. Il nous faut alors nous coordonner parfaitement pour que la note et le trait s’accordent parfaitement. Cet exercice se révèle particulièrement délicat car le dessin doit être minuté afin de s’accorder au rythme de la partition tandis que la guitare doit s’harmoniser au retard ou à l’avance du dessin qui ne saurait être exécuté avec la même régularité que l’instrument de musique. Durant la représentation, nous échangeons beaucoup du regard afin de s’assurer de la parfaite symétrie de nos interventions.
D’autres fois, la musique peut davantage suivre le dessin, accompagner l’avancée de l’image en s’accordant à son rythme. Cette très fine latence ne se perçoit pas par les spectateurs, mais compte beaucoup dans la création et l’interprétation du spectacle. Lorsque les manipulations sont complexes ou qu’un dessin exige une temporalité élastique, Matthieu compose une partition relativement flexible dont il peut modifier la durée en fonction de l’avancement du dessin : il joue le morceau les yeux tournés vers l’écran, s’accordant à la progression de l’image, renouvelant certaines boucles ou anticipant une conclusion prématurée.
Pour d’autres scènes encore, la partition est plus fixe et il revient alors au dessin de suivre et respecter le tempo de la musique. La réalisation de l’image est alors véritablement minutée et, pour la bonne conduite du récit, doit s’astreindre à cette durée fixée par la musique. Un véritable jeu du chat et de la souris entre la guitare et le pinceau peut alors s’instaurer, comme une course ou un défi tendu par le premier au second. La mise en scène de cette rivalité peut installer une tension narrative et prend souvent la forme d’une accélération de la scène, la musique pressant le dessin devant s’achever dans les temps impartis.
L’impossible repentir
Bien d’autres systèmes ou techniques sont encore à inventer et l’ont déjà été par d’autres artistes. Le dispositif du concert dessiné nous semble encore particulièrement riche de possibilités et à ce titre cet article est à lire comme un état de notre création aujourd’hui. Chaque spectacle nous parait bien distinct des autres, mobilisant des astuces différentes qui s’accordent aux récits que nous souhaitons raconter, l’important restant à nos yeux l’apport narratif original de chaque mécanisme. Ainsi, si L’Explorateur du Cosmos regorge d’effets spéciaux pour adhérer au merveilleux de l’espace mais qui nous engagent à entrer dans un travail de manipulations soutenu, nous avons adopté avec Poison une approche plus ancrée dans la pratique du dessin afin d’installer une ambiance plus contemplative, ponctuée toutefois de scènes qui nécessitent l’usage de constructions en bois, de grandes lentilles de tailles et d’incurvations différentes ou encore d’huile de paraffine, tandis que Coda se compose d’une seule feuille de papier, le dessin procédant entièrement par accumulation et transformations figuratives.
Au-delà de l’invention de systèmes graphiques et musicaux interprétant les différentes péripéties de l’histoire, notre désir de lier le spectaculaire au narratif implique une autre contrainte : durant les représentations, nous ne pouvons pas rater une scène au risque que la logique du récit ne s’étiole. Le manque de clarté d’une scène peut gâter voire gâcher l’histoire[10], et la multitude des artifices et leur sophistication rendent parfois le spectacle délicat à réaliser et impose une grande rigueur lors de sa préparation. Si une partie des scènes est préparée à l’avance et si nous connaissons parfaitement nos partitions mutuelles, la temporalité inhérente au spectacle rend tout repentir impossible. Un trait trop ample, court, tremblé ou trop épais risque de compromettre la composition que nous avons soigneusement planifiée, mettant en péril la fluidité narrative de la scène. Ainsi, alors que certains artifices peuvent être magnifiés par la simplicité de leur exécution, il est crucial que les scènes se déroulent sans accroc afin de laisser place à la magie de l'instant. Nous répétons donc méticuleusement, veillant à ce que chaque séquence se déroule harmonieusement, en examinant chaque détail, depuis le sens dans lequel les feuilles circulent jusqu'à la disposition spatiale des pinceaux, afin que tout concorde avec le récit et que la poésie des scènes puisse pleinement opérer.
Jean-Charles Andrieu de Lévis, relu par Matthieu Chiara

[1] Pilau Daurès, « Le dessin vivant », Du9, octobre 20113. En ligne : https://www.du9.org/dossier/le-dessin-vivant/
[2] In Camille Cimper, « Les premiers concerts de dessins à Angoulême. Entretien avec Benoît Mouchart », Neuvième art. En ligne : https://www.citebd.org/neuvieme-art/les-premiers-concerts-de-dessins-angouleme-entretien-avec-benoit-mouchart
[3] En aparté, je me permets d’enfoncer des portes ouvertes en soulignant que, malgré l'effort déployé pour décrire les méthodes que nous employons dans nos spectacles, la meilleure manière de les appréhender demeure encore de les découvrir en personne, d'assister à des concerts dessinés et d’en produire. Se pose aussi une question que je ne peux développer ici, celle, pourtant essentielle, de la trace que laissent ces concerts, de la conservation de ces évènements éphémères, de la possibilité de les consulter et de l’inéluctable déception lors du visionnage d’une captation. Il demeure toutefois essentiel de poursuivre la réflexion afin de faire évoluer cette pratique et de la sortir de l'ombre des festivals de bande dessinée et à ce titre, le travail et l’énergie de Camille Cimper sont remarquables (voir notamment son mémoire Pour une chorégraphie du geste dessiné disponible ici https://calameo.com/books/0073843232751c4b58b25) et je la remercie, ainsi que Sylvain Lesage et Irène Le Roy Ladurie, de m’avoir convié à cet espace de réflexion.
[4] Philippe Marion, « Narratologie médiatique et médiagénie des récits », in Recherches en communication, n° 7, 1997, pp. 61-88. »
[5] Ibid, p. 82
[6] Ibid, p. 83.
[7] Camille Cimper, « Quand le dessin devient spectacle », Neuvième art, mai 2023. En ligne : https://www.citebd.org/neuvieme-art/quand-le-dessin-devient-spectacle
[8] Article cité.







