
dans l’atelier de... zoé sauvage
[Août 2020]
Nouvelle venue dans la bande dessinée, Zoé Sauvage prépare un roman graphique sur des femmes qui ont bouleversé notre connaissance du vivant. Elle raconte le parcours qui l’a conduite de la science au dessin et à la fiction.
Thierry Groensteen : Tu as grandi en région parisienne ?
Zoé Sauvage : Oui, jusqu’à l’âge de douze, treize ans, c’est-à-dire jusqu’au moment où mes parents ont acheté une ferme en Charente et sont venus s’installer par ici.
Après, pour mes études, j’ai habité Bordeaux, Toulouse puis de nouveau à Paris. Et depuis un an me voici de retour en Charente. J’en suis arrivée à en avoir un peu marre des villes, et comme le sujet de la bande dessinée sur laquelle je travaille c’est quand même la nature, j’ai changé de lieu de vie.
Tu ne fais pas de la BD depuis très longtemps. Qu’est-ce qui t’a poussée à demander une résidence à la Maison des Auteurs ?
J’ai la place nécessaire pour travailler à la ferme, mais c’est difficile de travailler chez soi. J’avais déjà essayé dans le passé et j’avais rapidement trouvé des ateliers partagés avec d’autres artistes. Des gens qui baignaient un peu dans le même univers, de la même tranche d’âge, et avec lesquels je pouvais ressentir une forme d’émulation.
A la Maison des Auteurs, je ne viens que pour dessiner, je reste concentrée. Et puis c’est une institution ! Mes copains dans la BD m’en ont souvent parlé. J’ai été très heureuse d’être acceptée. Ça a boosté mon projet.

Tu es venue à la bande dessinée par des chemins détournés, après des études scientifiques. Tu n’envisageais pas du tout le dessin, à cette époque ?
Je dessine depuis toute petite, mais je n’assumais pas ma vocation artistique. La science me passionnait, cependant j’ai compris que ce n’était pas complètement ma voie. J’ai l’esprit qui vagabonde un peu trop, sans doute…
Peux-tu préciser les études que tu as suivies ?
J’ai d’abord fait une licence en sciences du vivant, puis un Master en écologie et en comportement animal. C’est ce qui m’intéressait vraiment – et qui m’intéresse toujours, d’ailleurs, puisque ma BD parle de ça. J’aurais dû enchaîner sur une thèse. Cela supposait de commencer par trouver un laboratoire qui pouvait me prendre. Mais il y a peu de places, peu d’argent, et on ne fait pas du tout ce qu’on veut, c’est très encadré. Sans parler de l’esprit de compétition qui y règne…
Tu as décroché ce Master en 2008, et tu as décidé de te tourner vers la vulgarisation.
Oui, j’ai consacré une année à tourner et monter, en solitaire, un film documentaire sur le frelon asiatique [1], une sorte de film de guerre montrant le combat des abeilles contre leur nouvel ennemi.
Tu l’as autoproduit ?
Totalement, et avec très peu de moyens. J’ai montré le film dans plusieurs festivals, obtenu un prix ou deux, et je l’ai édité en DVD, qu’il m’arrive de vendre encore un peu. On ne parlait pas encore beaucoup du frelon asiatique à l’époque, il est en train de se répandre partout en Europe mais à ce moment-là il apparaissait juste dans le sud-ouest de la France. J’ai filmé dans la région bordelaise.
Ce n’était pas dangereux de filmer les frelons de près ?
Si. Et je me suis faite attaquer. J’ai approché ma caméra à quelques centimètres de l’ouverture d’un nid de frelons et ils l’ont aussitôt entièrement recouverte. Ça donne un plan assez impressionnant ! Heureusement j’étais en tenue d’apicultrice, je prenais tout de même quelques précautions…

Tu n’as pas voulu enchaîner sur d’autres documentaires ?
Non, je me suis embarquée dans l’écriture d’un autre projet audiovisuel, mais complètement différent : une série d’animation pour enfants. Ça s’appelait Les Chtarbés de la nature et ça se passait dans un jardin. Cette fois je n’étais pas toute seule, il y avait une maison de production, La Station Animation, et une dessinatrice, Eva Rollin – qui avait fait les beaux-arts à Angoulême, d’ailleurs. Mais nous n’avons pas été plus loin que le pilote [2] ; on avait obtenu plusieurs bourses du CNC, ce qui nous a permis de travailler pendant deux ans, malheureusement les chaînes de télévision n’ont finalement pas donné suite. On voulait créer quelque chose d’ambitieux associant une plate-forme internet, et je crois que ça leur a fait un peu peur. Elles n’étaient pas encore prêtes pour cela. Tout le monde me dit que cinq ans plus tard, le projet aurait été pris sans problème.
C’était l’histoire de deux enfants…
… qui pouvaient se transformer en insectes ou autres bestioles du jardin, grâce à une machine inventée par leur grand-mère farfelue.
Pourquoi ne voulais-tu pas faire la conception graphique toi-même ?
Je n’étais pas encore assez sûre de moi dans ce domaine. Et puis j’avais envie de collaborer avec quelqu’un.
A quel moment as-tu décidé que tu pouvais être dessinatrice et plasticienne ?
J’ai d’abord eu une période où je me suis consacrée à la peinture, la sculpture, les installations.
Tu étais autodidacte, en ce qui concerne la création artistique ?
Oui. Mais quand j’ai compris que dans le monde de l’art, j’allais galérer, je me suis dit : « Autant faire ce qui te plaît vraiment, c’est-à-dire de la bande dessinée ». J’ai toujours été très fan de BD. Il y en avait beaucoup à la maison.

Peux-tu mentionner quelques auteurs ou autrices qui ont été importants pour toi ?
Dans les dernières années, Brecht Evens, pour son travail de couleur, d’aquarelle. Il m’a fait comprendre qu’on pouvait faire des choses incroyables en BD. J’aime aussi beaucoup les dessinatrices Aisha Franz [3], Amandine Meyer dans un genre plus expérimental [4], Moa Romanova [5] et Liv Strömquist, pour le propos, l’humour et la façon dont elle marie texte et image.
La couleur est une dimension importante pour toi, en général…
Oui, c’est mon dada. J’ai arrêté la peinture mais je fais de temps en temps des illustrations à la gouache, comme récemment un ex-libris pour la revue Topo.

Tu as suivi en 2018-19 une formation en « roughs et storyboards de bande dessinée » à l’école CESAN, une école parisienne privée créée une dizaine d’années plus tôt…
Oui, c’était une formation professionnalisante pour adultes, au rythme d’une journée par semaine, le mardi, pendant six mois. Les enseignants – Anne Guro (Ange), Alessandro Tota, Estelle Quinion, Marc Lizano et Singeon – étaient vraiment très bons. J’y ai aussi appris les principes du scénario, du découpage et de la mise en scène, ce qui m’a aidée à structurer mon projet. Vraiment, cela m’a été très utile, il m’arrive encore de relire des cours et j’ai gardé le contact avec certains profs qui suivent mon avancée.
Ta famille étant installée à côté d’Angoulême, tu n’as pas envisagé de venir y étudier la bande dessinée ?
Comme j’avais déjà fait cinq ans d’études, je ne voulais pas repartir pour un cycle de plusieurs années…


Tu as fait une résidence artistique à Reykjavik, en 2018. Comment avais-tu décroché cela ?
Une copine de Paris avait séjourné en Islande et y avait découvert une galerie collective, avec des ateliers. Il y a eu un appel à résidence, j’ai postulé et j’ai été prise. Ce fut une expérience très intense et enrichissante. La pensée animiste survit encore, en Islande. Il y a encore des gens qui croient aux elfes et au peuple des pierres ! C’est aussi pour cela que je voulais y aller. J’ai fait pas mal de randonnée là-bas, vu des volcans de toutes les couleurs… Malheureusement l’industrie minière détruit une partie des paysages. La chanteuse Björk se bat contre ça.

Quand tu vivais à Paris, tu animais régulièrement des ateliers d’arts plastiques pour les enfants…
Oui, dans une MJC associative, le centre d’animation Paris Mercœur, près du métro Voltaire, dans différentes bibliothèques, et pour une association, Les Petits Débrouillards, qui promeut les sciences auprès du grand public. J’aimais bien mélanger art et science, amener les enfants à créer à partir des phénomènes de la nature. C’est une expérience qui m’a beaucoup plu mais il était difficile d’en vivre.
Tu apprécies le travail de vulgarisation scientifique de Marion Montaigne ?
Ah oui, j’adore ! Elle me fait trop rire. Même la série d’animation, je suis fan… On a besoin de gens comme elle pour parler des sciences. J’aimerais bien réussir à en faire partie. Je suis entrée en contact, par l’intermédiaire de Boulet, avec la directrice de la nouvelle collection de BD scientifiques chez Delcourt, « Octopus », et un jour j’y ferai peut-être quelque chose.
Pour l’instant, tu n’as encore aucune publication professionnelle à ton actif. Tes deux seules bandes dessinées sont deux petits livres autoédités de 32 pages, que tu as présentés au festival d’Angoulême en janvier de cette année…
C’est ça : Sœur + sœur + sœur + sœur, sur la sororité, qui donne un pouvoir surnaturel à quatre filles dans une forêt, et L’Amour impossible, un drame humoristique entre une jeune femme et une prairie de fleurs allergènes. Je les ai imprimés ici, à la Maison des Auteurs, en numérique sur du beau papier. La prochaine fois, j’aimerais essayer la risographie.


Tu les présentais sur un stand ?
Sur celui du collectif Marsam, financé par Magelis, dans l’« Espace Nouveau Monde ». C’est un groupe que j’aime beaucoup, qui a bien voulu m’accueillir en son sein.
Pour le roman graphique sur lequel tu travailles, tu as un éditeur ?
J’ai trouvé en juillet une éditrice, en la personne d’Isabelle Cambourakis. Il y a des livres de sa collection féministe « Sorcières » qui m’ont vachement inspirée. Elle est la première à qui j’ai envoyé mon projet et elle a tout de suite répondu favorablement. Même si ce n’est pas elle la spécialiste de la BD dans la maison, mais plutôt son frère Frédéric. « Sorcières » est principalement une collection d’essais mais qui a déjà accueilli deux ou trois BD, des traductions de livres étrangers. Mon livre sera la première BD de création.
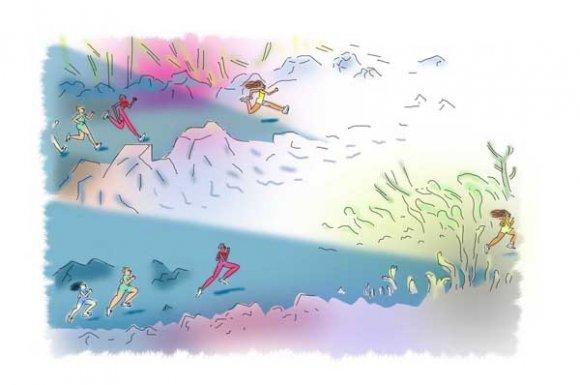
Tu te réclames de l’écoféminisme. Pourrais-tu expliquer le concept pour ceux et celles qui ne le connaîtraient pas ?
Je suis écoféministe, entre autres choses. Ce n’est pas ce qui me définit en tant que personne. Féministe depuis toujours, j’ai compris, notamment grâce aux livres publiés par Isabelle, que ce n’était pas un combat séparé de l’écologie. Le concept d’écoféminisme n’est pas nouveau, il a été forgé dans les années 1970 par une française, Françoise d’Eaubonne. L’idée, c’est que l’asservissement des femmes et la destruction de la nature procèdent d’une même logique de domination, de hiérarchie. Il faut combattre ensemble toutes les idées de suprématie, des hommes sur les femmes, des blancs sur les noirs, des hommes sur les animaux, etc. A la base, le mal est le même, c’est une manière de penser dont l’humanité doit essayer de se débarrasser. J’aborde cette question dans mon roman graphique en préparation.
Tu penses qu’il est encore temps de sauver l’humanité du désastre, notamment climatique ?
Je crois que c’est encore possible si on agit tout de suite. On doit encore pouvoir éviter un choc trop dur si on ne prévient pas la « chute » par une décélération consciente, tous ensemble. Plein de gens l’ont compris, mais beaucoup se sentent coincés par le système. Ils sont tout de même de plus en plus nombreux à changer intérieurement. Même les gilets jaunes ont exprimé à leur manière le fait que quelque chose ne va pas dans le monde tel que nous le connaissons. Ce qu’il faut, c’est proposer des alternatives, pas juste « être contre ceci » ou « contre cela », montrer que d’autres façons de vivre sont totalement enviables.

Indépendamment des messages que tu veux faire passer dans ta bande dessinée, quelle(s) forme(s) prend ton militantisme ?
J’ai participé à pas mal de manifs, et à mon petit niveau je travaille, avec mon frère, à la construction de notre ferme résiliente, en permaculture, pour devenir autosuffisants et, à terme, créer un lieu de vie collective. Nous sommes des néo-paysans (rire).
Tu n’es membre active d’aucune association ?
J’ai été tentée, mais je préfère contribuer à changer mes esprits par les BD que je vais publier. J’aime beaucoup Extinction Rébellion, mais si je me mettais à travailler avec eux, je voudrais m’investir à fond. On ne peut pas être partout, on doit faire des choix…

Alors parlons de ce roman graphique qui fait l’objet de ta résidence et que publiera, donc, Cambourakis. Le titre en est toujours Les Fées scientifiques ?
Oui. L’action est située dans un futur proche, en 2035. Mais ce n’est pas un récit réaliste, j’invente une réalité un peu alternative. Au lieu de parler de robotique ou d’intelligence artificielle comme la plupart des œuvres de science-fiction actuelles, je parle des sciences du vivant. Dans le monde que je décris, on a enfin compris qu’il faut absolument protéger la jungle amazonienne et les autres réservoirs de biodiversité. J’imagine l’existence de méga-parc naturels, hyper-protégés et complètement fermés à toute présence humaine, à l’exception d’une base scientifique. L’héroïne, Zoa, est un peu inspirée de moi jeune fille. Elle a, au départ, une mentalité assez cartésienne et elle va s’ouvrir peu à peu. Elle a étudié les sciences du comportement et elle va faire un stage dans un de ces parcs.

Zoa, « une jeune femme très sensible, en proie à des crises d’angoisse », si je m’en réfère à la présentation sur le site de la Maison des Auteurs…
Oui, ce n’est donc pas du tout moi (rire). Elle essaie de s’intégrer dans un monde scientifique encore très masculin. Et elle va découvrir, en se perdant dans le parc où elle étudie la nature, que des femmes scientifiques y vivent de manière totalement hors-la-loi. En l’occurrence, il s’agit de femmes existantes ou qui ont existé.
Comme Jane Goodall, l’éthologue et anthropologue britannique devenue une icône, qui, en 2035, aurait 101 ans...
C’est la première que rencontre Zoa. Il existe un formidable documentaire sur Jane, où on la voit, lady anglaise aux gestes très gracieux, élégante, grimper aux arbres et faire des trucs de dingues, seule dans la forêt avec ses singes, avec lesquels elle a établi des liens très étroits. Elle a été la première à aller sur le terrain ! Ensuite, Zoa fait la connaissance de Barbara McClintock, une généticienne américaine des années cinquante, qui vivait enfermée dans son monde, entrait dans des méditations transcendantales, et réussissait à voir l’ADN avec un simple microscope, ce qui est impossible. Ses sensations lui permettaient de comprendre des choses qu’elle ne pouvait pas techniquement observer avec les instruments dont elle disposait. Très en avance sur son temps, elle a réussi à démontrer le caractère mobile du génome. Une femme vraiment incroyable, qui m’a fascinée ! Les femmes scientifiques dont je parlerai ont toutes développé des techniques outsider, non conformistes.
Chacune de ces femmes délivre à Zoa une leçon… ?
Oui. Jane Goodall lui enseigne que seul le contact direct avec la nature permet de vraiment la connaître. Temple Grandin, une autiste américaine toujours en vie, développe sa théorie – vérifiée depuis par les neurobiologistes – selon laquelle les autistes ont une perception du monde similaire à celle des animaux, ce qui s’explique par le fait que leur cortex préfrontal est mal connecté au reste du cerveau. Il s’ensuit que leur pensée est visuelle et non conceptuelle. Elle, elle a utilisé son handicap, l’autisme, pour faire des études sur les vaches. Je la mets en scène avec des aurochs.
Est-ce que ta fiction ne risque pas de tourner à la démonstration un peu didactique ?
C’est en cela que l’exercice est difficile… J’évite les grandes explications, je montre Zoa qui entre dans les expériences scientifiques conduites par ces femmes, avec elles.
Tu donneras des références bibliographiques à la fin, pour ceux et celles qui voudront approfondir ?
Oui, j’aimerais beaucoup. Qu’il y ait carrément en annexe une présentation de chacune de ces femmes.
Tu n’as pas essayé d’entrer directement en contact avec l’une ou l’autre d’entre elles ?
Si, avec Monica Gagliano, une jeune chercheuse australienne qui travaille sur l’intelligence des plantes. Elle est très occupée mais elle est complètement d’accord pour apparaître dans une bande dessinée. J’aimerais bien la rencontrer quand elle viendra en Europe. Je n’ai contacté aucune des autres. J’espère qu’elles ne verront pas d’inconvénient à figurer dans une fiction.
Tout ça va faire un livre de quelle ampleur ?
Je me suis fixé environ 160 pages.

Et à quel stade de la réalisation en es-tu ?
J’ai un scénario complet mais non détaillé. J’ai commencé le storyboard de certaines scènes, et fait des essais plus aboutis sur quelques planches. Je laisse mon dessin au crayon, sans encrage. Pour la couleur, je pensais la traiter au moyen de crayons de couleur et pastels, mais je suis en train d’essayer d’autres techniques, rien n’est encore fixé.
Quel délai t’es-tu donné ?
Je voudrais finaliser le storyboard complet au début du printemps 2021. Pour ce qui est de la production des planches, je ne peux pas bien mesurer le temps qu’elle me prendra, parce que je manque d’expérience. Ce n’est pas évident de se lancer dans un roman graphique comme premier livre !
Tu te consacres pleinement à ce projet ?
Oui, mais en m’autorisant quelques petites choses à côté. Je prépare une histoire pour le collectif des Siffleurs, auquel participe aussi Lisa Chetteau, qui a été interviewée avant moi pour cette rubrique sur NeuvièmeArt. J’ai aussi une commande d’affiche pour le Pôle Image, destinée à annoncer un colloque sur les fantômes, ectoplasmes et squelettes dans la BD.
A quel moment as-tu abandonné ton vrai patronyme pour ce pseudo, Zoé Sauvage ?
Après le film documentaire, je crois, qui était encore signé Zoé Delépine. Quand je me suis lancé dans la peinture et la sculpture.
Qu’est-ce qu’il dit sur toi, ce nom d’artiste ?
Sauvage, pour moi, ça ne signifie pas dangereux ou agressif. C’est plutôt un synonyme de libre. On est sauvage quand on n’a pas été domestiqué. J’essaie de ne pas l’être.
Tu possèdes des animaux ?
Oui, j’ai deux chiens, un chat, et neuf poules. Elles sont trop géniales, ces poules ! Une éthologue a découvert qu’elles ont une sorte de langage et peuvent émettre près de trente vocalisations différentes, qui ont des sens précis. Les cochons aussi sont très intelligents. On commence à voir sortir plein d’études passionnantes sur les espèces domestiques.

Disons un mot de tes sculptures. Tu as fait des petits formats et de plus grandes installations. Tu utilises du textile ou des matériaux naturels : coquille d’œuf, argile, perles…
C’est ça. Et je me laisse inspirer par les formes de la nature, notamment végétales, avec une recherche de poésie et l’expression d’une approche un peu épicurienne de la vie. Mais je n’en fais plus trop actuellement. C’est par périodes. J’aime bien la scénographie, aussi. Et je devrais concevoir, pour le prochain FIBD, celle d’une exposition collective sur les femmes et la nature, avec une dizaine d’autres filles, organisée sous l’égide d’Hélène Dupuy, qui a ouvert un lieu en ville appelé Fichtre Diantre, à la fois boutique d’images et lieu d’expo, d’ateliers et de rencontres.
Merci Zoé. Et bon vent aux fées !
(Propos recueillis à la Maison des Auteurs le 14 août 2020.)
[1] Frelon asiatique, le loup dans la bergerie, 2009, 47’ ; http://www.frelon-asiatique-lefilm.fr
[3] Brigitte et la perle cachée, Ça et là, 2013 ; Shit is real, L’Employé du moi, 2017
[4] Plusieurs livres chez Misma éditions et Ion.
[5] Toujours tout foutre en l’air, chez Revival, en 2019.







