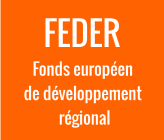Danièle Alexandre-Bidon – Entretien bédéphile
Retranscription de l’entretien avec Danièle Alexandre-Bidon, mené par Angélina Pato Nunes, étudiante en master 2 « Bande Dessinée : Édition, Théorie et Critique » de l’université Bordeaux Montaigne, durant l'année scolaire 2022-2023.
Angélina Pato Nunes : Quelle a été votre première expérience de la lecture de BD ? Une BD vous a-t-elle particulièrement marquée ?
Danièle Alexandre-Bidon : Ma première expérience de la lecture de la BD c’était avant la rencontre de Monsieur Couperie. Elle remonte à mes 8 ans à peu près. Une fois, quand j’étais petite fille à mes 7 ans, j’ai eu envie d’une bande dessinée en passant devant un kiosque à journaux, avec tous les illustrés qui paraissaient le jeudi à l’époque. J’ai été éblouie devant une couverture du Journal de Nano et Nanette, ces deux petits enfants blonds absolument adorables. Bien sûr comme tous les enfants, j’ai dit à ma mère, qui ne lisait pas de bande dessinée : « Maman, maman ! Je veux cet album. » Elle m’a dit non, bien sûr. Je pensais qu’elle me l’avait refusé à jamais, mais j’ai eu la surprise de retrouver il y a quelques mois une photo de moi à 8 ans avec cet album, peu après cet épisode . Mes parents étaient d’origine provinciale et ils n’avaient pas de contact avec la bande dessinée, mais ils aspiraient à une bourgeoisie établie , ce qui les empêchait de donner cela , surtout à une fille. Le jour de notre déménagement à Neuilly-sur-Seine, ils m’ont offert un Nano et Nanette. Visiblement, cela ne m’a pas marqué plus que ça, car je n’en ai pas demandé un deuxième (rire). Mais c’était mon tout premier contact avec la bande dessinée.
Mon deuxième contact fut dans mon école. On avait des professeurs extrêmement progressistes, et pour l’enseignement, notamment des langues, ils nous faisaient travailler sur des bandes dessinées, des illustrés, des hebdomadaires. C’était des BD espagnoles, mais je ne me souviens pas des titres... Et ce n’était pas beau, j’ai été frappé par le côté un peu « grossier » des dessins. C’était vraiment de la grosse cavalerie, du comics, et ça ne m’a pas plu. Mais je trouvais quand même que c’était vivant et que pour apprendre les langues c’était très bien. C’était une expérience plutôt pédagogique dans une école qui s’appelle l’École alsacienne, qui faisait des expériences pédagogiques sans cheval de bataille . C’était une école privée. Dans le public, ça aurait peut-être été moins bien perçu de travailler sur de la bande dessinée.
Ensuite, pour ma troisième expérience de la BD, il a fallu attendre très longtemps. J’ai passé mon bac assez jeune, à 16 ans. Naturellement, j’ai été privée de BD, mais je pouvais lire beaucoup de livres et être en avance (rire). Je suis entrée à 17 ans à la fac et là, ça a été un bouleversement, car étant socialement bien placés à Neuilly-sur-Seine, on allait à la fac de Nanterre, qui était le contraire absolu de ce dont rêvaient nos parents pour nous : le parfait royaume de la liberté pour une adolescente. Aller seule à la fac, rencontrer d’autres gens, c’était vraiment étonnant. Bon, il n’y avait pas de BD à la fac, ça c’est sûr (rire). Mais, j’ai fait la rencontre d’un garçon, qui est ultérieurement devenu mon mari, et dont le père était professeur d’université en linguistique africaine. Il avait été haut fonctionnaire dans l’économie, était totalement angliciste et passait son temps à faire des cours aux États-Unis dans les universités et, depuis la jeunesse de ses enfants, revenait de là-bas avec de la bande dessinée américaine, entre autres avec les Peanuts de Charles Schulz. Et là, je suis tombée en admiration intellectuelle devant les Peanuts qui m’ont littéralement ouvert les yeux. Là, je me suis dit, la BD c’est quelque chose ! C’est une langue, une littérature, une pensée, une philosophie, c’est tout ce qu’on veut. C’est comme la littérature, c’est pas du tout ce que j’avais lu jusqu’à présent.
À ce moment-là, donc en fac, j’ai fait une licence d’histoire et à la dernière année je suis tombée sur un professeur d’archéologie médiévale. Finalement, j’ai été séduite par le moyen-âge français et c’est là que tout a commencé. En fait, les archéologues ne sont pas des gens conventionnels, notamment les archéologues médiévistes qui ne sont pas des archéologues classiques. L’archéologie médiévale était une science qui débutait, on n’avait pas de grands modèles académiques de la Sorbonne, on avait seulement comme modèles les Anglo-saxons. Cette ouverture d’esprit qui donnait la naissance d’une sous-discipline archéologique m’a permis de rencontrer d’autres archéologues, qui eux aussi étaient passionnés de BD. Ensuite, les choses se sont entremêlées. D’abord, la première rencontre a été avec Patrick Perrin, directeur du musée des Antiquités nationales. Celui-ci avait alors l’intention avec quelques amis de faire une exposition sur Alix de Jacques Martin et, voyant que j’étais passionnée de BD, il m’a demandé si je voulais en être. J’ai immédiatement dit oui bien sûr. Cela a donné lieu à l’expo AVE ALIX, dirigée par l’association Clovis formée d’historiens et d’archéologues, qui a eu lieu dans la chapelle de la Sorbonne en 1984. Ça c’était mon premier vrai contact avec un travail de BD, et non pas seulement le plaisir de la lecture. On avait une sorte, comment dirais-je… non pas d’alibi, mais en tout cas de grands patrons, qui étaient un certain nombre de musées tels que le musée Carnavalet, la réunion des musées nationaux… Tout y était [elle montre le fascicule de l’exposition]. Aussi, on avait obtenu l’autorisation de Casterman de publier des images et qu’il nous protège contre l’auteur, qui soit dit en passant, était un épouvantable monsieur. Il nous faisait des procès, car on a osé dire que son Alix n’était pas un vrai document historique, alors que lui prétendait sa BD pouvait servir de leçon aux historiens, notamment dans l’enseignement secondaire. Donc c’était très amusant à faire et en fait c’est sous l’angle historique et archéologique que j’ai commencé à m’intéresser à la BD. Alors les années sont passées très vite, nous avons travaillé un ou deux ans pour préparer ça.
APN : Peut-être, avez-vous un témoignage à partager sur votre rencontre avec le travail de Monsieur Couperie ?
DAB : Oui, dans les mêmes temps, j’avais découvert que dans mon université, l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), il y avait un séminaire pouvant aller de 4 à 19 personnes regroupant des chercheurs, des spécialistes, des étudiants ou autres. C’était un séminaire sur l’histoire de la bande dessinée présenté par Pierre Couperie, que je ne connaissais pas encore. Je me suis inscrite en 1979, mais il a vraiment pris son essor en 1980. Là aussi, ce séminaire a été un regroupement de personnalités et a créé d’autres synergies. Il y avait par exemple Patrice Caillot, qui était le conservateur à la bibliothèque nationale et un très grand connaisseur de la bande dessinée. Quelques fois, des dessinateurs de BD venaient aussi. Nicole Lambert a tellement aimé le séminaire qu’elle y est restée et est devenue la meilleure amie de Pierre Couperie. C’est elle qui a dessiné les personnages des Triplés qui étaient prépubliés dans Le Figaro Madame. Il y avait également une jeune femme qui faisait une thèse sur la mort dans la bande dessinée. Elle est devenue ensuite directrice d’édition chez Paris Bibliothèque, qui font beaucoup de catalogues d’expositions… donc elle était en lien avec l’art, mais aussi avec les caricatures. Ces personnalités n’ont cessé de se rencontrer par la suite et ont commencé à former un groupe de « fans » autour de l’approche qu’avait Pierre Couperie. Son approche n’était pas du tout une approche de la BD dans le monde éditorial ou commercial, mais une approche d’historien. Je me suis donc toujours rattaché à la bande dessinée via l’histoire. Pierre Couperie avait une qualité particulière : il ne voulait pas aller sur les sites commerciaux ni travailler pour une maison d’édition, il ne voulait pas gagner de l’argent avec la BD, il souhaitait juste en faire l’histoire. Et donc, il emmenait plusieurs d’entre nous au festival de la BD de Lucca en Italie. Il s’agit d’un précurseur du festival d’Angoulême. La différence fondamentale est que tout le monde de la BD s’y retrouvait mais sans les rapports commerciaux. Certainement que les gens discutaient entre-deux, se promettaient de se voir et de faire des contrats ; mais l’idée était d’être sur place ensemble, de voir des expositions de BD, de faire des conférences, d’assister à des représentations de dessins animés, visiter ensemble des musées, aller de réception en réception avec le maire de la ville ou les éditeurs de la ville, le tout sur un pied d’égalité. Cela représentait des centaines de personnes invitées, qui quelques fois comme moi, étaient dans l’obligation de faire une conférence d’une heure pour justifier de sa présence et de sa prise en charge. Par manque de moyens, le festival a fini par se faire uniquement une année sur deux, puis a fini par s’estomper… Par ce biais du festival, nous avons pu rencontrer tous les acteurs de la bande dessinée, des dessinateurs, des auteurs comme Thierry Groensteen, des éditeurs avec qui on parlait peu parce que nous n’avions rien à leur proposer. Il y avait une délégation par pays du monde. C’était étonnant car pendant une semaine, on pouvait être en contact avec aussi bien des dessinateurs américains qu’anglais que yougoslaves. C’était tout à fait extraordinaire. On passait des heures au café ensemble et il ne nous traitait ni comme des jeunes, ni comme des étudiants, ou des historiens loin du monde de la BD. Cela permettait à des étudiants ou à des personnes qui commençaient à peine d’échanger ou bien de rencontrer des dessinateurs extrêmement connus (sourire).
APN : C’est incroyable, quelle richesse.
DAB : Alors, le premier entrelacement que je vais vous faire , c’était avec l’archéologie : mon métier. J’ai commencé par regarder l’image de l’archéologue dans la BD. Cela a été une de mes premières conférences à l’école, j’avais appelé ça « l’archéologue de papier ». On faisait des conférences longues et sérieuses bien documentées avec des diapositives. Les archéologues s’intéressaient à la bande dessinée, il y avait des colloques un peu partout, dans lesquels ils faisaient parler ceux qui souhaitaient parler de la bande dessinée.
Cela pouvait aussi passer par des sociétés savantes, par exemple avec le bulletin de la société archéologique, historique & artistique : Le Vieux Papier. C’était des gens extraordinaires qui collectionnaient tout, des cartes à jouer du 16e siècle jusqu’aux BD. Les historiens étaient extrêmement ouverts à ça.
La 3e connexion qui m’a poussée là-dedans aussi, c’est le musée des Arts et Traditions populaires où nous avions nos bureaux d’archéologie. Le musée m’a fait écrire des choses qui ont entrelacé le moyen-âge et la BD. Je passais mon temps à indiquer des images BD pour les expositions. J’ai fait des liens avec l’iconographie des enluminures et le langage de la BD. Au moyen-âge, on utilise ce phénomène du texte et de la case, quelques fois les paroles s’échappent de la bouche d’hommes ou d’animaux. Les procédés de la bande dessinée, comme la succession des cases pour raconter une histoire ou l’expression du son et du mouvement, avaient déjà été découverts par les artistes médiévaux. Dans la revue Ethnologie française, elle aussi située dans le musée des Arts et Traditions populaires, il y a eu un numéro appelé « entre l’oral et l’écrit » et ils m’ont demandé un article sur « écrire le son au moyen-âge » dans lequel j’ai essayé de montrer les précurseurs dans les enluminures. Beaucoup plus tard, deuxième moitié des années 1990, la Bibliothèque nationale s’y aussi est intéressé. Ils m’avaient demandé d’écrire sur Gallica sur « la BD avant la BD ».
Tout s’entremêlait, le métier d’archéologue, sa représentation, la BD, les images médiévales que je commençais à étudier et sur lesquels j’ai fait des livres.
APN : On pourrait dire que ce sont vos premières activités liées à la bédéphilie et à la BD dans le monde professionnel ?
DAB : En fait, je n’ai jamais été professionnelle de la BD, dans le monde de la BD. Mais chaque fois que le musée des Arts et Traditions populaires voulait faire une expo, je proposais un lien avec la bande dessinée. Par exemple, il y en a eu une sur Saint Sébastien et ils avaient utilisé le hall du musée pour mettre des BD. Beaucoup d’autres milieux d’université s’intéressaient aussi à la BD ou à la représentation du monde ou des métiers via la BD, pas seulement les sémiologues. Cela correspond d’ailleurs à une des questions que vous posez : « D’après vous, la BD était-elle un miroir des changements sociaux des années 1970 ? » C’est vrai que c’était une sorte de témoin de quelque chose. Cela me fait penser à une des premières expos que j’ai vues : « la bande dessinée témoin de son temps ». C’était déjà évident. La BD était un témoin du ressenti de la vie quotidienne et de ces années assez nouvelles.
APN : Comment votre entourage percevait-il cela ? Rétrospectivement, quels obstacles avez-vous rencontrés ?
DAB : Entre temps, j’avais commencé à acheter, acheter, de la bande dessinée, donc mes enfants ont grandi à travers un rayonnage de bande dessinée.
L’EHESS comme le musée des Arts et Traditions populaires étaient complètement ouverts à ces questions-là et ne se posaient même pas la question car ils étaient hors modèle académique. Et donc, il y avait ce regard bienveillant porté sur la BD que finalement je ne me posais pas la question de savoir si c’était bien normal, c’était évident. Je n’avais pas rencontré de gens chez qui ça posait des problèmes. À Nanterre par exemple, la formation que j’ai eue n’était pas du tout la même.
Après tout ça, j’ai décidé de travailler sur la BD en tant qu’historienne et non en tant que sémiologue et encore moins en journaliste. Car avant de pouvoir parler de la BD d’aujourd’hui, il me fallait connaître de la BD d’avant. La méconnaissance de l’histoire et de la profondeur historique de la BD me choque encore aujourd’hui. Il a fallu attendre 2022 pour que La bande dessinée en France à la Belle Époque de Thierry Groensteen, s’intéresse aux années 1890-1914 en France. Souvent, on travaille trop sur des monographies… C’est la profondeur historique qui manque, elle permet pourtant une remise en contexte.
APN : Y a-t-il des groupes de bédéphiles auxquels vous apparteniez ?
DAB : Je n’ai pas du tout appartenu à un groupe de bédéphiles. Peut-être mis à part le séminaire de Pierre Couperie, où venaient peu des historiens et dessinateurs réguliers, entre autres, pendant 17 ans. Ce n’était pas un groupe de bédéphile, mais un groupe de spécialiste de la BD. C’était un séminaire qui casait la BD dans quasi tout le contexte culturel de l’époque, aussi bien histoire de l’art que politique.
APN : Étiez-vous indépendante ?
DAB : Oui, complètement, mais toujours rattachée à une institution.
APN : Avez-vous déjà été jury ?
DAB : Non. Il n’y avait pas beaucoup de possibilités dans les années 1980 et je n’étais pas assez gradée puisque je n’étais pas professeur. J’ai tout de même participé à des jurys de thèse et j’ai pu écrire des préfaces. Un autre type de jury auquel j’ai participé, c’est pour le prix Château de Cheverny de la bande dessinée historique, initié par Pascal Ory. J’y ai participé depuis le début car j’ai été contacté dès la première session. J’avais été recommandé à Giroux par un ami, Jacques Berlioz, grand médiéviste, lui aussi très ouvert aux images et à la BD. Ils avaient essayé d’avoir un jury composé d’un médiéviste, moi ; d’un antiquisant et spécialiste de la Renaissance, Thierry Crépin-Leblond, qui dirige le musée national de la Renaissance ; un spécialiste du 17-18e siècle ; et un spécialiste de l’époque contemporaine. Pour juger de l’historicité d’un album, il fallait bien un spécialiste de chaque période.
J’ai participé à ce jury jusqu’à il y a environ 3 ans.
Au bout d’une douzaine d’années, on a pensé que beaucoup de personnes rêveraient d’être à notre place et nous avons choisi de renouveler le jury. Nous avions mis en place à chaque édition un tirage au sort pour renouveler un membre du jury sortant, qui devait alors choisir un dauphin pour le remplacer. Thierry Crépin-Leblond, débordé par son travail au musée a été le premier à partir.
Cela m’a énormément apporté.
APN : Avez-vous participé à des projets pour faire exister la BD ?
DAB : En fait ce ne me serait même pas venu à l’esprit une seconde. À l’université oui, pour lui donner plus de visibilité, mais à la limite cela ne nous intéressait pas. Dans le domaine de l’éditorial, des personnes comme Thierry Groensteen avait cela beaucoup plus à cœur. Nous étions vraiment dans le monde de la recherche, par conséquent on peut faire des recherches sur n’importe quel sujet, même sur ceux n’ayant aucune visibilité.
APN : Aux États-Unis, il y avait aussi une sorte d’effervescence autour de la BD, dans les années 1970 et 1980. Beaucoup de groupes et de collectifs se sont créés. Aviez-vous conscience de ce développement aux États-Unis ? Peut-être espériez-vous que vos travaux et votre implication participent au même essor en France ? J’ai pu lire dans une interview que vous disiez : « C’était en même temps l’histoire d’un médium (…) et l’écho des grands mouvements artistiques et littéraires qui se reflétaient dans la BD, aussi bien aux États-Unis qu’ici. »
DAB : Ah, oui ! Ce qui m’a frappé à cette période, notamment au festival Lucca, c’est qu’il y avait des vendeurs qui proposaient des planches originales ou des rééditions des BD américaines. Il y avait une sorte de nostalgie. Effectivement, leur attitude était celle de personnes nées dans les années 1930 et qui retrouvaient leur enfance en republiant ces œuvres extraordinaires. Ce phénomène nostalgique n’était pas du tout frappant en France, d’autant qu’on ne s’intéressait pas à l’historicité de la BD en France. Les Américains, eux, se sont très tôt intéressés à l’historique de leur discipline. En Italie pareil, ils avaient un « goût américanophile », et ils ont réédité une quantité incroyable de BD américaines, contrairement à nous en France. Dans les années 1970, l'éditeur Pierre Horay a quand même publié beaucoup de BD de dessinateurs américains essentiels, comme Little Nemo évidemment ! C’était d’énormes volumes, parfois il y avait une introduction de Pierre Couperie à l’intérieur, ou de l’un de ses amis professeurs de lettre. J’avais l’impression que c’était bien pris en main par cette maison d’édition, mais j’ignore complètement les tirages de ce genre de livre.
On ne faisait pas de nostalgie en France , mais sûrement à tort. Regardez, par exemple les éditions 2024 sont en train de rééditer des chefs-d’œuvre des origines du neuvième art. On ignorait qu’il y avait matière à s’intéresser à tout cela. Les érudits avaient placé la BD, les images et les volumes de 1920 ou 1930 dans la littérature enfantine. Quelques fois, il y a de très belles histoires qui ont eu lieu sur plusieurs tomes. La première BD de SF française remonte à 1910, mais ça ne ressort que maintenant. Le monde du privé est dominant aux USA et le monde du public en France. Les musées sont par exemple privés aux USA. La Bibliothèque nationale de France est désormais sensibilisée au registre de la BD, mais ce n’a pas toujours été le cas. En France, on n’avait ni mécènes contrairement aux américains, ni collectionneurs fortunés qui décidaient de consacrer leur bien à la promotion de la BD. En France, on ne pouvait fonctionner que par les institutions qui n’étaient pas prêtes à l’époque à se payer de belles éditions en couleurs. Après je n’avais pas l’impression qu’on était en retard. C’est à Paris, en 1967, qu’a eu lieu la première exposition mondiale de la BD, et non pas aux États-Unis. C’est le premier grand essai qui a permis de montrer la richesse iconographique, esthétique et narrative de la bande dessinée. Il y a aussi eu énormément de publication sous forme de journaux ou de fanzine et c’est par ce biais-là que tout a commencé en France. C’était des parutions régulières, avec souvent un numéro par mois. Par exemple, il y avait Phénix, Les Cahiers de la BD, Le Collectionneur de bande dessinée… Cela nous semblait un début prometteur ! Par contre ce qui est surprenant, c’est que les autres universités en France, en dehors de l’EHESS, ne se soient pas tout de suite emparées de la BD.
Aujourd’hui, les historiens adoptent la BD pour déconstruire les mythes nationaux et pour l’expliquer aux gens. Récemment, il y a eu La balade nationale de Sylvain Venayre et Étienne Davodeau qui déconstruit l’utilisation fallacieuse des images par des générations de dessinateurs pour la jeunesse ou les livres scolaires. C'est vraiment un ouvrage très original, absolument à lire pour les étudiants en histoire.
APN : Pouvez-vous décrire vos activités relatives à la bande dessinée ? Certaines sont peut-être méconnues…
DAB : Effectivement, depuis AVE ALIX, ma première exposition, j’ai été commissaire d’exposition à plusieurs reprises. Nous avions souvent de menus moyens… J’ai commencé par faire des expositions sur la vie quotidienne médiévale, puis j’ai proposé de réaliser des expositions sur le moyen-âge dans la BD et le musée a été très réceptif ! Depuis 2010, l’une de mes expositions tourne dans toute la France, je l’enrichis régulièrement. Par exemple, j’ai fait un ajout sur les Vikings. Il y a un côté très associatif dans ce genre d’entreprise.
Souvent, ces évènements sur la BD ne sont pas réalisés à partir de programmes prédéterminés. Il n’y a pas d’argent à gagner. Les expositions sont plutôt à l’initiative d’un réseau d’amitié au cœur des institutions. Je détourne du droit chemin des gens vraiment très sérieux (rire) !
J’ai aussi fait des conférences et énormément de colloques qui jouent un rôle très important en université. Après chaque colloque, des collègues me contactent pour me proposer de travailler ensemble sur un sujet à travers la BD. Je scanne depuis 2010 des choses anciennes, et j’ai aujourd’hui des dizaines de milliers de documents, un très grand corpus de BD. J’ai une indexation au kilomètre et des mots-clés. Si demain quelqu’un veut travailler sur les escargots dans la BD, je peux lui sortir les productions des 10 dernières années (rire) ! J’aide comme cela régulièrement des étudiants, qui peuvent venir chez moi et consulter ma grande bibliothèque. C’est ma manière d’aider les étudiants d’aujourd’hui. Cela m’est aussi arrivé d’aider des auteurs de BD. Il y en a un qui souhaitait faire une BD qui s’entrelace entre le monde contemporain et le moyen-âge, je l’ai aidé à trouver une chanson pour le début de l’histoire… Je fais des choses comme cela. Aussi, l’éditeur 2024 m’a demandé une postface pour la deuxième édition de Capitaine Mulet de Sophie Guerrive.
APN : Je suis assez surprise d’entendre que vous échangez avec des créateurs de bande dessinée . Vous accueillez souvent des étudiants, mais est-ce aussi souvent avec le cas avec des auteurs ?
DAB : Il y a plusieurs raisons qui font que je travaille avec des dessinateurs de BD. Souvent, ils ont besoin de repères ou de précisions d’un médiéviste. Un jour, j’ai reçu un coup de téléphone de Pierre Joubert, un dessinateur très connu depuis les années 1930. Il cherchait un médiéviste qui puisse faire les textes d’un livre sur les châteaux forts. Je lui ai proposé d’inclure au projet Françoise Piponnier, également médiéviste, car je ne connaissais pas tout. À cette époque, il avait comme apprenti le jeune dessinateur Patrick Pellerin. Nous travaillions tous ensemble dans son atelier et avions un regard sur son dessin. Il a retouché un vêtement sous mes conseils par exemple. Un homme n’aurait jamais porté du jaune à l’époque du moyen-âge… On leur donnait des plans de château, des informations techniques... On travaillait en direct l’image et les attitudes des personnages. J’ai aidé l’auteur sur d’autres de ses BD, toujours en documentant les scènes de la vie quotidienne. Le salon du livre d’histoire de Versailles m’a permis de renouveler cette expérience avec des dessinateurs, car il décerne le prix de la bande dessinée historique. Animabilis de Thierry Murat, publiée chez Futuropolis en 2018, est née lors d’un repas ensemble au salon du livre d’histoire. On a discuté ensemble du début, des vêtements et bijoux que portaient les enfants... C’est le genre de chose que j’ai fait à plusieurs reprises, avec Jean Harambat notamment, puisque je lui ai scanné des pages de livres d’archéologie de la Renaissance anglaise pour qu’il s’en imprègne. Cela peut aller très loin si les auteurs sont motivés, même si cela ne se voit pas forcément dans les albums. Patrick Pellerin avait par exemple repris la série ancienne de Barbe Rouge, le pirate, et souhaitait toucher de sa main des objets de l’époque qu’il allait dessiner. Dans notre groupe d’archéologie, mon patron avait un étudiant qui travaillait en Guyane et Patrick Pellerin s’est rendu sur le site pour le fouiller. C’est extraordinaire.
APN : Globalement, perceviez-vous des évolutions positives ou négatives depuis que vous avez intégré le milieu bédéphile ? Si oui, quelles sont-elles ?
DAB : Jacques Martin, lorsqu’on avait fait l’expo AVE ALIX, avait dit dans des interviews : « je suis une source pour les historiens ». C’était grotesque. La licence poétique, c’est tant qu’on veut à partir du moment où on n’affirme pas que la vraie histoire est dans la BD. L’historien aujourd’hui a pour devoir d’agir sur cela. Cependant, cela ne me gêne pas du tout de voir des « faux » moyen-âges dans des univers de fiction ou de fantasy par exemple.
La production de la BD est tellement grande qu’on ne peut pas tout lire. Aujourd’hui, je n’ai pas une vision globale, mais plutôt partielle. Je lis en fonction des auteurs, du style graphique, par période, sujets, en me focalisant sur les BD qui m’intéressent. Après la COVID-19, je me suis intéressée avec ma fille à la représentation des virus…
Les seuls qui ont cette vision globale sont les bibliothécaires de musée, comme Catherine Ferreyrole à la Cité de la BD, qui voient tout passer . La bédéphilie était quelque chose de militant dans les années 1960-1970. Aujourd’hui, il n’y a plus besoin de militantisme. La BD est un projet culturel identifié, et pas un objet non-identifié, comme l’aurait dit Thierry Groensteen. On en trouve même dans les journaux bourgeois, on trouve du Spirou, etc. Tout le monde peut lire des BD, il n’y a plus ce mépris.
Après, il y a les collectionneurs, je pense que c’est une vraie déviance. La collection de pièces rares complètement hors de prix prive des musées de sources et certains dessinateurs de BD se battent contre cela en léguant leurs œuvres à la Bibliothèque nationale de France. Mais d’autres revendent leurs planches originales et c’est un peu bizarre… C’est comme les pièces du moyen-âge vendues aux personnes privées. Comme on aurait collectionné les lingots d’or, aujourd’hui on collectionne ça. Je pense que ce n’est pas l’avenir qu’il faut rêver pour la BD, mais je dis peut-être ça car j’ai beaucoup travaillé avec les musées (rire).
APN : Il est vrai que la bande dessinée en tant qu’œuvre d’art devrait toujours pouvoir être accessible au plus grand nombre.
DAB : C’est pour cela que certains des artistes font don de leur vivant à des institutions. Car sinon, c’est la famille qui tire profit en revendant pièce par pièce aux collectionneurs. Cela me rappelle les marchands de livres anciens du 19e siècle qui récupéraient les pages de gravures pour les revendre et jetaient les livres. La BD est dans la vie intellectuelle de tout le monde, il y a aussi le numérique et les scans. Mais je préfère quand les planches sont dans les musées qu’aux mains de riches collectionneurs privés (rire).
Pour aller plus loin
Entretiens bédéphiles